Une sorte d’ornithorynque
Quand Alexandre le merveilleux traverse le miroir d’Alice,
par Gilbert Salem
Ceux qui ont longtemps situé Alexandre Vialatte dans la catégorie des écrivains mineurs (le terme consacré est «mineurs mais brillants, indispensables») ont certainement été incapables de s’expliquer leur imperméabilité à son humour: comment un traducteur de Kafka pouvait-il, inlassablement, écrire des romans, des contes, des essais, des chroniques en s’y moquant de tout, en renversant l’ordre de la logique, en parodiant les méditations les plus sérieuses, en faisant la nique aux théories les plus solennelles de l’histoire de l’humanité ? Ce charmant Auvergnat du XVIII’ arrondissement a même affirmé que l’adjectif «kafkaïen» ne doit pas forcément s’appliquer à la grisaille des empires administratifs, à la douleur d’être né, ou à une vision angoissée de la civilisation moderne. Il a même osé affirmer que Kafka, ça peut être drôle !

Je crois que les intellectuels français de la génération d’André Gide ont eu pour les propres écrits de Vialatte rien de plus que de l’indulgence. Puisqu’il était impossible de lui nier une maestria de styliste, une érudition fine et dédaléenne — encore qu’elle refusait d’épuiser les sujets, qu’elle se contentait de les évoquer — ils l’ont considéré comme un écrivain talentueux mais facé-tieux, un mou, un apolitique, un ambigu, un ambidextre, un intellectuel démuni de pensée engagée. Pour ne rien arranger, c’était un monsieur qui avait l’audace infantile de persifler les philosophies proclamant une foi dans la grandeur de l’homme. L’homme, il se bornait à le définir comme un petit passant à chapeau mou qui attend l’autobus.
Il faut absolument relire la très belle biographie que lui avait consacrée en 1981 son amie Ferny Besson, chez Lattès. Dans Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, elle écrit: «Mais d’abord, à quelles références se reporter ? Sûrement pas celles des slogans politiques. Celles des philosophes ? Ils sont loin, on le sait, de s’être mis d’accord. (…) Peut-être pour-rait-on dire qu’Alexandre Vialatte a une sensibilité de gauche avec des idées de conservateur, navré par la disparition des choses selon lui utiles au bonheur de l’homme et au respect de la civilisation.»
Vingt ans après sa mort, la sensibilité des mandarins de Paris a évolué. Disons qu’elle a fini par sè débarrasser de cette insupportable résille de lignes idéologiques, au sein de laquelle son esprit libre et individuel se sentait à l’étroit, fautif, et était voué à l’ombre, à l’anonymat. Tandis que le Tout-Paris était en effervescence autour des récits de Minou Drouet (à laquelle même Cocteau finit par dédier un hommage méchant: quelle perte de temps !), Vialatte était ignoré. Aujourd’hui qu’il est de bon ton de ne plus croire aux valeurs, que l’intellectualité pari-sienne se moque des écoles, encense les individualismes les plus débridés — les moins brillants aussi — la beauté candide des romans de fiction, ou des chroniques qu’il signait dans La Montagne de Clermont-Ferrand, la NRF et le magazine féminin Marie-Claire a réapparu. Elle resplendit, émeut, elle crée un peu partout des courants de sympathie, des familles à sensibilité via-latienne.
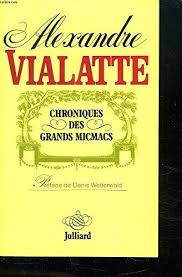
Je perçois personnellement Vialatte comme un héritier direct non pas d’Alphonse Allais — dont le génie littéraire ne s’est pas exprimé que par des traits d’esprit, non pas par un état de pensée continu — mais de Lewis Carroll. Comme l’auteur de La chasse au Snark, Vialatte est un être tellement épris de logique pure qu’il en éprouve le besoin de secouer l’ordonnance rationnelle de l’intelligence humaine. Il est perpétuellement hanté par une passion ludique, qui est celle des potaches de l’école de sous-préfecture (relire Les fruits du Congo, La femme de Job). Vialatte est un enfant qui s’amuse avec des objets, des instruments, des outils qui sont généralement réservés aux adultes. Un sophiste au coeur de garnement.
«Qu’est-ce que le cheval ?» écrit-il par exemple dans un texte où il s’amuse irrévérencieusement des théories péremptoires de la zoologie moderne. «Qu’est-ce que le cheval ? Tout le monde a la notion du cheval. Si on ne l’a pas, il suffit à l’esprit de se représenter un âne, mais un grand âne avec la queue moins étriquée. Ou alors un boeuf, en moins gros, sans cornes, avec une crinière. Ou à la rigueur un homard, mais sans pinces ni carapace, monumental, avec le poil luisant et des sabots qui sonnent sur une route asphaltée. Ou alors un très gros lapin, un lapin de cinq cents kilos qu’on pourrait atteler à une voiture et qui ressemblerait à un cheval. Ou encore un paquet de lapins, de cinq cents lapins d’un kilo pièce, agglomérés pour faire un lapin synthétique qui aurait une crinière abondante, avec une selle et un jockey. Bref, tous les animaux sont propres à donner une idée du cheval à condition de les faire déformer par l’esprit dans le sens qui les rap-proche réellement du modèle.» (tiré de Antiquité du Grand Chosier, Julliard).
Imaginez le faciès binocleux, le front blême et illuminé, le sourcil sévère du grand Gide à la lecture d’une description pareille !
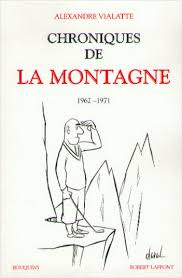
Vialatte s’intéressait quand même très souvent aux grandes préoccupations de ses contemporains. Mais il y mettait une forme différente. A propos de la mauvaise foi des erreurs judiciaires, il s’accusait lui-même. «Il est des cas où elle éclate [la mauvaise foi], écrivait-il dans La Montagne du 19 avril 1966. Je n’aurais pas signé le recours en grâce d’Eichmann. Même étant contre la peine de mort de façon inconditionnelle. Mais comment se fait-il qu’aucun de ceux qui disculpent le criminel en le présentant comme une victime de son enfance, de ses parents, de son entourage, de son milieu, de la société en général, n’ait demandé l’acquittement d’Eichmann ? Si quelqu’un a été élevé dans l’idée que le crime était bien, patriotique, utile, glorieux, c’était bien lui ! Chaque crime lui donnait du galon ! Alors ?… Il en faut bien conclure que les adversaires de la peine de mort ne croient pas à leurs arguments. Qu’ils admettent tout de même la conscience !
Mais peut-être aussi ne l’admettent-ils que pour certains ? Ils ont leurs têtes ? C’est eux qui le savent. Ils ne me l’ont jamais expliqué.»
Ou encore cette description qu’il a faite de Blaise Pascal, un Auvergnat comme lui, et par laquelle il résume sa propre perception de la réalité, son amour de l’existence et sa foi: «Peut-être faut-il pour bien goûter Pascal avoir été contraint d’admettre par les chiffres qu’il y a un envers du tapis, qu’il existe un au-delà de la logique, un point de rupture entre nos vérités et la vérité intégrale, une discontinuité des lois de la raison, et que le plus haut point où elles puissent se hausser est d’admettre qu’elle doit se renier sous peine de se renoncer (…) Ainsi, dans Pascal, l’univers sensible semble explicable seulement par une équation qui nous oblige à admettre également un univers où les contraires se concilient, le transcendant, justifiant le réel, un troisième ordre justifiant les deux autres, la «charité» expliquant tout le problème, avec deux chemins pour y conduire: le calcul, l’algèbre, la logique et sa longue route humaine; ou l’intuition, la voix du coeur, la voie royale, le chemin de la flèche, le vol de l’oiseau.»
Alexandre Vialatte s’amusait de la destinée de l’ornithorynque, cet étrange animal à poils et à écailles, doté de tétons comme les mammifères, d’un bec comme les oiseaux et qui fut découvert au petit bonheur la chance au début du siècle dernier par des voyageurs qui n’en crurent pas leurs yeux. Toutes les classifications du règne animal instituées jusqu’à ce jour furent chamboulées par son apparition. Quand on le présenta, encore vivant, à l’Académie des Sciences à Londres, les savants conclurent simplement que l’ornithorynque n’existait pas.
G.S.
(Le Passe-Muraille, No 3, septembre 1992)


