Une mémoire pour l’oubli

Fragments inédits d’un recueil du poète palestinien Mahmoud Darwich (1941-2008), en ouverture du Passe-Muraille de juillet 1994.
Une aube que porte le feu. Un cauchemar qui vient de la mer. Coqs métalliques. Fumée. Fer qui offre le festin du fer triomphant. L’aube qui naît des sensations avant que d’être perceptible. Un grondement me chasse du lit et me jette dans l’étroit couloir. Je ne veux rien, n’espère rien. Je suis incapable de bouger un membre dans ce bouleversement général. Pas de temps pour être prudent, pas de temps pour le temps. Si je savais seulement, si je savais comment mettre un peu d’ordre dans cette mort tombant en déluge ! Si je savais comment libérer les cris enfermés dans un corps qui ne m’appartient plus tellement il s’efforce d’échapper au chaos des bombes ! Assez ! Assez !
J’ai chuchoté pour savoir si je peux faire quelque chose qui me ramène à moi-même, et qui me montre la bouche du gouffre, ouverte de toutes parts. Je ne peux pas m’abandonner à ce destin, et je ne peux m’insurger. Fer qui hurle, auquel répondent d’autres aboiements. La fièvre des métaux est la chanson de cette aube.
Si cet enfer pouvait cesser cinq minutes ! Advienne que pourra ! Cinq minutes. Je dirais presque: cinq minutes seule-ment, pour l’unique chose à faire avant de me préparer à mourir, ou à vivre. Cinq minutes, est-ce suffisant ? Oui, assez pour me glisser dans ce couloir qui mène à la chambre, au bureau, à la salle de bains où il n’y a plus d’eau, à la cuisine où je guette l’instant de me précipiter depuis une heure, en vain. Jamais je n’y arriverai.
J’ai dormi il y a deux heures. J’ai mis du coton dans mes oreilles et j’ai dormi après avoir écouté le dernier bulletin d’information. Ils n’ont pas dit que j’étais mort, c’est donc que je suis vivant. J’ai palpé mon corps, constaté qu’il était entier. Dix doigts au sol, dix doigts plus haut. Deux yeux, deux oreilles, un long nez. L’autre doigt au milieu. Le coeur, il ne se voit pas et rien ne témoigne de sa présence, rien d’autre que mon désir obstiné de faire le décompte de mes membres. Un pistolet posé sur une des étagères de la bibliothèque. Un élégant pistolet, propre, brillant, de petite taille et sans munitions. On m’en a donné une boîte avec le pistolet il y a deux ans de cela et je ne sais plus où je l’ai cachée de peur d’une bêtise, de peur d’un éclat de colère, de peur d’une balle perdue. Je suis donc vivant, ou plus exacte-ment: je suis.

Personne n’entend la supplication qui s’élève de la fumée: donnez-moi cinq minutes pour que je mette cette aube, ma petite part d’aube, sur ses deux pieds, pour que je puisse me préparer à entamer cette nouvelle journée née des lamentations. Sommes-nous en août ? Oui, en août, et la guerre est devenue siège. Je cherche à la radio, ma troisième main, ce qui se passe en ce moment même. Pas de témoins, pas de nouvelles. La radio dort.
Je ne me demande même plus quand cesseront les aboiements métalliques de la mer. J’habite au huitième étage d’un immeuble que tout chasseur aimerait épingler à son tableau de chasse. Alors, avec cette armada qui a transformé la mer en enfer… Au nord, l’immeuble offrait à ses habitants le spectacle du toit ridé de la mer, façade de verre désormais tournée vers le massacre à ciel ouvert. Pourquoi suis-je venu m’installer ici ? Quelle question stupide ! Voilà dix ans que j’habite ici, et cette débauche de vitres ne m’a jamais dérangé.
Comment atteindre la cuisine ? Je veux l’odeur du café, je ne veux rien d’autre que l’odeur du café. De tous les matins du mon-de, je ne veux rien d’autre que l’odeur du café, pour me reprendre, me remettre sur mes deux pieds, me transformer d’animal rampant en être de raison, saisir ma part d’aube, avant notre dé-part, le jour et moi, vers la rue, en quête d’ailleurs.
Comment faire pénétrer l’odeur du café dans mes cellules, tandis que les obus s’abattent sur la cuisine ouverte au-dessus de la mer, répandant des senteurs de poudre et la saveur du néant ? Je me suis mis à mesurer le temps qui s’écoule entre deux explosions. Une seconde, une seule seconde, pas même le temps de reprendre souffle, le temps d’un battement de coeur. Une seconde, pas assez pour que je me tienne devant le réchaud sous la large fenêtre au-dessus de la mer, pas assez pour que j’ouvre la bouteille d’eau, pas assez pour que je remplisse la bouilloire, pas assez pour que je craque une allumette. Bien assez pour que je disparaisse en fumée.
J’ai fermé la radio. Je ne me demande plus si les murs du couloir offrent une protection suffisante contre la pluie d’obus. L’important, c’est qu’il existe une pardi pour me dérober à ce ciel transformé en métal dévoreur de chair: coups au but, éclats, ou souffles des explosions. En pareil cas, un rideau épais suffit à procurer l’illusion d’un refuge. Mourir, c’est voir venir la mort.
Je veux sentir l’odeur du café. Cinq minutes. Je veux une trêve de cinq minutes pour un café. Je ne veux rien d’autre que me préparer un café. Cette obsession me donne un but, un objectif. Tous mes sens sont tendus vers cet unique appel. Ma soif n’a plus qu’un but: un café.
Le café, pour l’amateur de café que je suis, c’est la clé du jour.
Le café, pour le connaisseur que je suis, il faut se le préparer soi-même et ne pas se le faire servir. Car celui qui vous l’apporte y ajoute ses paroles, et le café du matin ne supporte pas le moindre mot. Il est aube vierge et silencieuse. L’aube — mon aube — est étrangère à la moindre parole. L’odeur du café boit le moindre des bruits, fût-ce un simple bonjour, et se gâte.
Le café est donc ce silence originel, matinal, circonspect, solitaire, où tu te tiens, tout seul, avec cette eau que tu choisis, paresseusement et coupé du monde, dans une paix retrouvée avec les êtres et les choses. Eau que tu verses lentement, lentement, dans le petit récipient de cuivre, aux reflets sombres et mystérieux, dorés, presque fauves, avant de le poser sur un feu doux, ou mieux encore sur un charbon de bois.
Ecarte-toi un peu de ce que tu as mis à chauffer à feu doux pour observer, en bas, la rue qui s’éveille et qui part à la recherche de son pain, depuis que le singe est devenu homme. Rue portée par les charrettes des marchands de quatre saisons, les couplets naïfs des commerçants qui vantent leurs marchandises. Respire l’air venu de la fraîcheur de la nuit, retourne ensuite à ton fourneau — ah si seulement c’était un feu de bois ! — et observe, avec calme et mesure, le jeu des éléments: le feu qui s’irise de vert et de bleu, l’eau qui se ride et exhale de petites bulles blanches qui se transforment en pellicule brillante, laquelle ne tarde pas à s’épaissir, à s’épaissir doucement, qui vont s’élargissant toujours plus rapidement, et se brisent, pour crever en grosses bulles, qui se gonflent à nouveau et se brisent, avides de dévorer les deux cuillerées de sucre dont l’absorption provoque un discret sifflement redevenant, quelques instants plus tard, gargouillis bouillonnant, impatient d’une nouvelle offrande, celle de la poudre rugissante, étalon de senteurs et de virilité orientale.
Éloigne le récipient du feu et entame le dialogue de la main, encore vierge de toute trace de tabac ou d’encre, avec la première de ses créations, avec sa création première, qui délivrera, en cet instant, la saveur de ta journée et le verdict des augures. Elle te dira si tu dois travailler ou te tenir à l’écart du monde. De ce premier geste, de son rythme, de ce que lui confère le monde du sommeil encore ouvert sur la journée passée, de ce qu’il révèle de ton âme, dépendra la couleur de ta journée.
Le café, la première tasse de café, est le miroir de la main, de cette main qui tourne le breuvage. Le café est déchiffrement du livre ouvert de l’âme, devin des secrets que le jour renferme.
Depuis la mer, l’aube de plomb continue à progresser, portée par des sons comme je n’en avais jamais entendus. La mer tout entière est farcie d’obus qui s’y perdent. La mer n’est plus liquide, se fait métal. Tous ces noms sont-ils pour la mort ? Nous avons dit que nous sortirions. Alors, pourquoi cette pluie rouge, noire, grise, sur ceux qui s’apprêtent à sortir et ceux qui resteront, hommes, pierres, arbres ? Nous avons dit que nous sortirions. «Par la mer», ont-ils exigé. «Par la mer», avons-nous accepté. Alors, pourquoi arment-ils vagues et embruns de ces canons ? Pour que nous nous hâtions davantage ? Ils doivent commencer par lever le siège, du côté de la mer, ils doivent ouvrir la dernière voie pour laisser couler notre dernier filet de sang. Tant qu’il en sera ainsi — et il en est ainsi —, nous ne sortirons pas. Je prépare donc le café !
(…)
La voûte du ciel s’abaisse, comme un toit de béton qui s’effondre. La mer devient terre ferme et se fait proche. Le ciel et la mer ne forment plus qu’une même pâte, mer et ciel s’étreignent à m’étouffer. J’ai ouvert la radio pour prendre des nouvelles du ciel. Je n’ai rien entendu. Le temps s’est solidifié, s’est installé sur moi pour m’étouffer. Les avions ont fui entre mes doigts, ont déchiré mes poumons. Comment arriver jusqu’à cette odeur de café ? Comment mourir, desséché, sans l’odeur du café ? Je ne veux pas, je ne veux pas… Mais où est ma volonté ?
M. D.
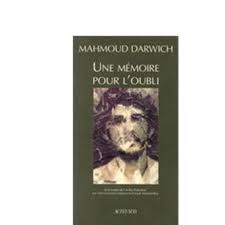
Extrait de: Une Mémoire pour l’oubli. Le temps: Beyrouth. Le lieu: un jour d’août 1982. Récit traduit de l’arabe (Palestine) par Yves Gonzalez-Quijano et Farouk Mardam-Bey, à paraître à l’automne 1994 aux Editions Actes-Sud, dans la collection «Mondes arabes». La rédaction du Passe-Muraille remercie les Editions Actes-Sud d’avoir permis la publication de ce texte.
(Le Passe-Muraille, No 14, juillet 1994)
