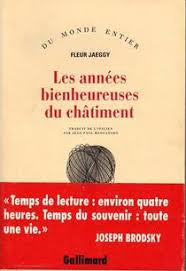Une Fleur des hauts gazons
À propos du (merveilleux) premier récit de Fleur Jaeggy, Les années bienheureuses du châtiment,
par Claude Frochaux
«À quatorze ans j’étais pensionnaire dans un collège de l’Appenzell. En ces lieux où Robert Walser avait fait de nombreuses promenades lorsqu’il se trouvait à l’asile psychiatrique, à Herisau, non loin de notre institution. Il est mort dans la neige. Quelques photos montrent ses traces et la posture de son corps dans la neige. Nous ne connaissions pas l’écrivain. Et il était même inconnu de notre enseignante de littérature. Parfois je pense qu’il est beau de mourir ainsi, après une promenade, de se laisser choir dans un sépulcre naturel, dans la neige de l’Appenzell, après presque trente années d’asile, à Herisau. Il est vraiment dommage que nous n’ayons pas connu l’existence de Walser, nous aurions cueilli une fleur pour lui. Kant lui-même, avant sa mort, fut ému lorsqu’une inconnue lui offrit une rose. Dans l’Appenzell, on ne peut faire autrement que de se pro-mener.»
Ainsi commence le livre de Fleur Jaeggy, Les Années bienheureuses du châtiment. Fleur Jaeggy est-elle un écrivain suisse ? Oui, si on se fait de la Suisse une vision élargie, cosmopolite, en accordance avec son livre. Fleur Jaeggy est née à Zurich et vit à Milan. Elle écrit en italien. Elle est romancière et, par ailleurs, la femme de l’éditeur Roberto Calasso, le directeur d’Adelphi, l’une des meilleures maisons d’édition italiennes. Roberto Calasso, lui, est essayiste et comme Fleur Jaeggy publie chez Adelphi en italien et chez Gallimard en français. Roberto Calasso fut lauréat en automne 1991 du Prix européen de l’essai décerné par la Fondation Veillon de Lausanne. Tout cela est très suisse, en définitive. A condition d’avoir de la Suisse cette vision un peu élargie et contemporaine dont nous parlions et qu’avaient nos ancêtres. Par exemple au XVIe siècle, lorsque sur un coussin de velours grenat, le capitaine des régiments suisses remettait la clef de Milan à Maximilen Sforza. Il suffit de voir la Suisse un peu plus épanouie dans ses horizons et la famille Calasso nous appartient de haute lutte !


Donc, Fleur Jaeggy est suisse et parle de l’Appenzell, ce qui lui valut le Prix Bagutta en 1990. Une de ses meilleures critiques fut Ingeborg Bachmann qui écrivait du premier livre de Fleur Jaeggy: «L’auteur à l’enviable premier regard pour les personnes et les choses, il y a en elle un ensemble de légèreté distraite et de sagesse autoritaire.» On ne saurait mieux dire.
Mais que nous raconte Fleur Jaeggy dans ce quatrième court roman — une centaine de pages — et qui porte ce mystérieux titre aux résonances bibliques ? Eh bien, tout simplement, sa jeunesse adolescente qui se passa pour une bonne part dans un collège de jeunes filles en Suisse, dans l’Appenzell. Une de ces institutions qui définissent mieux la Suisse que n’importe quelles autres, qu’elles soient bancaires ou chocolatières. Il n’y a qu’en Suisse ou dans la banlieue parisienne, à en croire Valery Larbaud, qu’on trouve ces creusets des figures marquantes à venir de la haute société internationale. Il y a les Américaines du Sud, les Scandinaves, les fascinantes arabes avec la figure du père inscrite en pétro-dollars dans un arrière-plan mythique.
C’est tout cela que raconte Fleur Jaeggy, mais aussi beaucoup plus. D’autres ont raconté ces jeunesses déracinées dans la séquestration des pensionnats. Sagan l’avait fait de la manière la plus saisissante — pas Françoise, l’autre, Léontine, et pas en littérature mais au cinéma, dans Jeunes filles en uniformes, et pas récemment mais dans l’avant-guerre et en Allemagne. Il y a eu aussi dans le monde allemand Les Désarrois de l’élève Törless, par beaucoup d’aspects le livre le plus proche dans l’esprit de ces Années bien-heureuses du châtiment, pour ne pas perler de Colette, ou plus près de nous de Guy de Pourtalès, de Mercanton et tant d’autres.
Fleur Jaeggy nous parle du Bausler Institut, de sa vie feutrée, des cérémonies qui ponctuent l’an-née et qui ne sont pas toujours religieuses. Il y avait, par exemple, la réception du Président d’un Etat africain, dont la fille, la petite négresse qui toussait toujours, était devenue pensionnaire. «Madame Hofstetter était émue comme un animal de basse-cour». Toutes les jeunes filles avaient dû s’aligner, comme si le Président passait une garde d’honneur en revue. Ce n’était pas juste, pas démocratique. Il y avait déjà les têtes subversives et les résignées. Il y avait Micheline aussi et Marion et l’Allemande qui partageait la chambre de la narratrice. Et puis, les professeurs, la hiérarchie, l’ordre établi immuable d’un lieu clos, autonome, autarcique, éloigné de tout et du monde, Teufen, Appenzell.
Solitude des riches, dont la richesse (des parents) parvient mal à recouvrir la pauvreté affective qui en résultait. Car, on devine autant qu’on lit, à quel point ces jeunes filles avaient été mises là parce que les familles étaient occupées ailleurs, à des affaires importantes, familles souvent éclatées, le père ici, la mère au Brésil. Et le monde de l’adolescence se vivait entre adolescents, l’univers des adultes ne servant que de loi-cadre comme dans les ordonnances administratives. «Il était évident que j’allais devoir passer mes meilleures années au collège. De huit à dix-sept ans.» Le grand moment était la distribution du courrier. «Quant à moi, je recevais peu de lettres. Elles étaient distribuées à table. Ce n’était pas agréable d’avoir peu de courrier. Aussi, commençai-je à écrire à mon père, des lettres insipides, où je ne disais rien. J’espérais qu’il allait bien, comme moi j’allais bien. Il me répondait tout de suite en mettant sur l’enveloppe des timbres de la Pro Juventute, me demandait comment il se faisait que je lui écrivisse tant.»
Solitude avec pour corollaire naturel la fascination que peut exercer la figure distante et singulière d’une camarade «différente». Chacun a connu cela jusqu’au mysticisme et le livre de Fleur Jaeggy explore cette dimension de l’adolescence avec une précision et une justesse remarquables. Tout tourne autour de Frédérique: «Elle avait quinze ans, les cheveux aussi raides que des lames, brillants, les yeux sévères et fixes, pleines d’ombre. […] Un beau front haut, où les pensées se laissaient presque toucher, où les générations passées lui avaient transmis talent, intelligence, charme. Elle ne parlait avec personne. L’apparence était celle d’une idole, hautaine. C’est pourquoi, peut-être, je désirai faire sa conquête. Elle n’avait pas d’humanité.»
Par ses trop-pleins de sensibilité et d’émotion, l’adolescence est déjà le temps des événements psy-chiques majeurs. Lorsque cette adolescence se déroule dans des pensions hors du temps et qui servent de caisses de résonance de l’âme, tout devient immense, solennel, définitif. La narratrice est assez lucide pour mesurer sa fascination, mais l’empire de Frédérique ne cesse de croître. Et son indifférence aux autres augmente encore la souveraineté qui l’habite. Aucune rébellion d’ailleurs, malgré sa violence naturelle. Elle aimait l’ordre, elle était bonne élève, disciplinées, exemplaire.
On pourrait croire que la vie du Bausler Institut était coupée de l’extérieur. Que les drames qui s’y jouaient, les relations qui se nouaient, étaient pour rire. Comme dans l’antichambre d’une vie à venir, la répétition en quelque sorte avant le spectacle. Mais il n’en était rien. Les Hofstetter finiront par mourir pour de bon. Et le temps aussi s’écoulait pour de bon. Et les cicatrices des passions étaient de vraies cicatrices qui ne se refermeraient pas une fois franchie la porte de sortie.
Car, on retrouvera plus tard la narratrice et Frédérique.Beaucoup de choses s’expliqueront. On com-prendra que certaines singularités peuvent être fatales et que la souveraineté se paie en monnaie sonnante et surtout trébuchante. Personne ne jouait pour rire. C’était bien là la vie, la vraie vie, avec ses acteurs mal préparés, grimés de travers, maladroits et fragiles. La vraie vie confiée parfois à des journaux intimes dont on se souvient surtout des fermoirs et des clefs.
Tout l’art de Fleur Jaeggy tient dans la succession de ces phrases si brèves qu’on a l’impression par-ois qu’elles se termineraient en sanglots si un point final n’arrêtait pas les larmes. Une sécheresse qui n’est pas celle du coeur, mais d’une lucidité qui se refuse à la complaisance sentimentale. L’intelligence est à vif, comme on le dit des nerfs, mais la charge émotive est sous-jacente. Raisonneuse et à l’affût, mais jamais cérébrale: un ensemble de «légèreté distraite et de sagesse autoritaire», Ce genre de lucidité ne lasse pas, elle est vivante, ouverte, elle étonne, elle déconcerte. Par ses brusques sautes d’humeur, par ses regards de coulisse et ses changements de registre, Fleur Jaeggy parvient à la fraîcheur. On foule ces pages pour la première fois. On se laisse enva-hir, troubler, charmer. Et c’est très bon ce peuplement de personnages qui se mettent à vivre et qui ne nous lâchent plus. On est pris à son tour. On croyait que c’était pour la nostalgie. Non, c’était la vie. C’était pour de bon !
C.F.
Fleur Jaeggy, Les Années bienheureuses du châtiment, traduction Jean-Paul Manganaro, Editions Gallimard, 1992.
(Le Passe-Muraille, No 1, Avril 1992)