Frères et sœurs
(Chronique des tribus)
Par JLK

1. En mémoire de l’Hidalgo
2. Le pull sport chic

3. À la chasse

4. La belle noyeuse

5. Sous le manteau

7. Comme un sac de charbon !

8. Déchirons la Vieille !

9. L’Art d’être grand-père
10. L’abuelito de la chanson

11. Téléphonages

12. Secrets de famille
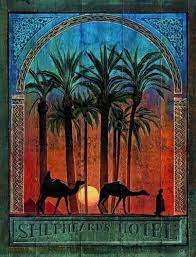
13. Tribulations

14. Familles je vous haime…

15.« On s’en roule une ? »
C’est à l’incitation de son vieil ami l’oiseleur Rainer Vogelsang, lui évoquant un roman récent selon lui captivant qui se passe dans les parages de Maracaibo, que le frère, songeant précisément au séjour de sa sœur aînée au Venezuela avec l’Hidalgo, à la fin des années 70, en est venu à se plonger à son tour dans ce roman dont il n’a pu se détacher des cent premières pages, relevant dès la première un détail qui a rappelé une manie de son impayable grand-oncle Fabelhaft, lequel faisait usage d’une rouleuse à cigarettes argentée à motifs gravés quand il amorçait l’un de ses récits à tiroirs, vous regardant par dessous avant de faire semblant de s’excuser (je m’en roule une vite fait, d’accord ? »), la même petite machine que la taiseuse mendiante Teresa trouve dans les langes de l’enfant abandonné sur le parvis d’une église dédiée à San Antonio, et le frère dit à sa sœur ainée que rarement, depuis longtemps, il n’a éprouvé par la lecture une sensation aussi intense de se plonger dans la chair vive et les parfums, les couleurs et les saveurs d’un pays aussitôt ressaisi, aussi, dans ses magies diffuses et profuses à la fois, avec ce môme abandonné comme dans un roman de Dickens, auquel la mendiante fauche cet objet avant de lui revenir honteuse et de l’adopter pour ainsi dire quoique à regret, de l’allaiter au pis de sa chèvre noire et de le garder avec elle au point de se demander bientôt si cette pauvre chair n’est pas sortie de la sienne, et la sœur de lui dire par Whatsapp qu’elle aussi a pour ainsi dire adopté le Venezuela quand elle y a mis un premier pas, sans se rappeler à vrai dire le détail de la rouleuse à cibiches – et le voici évoquer ce soir le bazar des troubles actuels, et elle de se demander si son projet prochain de se pointer dans les Caraïbes pour y fêter les 80 ans d’une sienne chère amie se fera sans trop d’encombres, « mais là je vais repartir pour Maracaibo via Google Earth », lance le frère à sa sœur, et cet autre transit virtuel ajoute, les odeurs en moins, à son étonnement en constatant que la mangrove où le jeune Antonio patauge à sept ans, au début des années 20, a fait place à une agglomération tentaculaire qui vue du ciel ressemble à une mégalopolis chinoise ou lunaire, et que le grand lac est un cloaque et qu’il est sûrement interdit de fumer dans les avions, mais ce soir les mots du poète reprendront le dessus, le petit Antonio passé par l’école de la vie entre les filles en chemises du Majestic et les coureurs de mer sachant la mélodie des vent et le langage des marées, le collecteur d’histoires d’amours et l’amant d’une femme aimée pour la vie, le révolté promis aux tortures venir et la mémoire d’une dynastie – cela que les images ne disent pas et que le Verbe ressuscite…

16. De sales gens
Le frère s’est promis de demander à sa sœur ainée si, en huit décennies d’existence d’abord dépendante étroitement des braves gens de sa famille, puis s’en émancipant avec l’Hidalgo et transitant par divers pays et divers cercles sociaux, jusque dans la proximité géographique des fameux narcos latinos, elle ait jamais eu à se frotter à de sales gens, mais vraiment de sales gens hyper mauvais et même dangereux pour elle et ses enfants – des gens qui t’empêchent de dormir et quand tu dors te réapparaissent grimaçants et ricanants, « mais pas du tout », qu’elle répond à son frère en s’étonnant de ce qu’il lui pose une question pareille, alors il lui dit qu’il a l’impression que la publicité faite aux sales gens n’en finit pas de s’amplifier à l’exponentielle, qu’hier il regardé la moitié d’un début de série où il n’était question, dans le New York le plus huppé, que de came et de meurtres, que la veille il a subi une autre moitié de série documentaire consacrée à l’animateur américain de l’émission la plus abjecte qui fût, le fameux Jerry Springer équivalent du non moins odieux Cyril Hanouna, bref que tous les jours et plus encore les nuits les médias n’en finissent plus de faire état des faits et gestes des plus sale gens de l‘Espèce, or sa sœur le rassure, « mais pas du tout du tout, mon cher, toi je ne sais pas vu que tu as circulé plus que nous dans les lieux plus ou moins louches d’un peu partout , mais moi et l’Hidalgo, à part un épisode affreux qui d’ailleurs nous a fait fuir quelques années chez les Latinos, nous n’avons en somme connu que de braves gens, parfois de sottes gens comme il y en a partout mais pas vraiment ce qu’on peut dire de vraiment vraiment sales gens – et puisque tu en es à te scotcher aux séries les plus sinistrement sordides, va donc plutôt voir Alias Grace et tu me diras ce que sont les belles et bonnes gens que nous aimons »…

17. De si belles personnes
Sa sœur aînée était encore en train de de se faire masser les orteils par la sable tiède de la fin de matinée, à Marbella Beach, quand il l’a appelée pour une bricole et lui a annoncé qu’il la rappellerait le même soir, et dans l’intervalle on a passé du ciel plombé du matin sur le Haut-Lac, les crêtes enneigées des monts de Savoie à peine lisibles, à une soudaine éclaircie de début de soirée flammée de bandes oranges et coïncidant avec l’apparition de Bruce Willis sur le petit écran de son laptop, à six minutes du début de ses 10 kil réglementaires sur sa bécane elliptique, et la fierté de tenir son programme, relançant ensuite sa sœur pour lui dire qu’il vient de voir les 35 premières minutes de Pulp Fiction qui lui ont inspiré cette réflexion, par rapport à ce qu’il lui disait la veille sur l’omniprésence croissante des sales gens dans les représentations médiatiques de toute espèce : qu’il n’y a que l’humour noir, à part la gentillesse naturelle et la bonté surnaturelle des Belles Personnes pour supporter l’épouvante de la vie en ses grandes largeurs, sur quoi, sa sœur lui ayant demandé s’il a suivi son conseil, la veille, de visionner la série Alias Grace, le frère confirme et la remercie pour cette découverte d’une indéniable Belle Personne (il le dit sans ironie), faisant écho à une autre sienne découverte d’une autre Belle Personne incarnée par la prénommée Ana Maria, dans cette troisième découverte que figure à ses yeux le dernier roman de ce Miguel Bonnefoy qu’il lui dit sa révélation de début d’année au titre de jeune auteur (il a l’âge de ses filles) dont la prodigieuse alacrité narrative, la sensibilité et la vitalité de l’écriture, l’énergie et la beauté qui se dégagent des 133 pages lues jusque-là sur les 300 que compte l’ouvrage – que tout ça le revigore un max à l’instant même où il se dit, devant l’écran de son laptop bloqué sur PAUSE, qu’il en est en somme ces jours à ses sessions de rattrapage puisque Le rêve du jaguar est déjà le septième roman de ce Bonnefoy et qu’il lui aura fallu passer le cap de ses 77 ans pour mater pour la première fois John Travolta en Vincent Vega avec son air de gorille à tête de chien à longue mèche huileuse et regard de bœuf musclé – « et là je te quitte, conclut-il, « vu que j’ai à préparer ma tarte aux pommes du vendredi en matant la suite de la romance affreuse de Tarantino and Co », etc.

18. Cette espèce de joie
19.Le fil invisible

20. La Hija mayor
21. Pergola

22. Rêverie
La dérive s’est amorcée juste après sa rencontre avec le jeune Birman, devant le petit portail du jardin de l’ancien Grand Hôtel abritant aujourd’hui l’École hôtelière internationale, le sourire engageant de l’étudiant à cravate et costume parfaitement appropriés à ses fines manières était une invite à cette esquisse de conversation au coucher du soleil d’hiver, ils ont échangé de souriantes banalités en anglais correct avant de se quitter avec la quasi certitude de ne jamais se recroiser, et ensuite le train vers le cinéma, le livre dans le train, les premières pages du livre évoquant le petit chat défunt dans le plaid à côté de la femme passée en vitesse à la boulangerie, l’enterrement du petit chat et la découverte des pièces d’or au lieu même de la petite fosse creusée dans le jardin, et l’Italie ensuite, les voyages soudain permis par la somme tirée de l’or exhumé, le souvenir de Baladine sa chatte à lui – donc tout un pan de sa vie à lui ressuscité -, le film à l’âpre mélancolie et l’autre certitude que jamais il n’irait en Corée de son vivant malgré son vague désir de voir un jour le soleil se lever sur Séoul – tout cela lui a été donné et repris en quelques heures avant son long piapia téléphonique avec sa sœur puînée et leur échange de souvenirs – elle lui rappelant qu’il avait en leur enfance des souris blanches bien avant ses chats et ses chiens, et lui revenant ensuite à son livre avec cette femme en Italie, d’abord à Naples puis à Sorrente où il se rappelle avoir vu, de ses yeux, le soir, une Madone en néon vert s’allumer au-dessus du port où les pêcheurs revenaient en fin de journée…
Que cette femme du livre ait trouvé des pièces d’or dans son jardin en enterrant son compagnon de dix-sept années passées ensemble, des napoléons et des bracelets, des bagues et des louis anciens, jusqu’au lingot reposant sur le fond de la boîte de plomb enfouie, tout cela lui semble aller de soi dans un roman, en tout cas comme c’est raconté, avec la grâce d’une écriture à la fois ailée et lestée d’évidence, et là c’est parti pour une longue songerie vu qu’il a lui aussi des trésors à revendre pour en financer ses virées…




J’ai hâte de lire la suite !