Edmund White, mémorialiste gay

par Sergio Belluz

Brillant, sophistiqué, précis, tendre et drôle, Edmund White est un must pour ceux qui veulent connaitre la petite histoire, la culture et la sociologie du mouvement queer depuis les années 1960 à New York et ses rapports avec l’intelligentsia franco-américaine – White est l’un des grands biographes de Jean Genet –, mais aussi pour tout ceux qui aiment la littérature de l’intime, l’écriture au jour le jour et les confidences littéraires où se côtoient vague à l’âme et humour quelquefois tendre, quelquefois vachard, jamais méchant et toujours drôle.
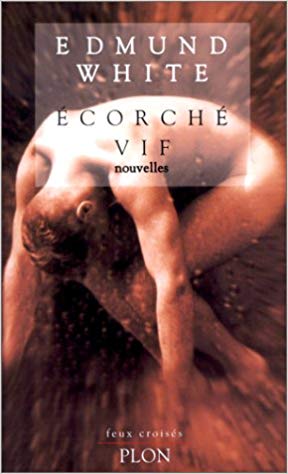
SKINNED ALIVE (ÉCORCHÉ VIF, 1995)
Dans Skinned Alive (New York : Knopf, 1995), en français Écorché vif (Paris : Plon, 1997), un recueil de « nouvelles » – j’écris « nouvelles » entre guillemets, parce qu’il s’agit en réalité, pour certaines, de textes autobiographiques devenus, peut-être par discrétion ou pour s’éviter des procès, des sortes de fictions un peu artificielles – il évoque, notamment, sa passion houleuse et malheureuse pour un certain Jean-Loup, jeune Bordelais de bonne famille, fantasque, intelligent, et dessinateur de BD. –, un Jean-Loup qu’on retrouvera, plus explicitement cette fois, dans Inside A Pearl : My Years in Paris (Londres : Bloomsbury, 2014), le journal parisien d’Edmund White, toujours pas traduit en français…
Dans l’original américain, c’est ce mélange de littéraire et de ragots, ou de ragots littéraires, parsemés d’expressions françaises chics qui fait tout le charme un peu snobinard, un peu désinvolte, de la prose de White, sans compter les informations très précises qu’il donne sur certaines personnalités, tant à Paris qu’à New York.
Il y a aussi tout un passage absolument extraordinaire sur le côté factice des monuments historiques : notre réalité, qu’on le déplore ou non, ce sont plutôt les HLM et les centres commerciaux, là où se trouve la vie contemporaine, ce qui la représente le plus fidèlement, tout le reste n’étant qu’une sorte de décor ravalé et plaisant, une projection, une vieille photographie, une construction factice comme peuvent l’être un Paris ou une Venise vu par Hollywood ou Las Vegas.
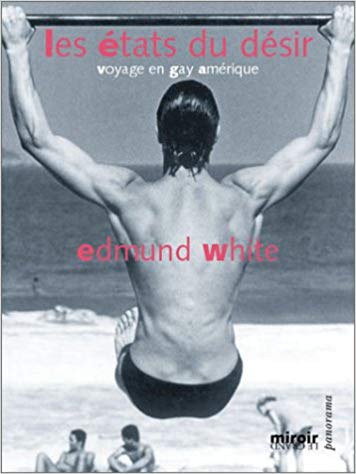
STATES OF DESIRE (1980)
Le titre original du livre – States of Desire (USA : Bantam, 1981) traduit 22 ans plus tard par Les États du désir : voyages en gay Amérique (Paris : Le Grand Miroir, 2002) – est ingénieux, à double sens: en anglais, c’est effectivement un descriptif des différents états du désir homosexuel, de ses différentes facettes mais aussi un voyage à travers l’Amérique gay dans divers états américains (Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Santa Fe…).
Comme toujours, je suis frappé par la finesse de White, et par son écriture subtile, qui reflète bien ce regard rêveur, dubitatif, à la fois sensuel, objectif et rationnel, avec cette touche d’humour, d’ironie, de second degré qui ressemble à ce que pourrait être une conversation aimable autour d’un bon repas.
La finesse, c’est cette façon d’observer – des comportements, des mimiques, des modes, des façons de s’exprimer, à la fois dans la diction et dans la terminologie utilisée –, toujours précise, toujours juste, toujours subtile.
Quant à l’écriture, c’est cette espèce d’élégance snob qui n’hésite pas à mêler richesse de vocabulaire et cohabitation de registres très divers avec une touche d’humour camp – en particulier dans les incises –, le tout en alternant de manière très équilibrée des descriptifs et des citations de gens qu’il rencontre.
Typiquement, il va écrire quelque chose comme :
Phil (I will call him Phil) was very good looking in an old-fashioned pin-up style, with his squared shirt, faded jeans, thick haircut and round black eyes that looked at you in a mix of seduction and naïveté.
(Ma traduction)
« Phil (je l’appellerai Phil), était très beau dans le genre pin-up à l’ancienne, avec sa chemise à carreaux, ses jeans délavés, ses cheveux épais et ses yeux noirs et ronds qui vous regardaient avec un mélange de séduction et de naïveté. »
Une écriture très gay, assez mordante sans être méchante, assez snob sans être maniérée, assez précise sans être méticuleuse et, au final, extrêmement juste, en l’occurrence totalement adaptée au sujet, que White sert magnifiquement.
J’ai beaucoup aimé un passage sur la scène cuir/SM où il rattache cette mouvance au protestantisme et à sa haine du corps.
Le sadomasochisme serait, selon lui, une manière d’exorciser – par des jeux de rôles –, les traumatismes vécus par les homosexuels dans leur rapport avec eux-mêmes comme dans les traitements qu’on leur a infligés.
Il relève que le SM s’est développé dans les pays à forte dominance protestante (les États-Unis, les Pays-Bas…), pas dans les pays catholiques, où une sensualité innée est en totale opposition avec le côté cérébral du SM.
On peut bien sûr s’exciter à l’idée de n’être qu’un jouet ou un esclave sexuel, un fantasme assez courant, mais la « scène » SM (et le mot « scène » traduit bien sa dimension de jeux de rôles), fétichiste par définition, implique tout un scénario et tout un attirail – bottes, gilets, accessoires divers – et toute une préparation physique et mentale pour arriver à la jouissance, bien loin d’un désir ou d’une sexualité plus liés à l’érotisme, à la simple attirance physique ou encore au besoin de partager une intimité physique et amoureuse.
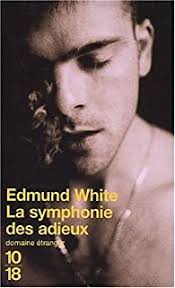
LA SYMPHONIE DES ADIEUX (1997)
The Farewell Symphony (New York : Knopf, 1997) – en français : La Symphonie des Adieux (Paris : Plon, 1998) – est un « roman » qui se veut le portrait de cette génération d’homosexuels qui a eu vingt ans dans les années 70, et qui, à New York, a vécu cette toute nouvelle liberté, conquise avec la révolte de Stonewall.
Une génération qui s’est beaucoup amusée, s’est beaucoup droguée et a beaucoup baisé – à Fire Island et dans les boîtes gays de New York –, puis a été décimée par le SIDA et a commencé à mourir en masse.
On retrouve ici le style, l’humour, le snobisme, le côté intellectuel camp, la marque de fabrique d’Edmund White, en somme, qui sait relever les grandeurs et les petitesses de chacun et en montrer, justement, toute l’humanité.
Dans The Farewell Symphony, je suis toujours étonné, à part la sensibilité et la subtilité qui caractérisent Edmund White, de cette sexualité si « sauvage » qu’il décrit.
Consommer et jouir
Autobiographie déguisée ou pas, le héros revient sur sa jeunesse, et sur le nombre incalculable d’hommes qu’il a sucé, qu’il a baisé, ou dont il s’est fait baiser.
Il raconte, par exemple, qu’après toute une suite de fellations, presque chaque jour, et d’autres baises sauvages, et même de fist fucking, il avait régulièrement rendez-vous chez son médecin généraliste pour des gonorrhées ou d’autres maladies vénériennes, pour lesquelles le médecin lui donnait des antibiotiques, comme à tous les autres patients, hommes pour la plupart, dans le même cas.
Les médecins trouvaient ça normal, ajustant la dose d’antibiotiques au fur et à mesure de la résistance du microbe.
On se dit que cette exposition constante a forcément dû affaiblir le système immunitaire, indépendamment du SIDA, qui commençait déjà à faire des ravages.
La forme et le fond
Pas sûr, toutefois, que la forme romanesque soit la plus adéquate en ce qui concerne White : je trouve qu’il est beaucoup plus fort dans la chronique.
À mon goût, ses livres de souvenirs – My Lives (Bloombury : London, 2005), en français Mes vies, Paris : Plon, 2006) ; City Boy : My Life in New York During the 1960’s and 1970’s (Bloomsbury : London, 2009), en français : City Boy (Paris : Plon, 2010) ; Inside A Pearl : My Years in Paris (London : Bloomsbury, 2014, pas encore traduit en français) –, sont des merveilles de précision, de culture, de tendresse et d’humour et seront bien plus représentatifs de la mission qu’il s’est donnée d’être le mémorialiste de la culture homosexuelle contemporaine, celle de New York et de Paris, en particulier.
Dans ses romans, il me semble qu’il perd beaucoup à créer une fiction factice, à fabriquer ses personnages à partir de modèles réels, à tâcher de faire vivre tout ça au lieu de transcrire simplement les choses telles qu’il les a réellement perçues, ce qui fait justement la force de ses mémoires, réparties sur plusieurs livres, tous passionnants et tous indispensables pour comprendre cette période intellectuelle et sociologique.
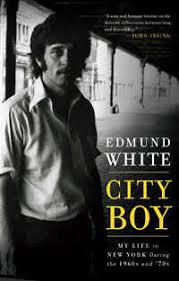
CITY BOY (2009)
Justement, pour qui veut connaître de l’intérieur le New York des années 60 et 70, le New York de la bohème littéraire et artistique gay mais pas toujours gaie, le New York du sexe, de l’alcool, des drogues de toutes sortes, de la débauche créative tous azimuts, le New York effervescent de Warhol, de Basquiat, de Susan Sontag, de Mapplethorpe, de Stonewall, de Greenwich Village et du début du disco, le New York de toute une génération de gens brillants décimés par le SIDA, impossible de ne pas lire avec délice, nostalgie et tristesse à la fois le City Boy : My Life in New York During the 1960’s and 1970’s (London : Bloomsbury, 2009), en français City Boy (Paris : Plon, 2010), les extraordinaires mémoires d’Edmund White à ce sujet.
On y retrouve tout son talent d’écrivain mémorialiste-chroniqueur-concierge et son écriture aux descriptions fidèles et cancanières à la fois, qu’il résume très bien en décrivant d’une phrase le style de toute une génération de poètes newyorkais – John Ashbery, Kenneth Koch, James Schuyler – qui « louaient leur ville avec désinvolture, en haussant les épaules, mais en termes mystérieusement précis » (« hymning the city in the same casual, shrugging, but secretly precise terms. »).
Plus loin, il évoque avec émotion et drôlerie le style de David Kalstone, universitaire, biographe et essayiste littéraire, spécialiste entre autres de la poétesse Elizabeth Bishop – « David had found a compelling middle path between gossipy narrative and academic close reading. » (« David avait trouvé un moyen terme irrésistible entre le commérage et l’étude académique poussée ») – qui s’applique parfaitement à la méthode White.
Humour proustien

Pleine d’un humour désinvolte toujours teinté d’une légère tristesse, la prose de White, son style, subtil et proustien dans ses circonvolutions, englobe parfaitement tous les détails d’une comédie humaine passée et brillante – et même clinquante sous bien des aspects – avec une causticité, voire une vacherie qui a l’art de remettre tout ce beau monde à sa juste place.
It is difficult to convey the intensity and confusion in our minds back then in the sixties and early seventies as we tried to reconcile two incompatible tendencies – a dandified belief in the avant-garde with a utopian New Left dedication to social justice (…) What was shared by these two doctrines – the continuing (and endless) avant-garde and radical politics – was an opposition to the society around us, which we judged to be both philistine and selfish.
(Ma traduction)
« Il est difficile de transmettre toute l’intensité et toute la confusion des esprits de ces années soixante, début des années soixante-dix, où l’on essayait de réconcilier deux tendances incompatibles – une foi snobinarde dans l’avant-garde et un engagement utopique Nouvelle Gauche pour la justice sociale (…) Ce que ces deux doctrines exprimaient – la continuelle (et incessante) avant-garde et la radicalité –, c’était une prise de position contre la société dans laquelle nous vivions, que nous jugions à la fois béotienne et égoïste. »

Rastignac à New York
White, à travers sa propre expérience, transcrit bien, avec sévérité et bienveillance, toutes les aspirations, naïves quelquefois, du jeune homme ambitieux et lettré qu’il était alors, sorte de Rastignac se faisant son chemin à New York, gravissant les échelons culturels, entrant dans les cercles littéraires dans l’espoir, un jour, d’en faire partie :
As in so many situations in those days, I was the youngest and least well-known person at the the table, not silent but certainly mostly a listener. I longed for literary celebrity even as I saw with my own eyes how little happiness it brought. For me, I suppose, fame was a club one yearned to join, obsessing over it night and day until the moment one was admitted, and after that never thought about again. But with one difference: literary fame, unlike club membership, was something you could lose as quickly as you gained. Now, in my nearly half century of being “on the scene”, I’ve witnesssed so many reputation come and go. Who remembers William Goyen (though his House of Breath is still popular in France)? Or By Love Possessed, the former “literary bestseller” by James Gould Cozzens? Don Marquis and his beloved Archy and Mehitabel?
(Ma traduction)
« Comme souvent à cette époque, j’étais le plus jeune et le moins connu à la table, pas silencieux mais plutôt auditeur. Je rêvais d’une gloire littéraire alors même que je pouvais observer avec mes propres yeux le peu de bonheur que ça procurait. Pour moi, j’imagine que la célébrité était comme un club dans lequel il fallait absolument entrer, une obsession de chaque instant jusqu’à ce qu’on y soit admis, qu’on oubliait une fois qu’on en faisait partie. Avec une différence, toutefois : la gloire littéraire, au contraire d’une carte de membre d’un club, pouvait se perdre aussi rapidement qu’on l’avait obtenue. Aujourd’hui, à près de cinquante ans de présence « dans le milieu », j’ai vu tant de réputations naître et disparaître. Qui se rappelle de William Goyen (même si son House of Breath est encore très connu en France) ? Ou de By Love Possessed, le « bestseller littéraire » de James Gould Cozzens ? De Don Marquis et son adulé Archy and Mehitabel ? »
James Merrill, le Dante de New York

Du monde littéraire de cette époque, j’ai beaucoup aimé son portrait du célèbre poète James Merrill, auteur de The Changing Light at Sandover, qui se voulait rien de moins qu’une réponse à la Divine comédie de Dante :
Whereas Dante wrote mostly about historical figures, Merrill lent a mythical dimension to his own friends, many of them otherwise unknown. This strategy of elevating one’s own experience had become more and more common since the collapse of a widely shared general culture (Proust is the star example of this new manner). Whereas Dante claimed he’s actually travelled into the afterlife and observed everything firsthand, Merrill communicated with his dead through the Ouija board, which all felt to me amateurish and “fun”, the Delphic oracle reduced to a parlor game.
(Ma traduction)
« Alors que Dante a surtout écrit sur des personnages historiques, Merrill a donné une dimension mythique à ses propres amis, la plupart inconnus par ailleurs. Cette stratégie de mettre en avant sa propre expérience était devenue de plus en plus commune depuis la disparition d’une culture générale partagée de tous (Proust en est l’exemple le plus célèbre). Là où Dante affirme qu’il a vraiment voyagé dans l’au-delà et qu’il a tout observé par lui-même, Merrill communiquait avec ses morts à travers une planche de Ouija, ce qui me semblait terriblement amateur et « sympa », l’oracle de Delphes devenant un jeu de société. »
Vladimir Nabokov : peut mieux faire !
Impossible non plus, de ne pas s’amuser à son évocation de Vladimir Nabokov, avec qui White, qui travaillait alors à la Saturday Review de San Francisco, a eu l’occasion de collaborer sur un projet :
He was my favourite living writer along with Christopher Isherwood. Different as Nabokov and Isherwood were from each other, both inspired me with a respect bordering on reverence and an excited anticipation for each new title. Nabokov was funny and wicked, baroque and heterosexual; Isherwood was sober and good and classical and gay.
(Ma traduction)

« C’était mon écrivain vivant préféré avec Christopher Isherwood. Bien que différents l’un de l’autre, les deux m’inspiraient un respect à la limite de l’idolâtrie et une attente fébrile pour chaque nouvelle parution. Nabokov était drôle et méchant, baroque et hétérosexuel ; Isherwood était sobre et gentil et classique et gay. »
On apprend non seulement que Nabokov parlait l’anglais avec un accent pour le moins mélangé – « His a’swere long and English, his r’s rolled and Russian, his accent more French than anything else, at least to my untrained ears », « ses a étaient longs et anglais, ses r étaient roulés et russes, son accent plutôt français, du moins pour mes oreilles profanes » – mais qu’en plus son anglais écrit n’était pas parfait non plus, au grand embarras de White, forcé de réviser le texte :
Nabokov’s mini-essay had minor mistakes in punctuation and even in diction. How did one edit Nabokov? My solution was to have the essay set exactly as he’d written it, mistakes and all, then to reset it in my corrected version. I messengered both versions to him with a short but polite letter explaining what I’d done. He wired back YOUR VERSION PERFECT.
(Ma traduction)
« Le court texte de Nabokov contenait quelques petites fautes de ponctuation et même de diction. Comment est-ce qu’on corrige Nabokov ? Ma solution a été de garder le texte exactement comme il l’avait écrit, fautes comprises et de le reprendre dans une version corrigée par ma main. Je lui fis parvenir les deux versions accompagnée d’une courte note d’explication. VOTRE VERSION PARFAITE me télégraphia-t-il en retour. »
Borges et ses caleçons
Enfin, comment ne pas s’amuser à l’évocation de Borges, invité à New York pour donner une conférence :
He and his companion Maria Kodama (later his wife), had to fly first-class, of course, from Buenos Aires, and we arranged for them to stay in a beautiful NYU apartment looking down on Washington Square. The only drawback was lack of room service. Maria Kodama called me on a Sunday afternoon and asked: “who will wash out Borges’s underthings?” I thought to volunteer my own services but I was afraid of embarassing everyone. Finally I had to hire a maid at a hundred dollars an hour to go over there on sunday evening and wash out the distinguished panties.
(Ma traduction)
« Lui et sa compagne Maria Kodama (sa future épouse), devaient voyager depuis Buenos Aires en première classe, naturellement, et on s’était arrangé pour qu’ils séjournent dans un magnifique appartement de l’Université de New York avec vue sur Washington Square. Le seul problème, c’était l’absence de service de maison. Maria Kodama m’appela un dimanche après-midi pour me demander « qui allait laver les sous-vêtements de Borges ? » Je me serais volontiers porter volontaire mais craignait d’embarrasser tout le monde. Au final, je dus engager une femme de ménage à cent dollars l’heure pour qu’elle aille chez eux le dimanche soir pour laver les distinguées culottes. »
La littérature, c’est aussi une question de linge sale.
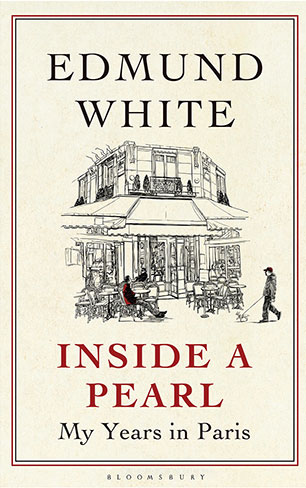
INSIDE A PEARL: MY YEARS IN PARIS (201
Ce livre délicieux, en particulier pour ceux qui font partie de l’aire culturelle française, n’a toujours pas été traduit et on se demande bien pourquoi, à moins que ce ne soit pour des questions légales, les personnes mentionnées par Edmund White, ou leurs héritiers, s’opposant peut-être à la publication du livre ?
 Il faut dire que, tout en s’amusant d’un certain regard américain sur les idiosyncrasies françaises, on y croise aussi du très beau linge et tout ce que la culture française de cette époque-là a suscité de personnalités, d’événements, de controverses : Kundera, Foucault, Defert, Guibert, Lindon, Barbedette, Bianciotti, Rinaldi, Matzneff, Hocquenghem, Kristeva, Sollers…
Il faut dire que, tout en s’amusant d’un certain regard américain sur les idiosyncrasies françaises, on y croise aussi du très beau linge et tout ce que la culture française de cette époque-là a suscité de personnalités, d’événements, de controverses : Kundera, Foucault, Defert, Guibert, Lindon, Barbedette, Bianciotti, Rinaldi, Matzneff, Hocquenghem, Kristeva, Sollers…
Cette fois c’est son long séjour dans le Paris des années 80 en tant que correspondant pour le magazine Vogue qu’Edmund White retrace dans ces nouveaux mémoires intitulés Inside A Pearl : My Years in Paris (London : Bloomsbury, 2014) qui, chronologiquement, fait suite à City Boy (Paris : Plon, 2010), ses mémoires newyorkaises des années 1960-1970.
Babar et le Tout-Paris
Il faut dire que White est entré de plain-pied dans tout ce qui comptait à Paris grâce à une amie, l’élégante Marie-Claude de Brunhoff, qui, en tant que critique littéraire pour L’Express, Le Monde et La Quinzaine Littéraire, prospectrice (« literary scout ») pour différentes maisons d’éditions et première femme du créateur de Babar, possédait un précieux carnet d’adresses, connaissait un peu tout le monde, avait ses entrées partout et parlait d’une voix enfumée qui faisait qu’au téléphone on la prenait pour Jeanne Moreau, ce qui ouvrait d’autres portes encore.
White en fait un portrait extrêmement précis, au moral comme au physique, et c’est toute une personnalité, toute une intelligence, toute une élégance, tout un charme qu’on retient, quelque chose qui ressemble beaucoup à cette grâce irrésistible qu’on perçoit dans les textes et les interviews de Louise de Vilmorin, par exemple.
Au physique:
She wasn’t tall, but she held herself as she were. She had a white ivory cigarette holder into which she screwed one cigarette after another. (…) Marie-Claude was beautiful, with big, wide-awake eyes, a low voice, layers of pale clothes that billowed around her in floating panels, shoes that were immaculate and of a startling red.
(Ma traduction)
« Elle n’était pas très grande, mais elle se tenait comme si elle l’était. Elle avait un fume-cigarette en ivoire blanc dans lequel elle vissait une cigarette après l’autre. (…) Marie-Claude était magnifique, avec de grand yeux éveillés, une voix grave, des couches de vêtements clairs qui, tels des rubans, flottaient autour d’elle, des chaussures immaculées et de couleur rouge pétant. »
Au moral:
She even had a very European way of being tired. She would say, « But we’re all terribly tired. Everyone is worn out.” It wasn’t clear if she meant that the troubled politics of recent weeks had exhausted everyone, or whether in these impoverished latter days everyone we knew had to work like coalminers to stay afloat.
(Ma traduction)
« Elle avait même une façon européenne d’être fatiguée. Elle disait, ‘ Mais on est tous terriblement fatigué. Tout le monde est éreinté.’ On ne savait pas si elle parlait de la politique un peu agitée des semaines précédentes, qui épuisait tout le monde, ou du fait qu’en cette période d’appauvrissement tous ceux que nous connaissions devaient travailler comme des ouvriers à la mine pour pouvoir surnager. »
Et classe jusqu’à la fin:
Then one year her cancer, which had started in her breasts, came back. (…) “C’est bête,” she said, “so stupid”, almost as if it was a trick in bad taste that fate had pulled on her – or did she mean it was a bêtise that she’d committed?
I visited her later in the hospital. Though her hair had gone, she’d arranged some terrific turbans out of gaudy silks and satins tied with a flourish worthy of a maharani. She was gallant to the end.
(Ma traduction):
« Et puis une année son cancer, qui avait commencé au sein, a récidivé. (…) ‘C’est bête’, elle avait dit, ‘si stupide’, comme s’il s’agissait d’un tour de magie de mauvais goût que le destin lui avait fait – ou est-ce qu’elle voulait dire que c’était une bêtise de s’être fait avoir ?
Je lui avais rendu visite à l’hôpital, plus tard. Même sans cheveu, elle s’était fait des turbans extraordinaires avec des étoffes de soie et de satin tape-à-l’œil nouées avec un art digne d’une maharani. Elle a été vaillante jusqu’au bout. »
Parlez-vous français ?
Edmund White est évidemment tout de suite confronté aux subtilités du français qu’il doit apprendre au quart de tour (il avait bluffé pour avoir son contrat chez Vogue) :
MC (Marie-Claude) had been so generous to me, inviting me to her table at least once a week, introducing me to le tout Paris, gently correcting my mistakes in French (“You go chez le dentiste, not au dentiste. You never wish someone a good evening, une bonne soirée – it sounds so vulgar. And you offer someone a drink, you don’t buy them one like you do in America.”)
(Ma traduction)
« MC (Marie-Claude) avait été si généreuse avec moi, m’invitant à sa table au moins une fois par semaine, me présentant le tout Paris, corrigeant mes erreurs de français (‘On va chez le dentiste, pas au dentiste. On ne souhaite jamais une bonne soirée à quelqu’un, ça fait vulgaire. Et on offre un verre, on ne paie pas des verres comme vous faites en Amérique.’) »
Il s’amuse à la fois de sa propre gaucherie linguistique, de l’importance que les Français accorde à leur langue, et des conventions bourgeoises :
I remember once saying la mariage and a five-year-old had corrected me, « But it’s le mariage”. Quickly, her mother, blushing, whispered to the little girl, “Don’t correct Monsieur, He’s a professor.”
(Ma traduction) :
« Je me souviens d’une foi où j’avais dit la mariage, et une petite de cinq ans m’avait corrigé, « Mais c’est le mariage ». Aussitôt, sa mère, rougissante, avait murmuré à la petite fille : « Ne corrige pas Monsieur, c’est un professeur. »
Pour pouvoir saisir plus facilement ce qu’on lui dit, il choisit ses amis, plutôt des femmes – « Les femmes, surtout celles de la bonne bourgeoisie, parlaient plus clairement que leurs équivalents mâles ou plus jeunes » – et apprend en passant toutes les tournures quelquefois très drôles pour éviter d’appeler un chat un chat :
The concierge in our building often referred to my new partner Michael as my son (« votre fiston est déjà sorti”); older gay men called their companions their “nephews.” One time I was with Bernard when he ran into a tante (queen) who said, “Do you know my nephew?
“Yes,” Bernard replied, “he was my nephew last year.”
(Ma traduction)
« Le concierge de notre immeuble parlait souvent de mon nouveau compagnon Michael comme de mon fils (« votre fiston est déjà sorti”); les gays plus agés appelaient ‘neveu’ leur compagnon plus jeune. Une fois, j’étais avec Bernard quand nous avons croisé une tante qui avait dit: ‘Est-ce que vous connaissez mon neveu?” ‘Oui,’ avait répondu Bernard, ‘l’année passée c’était le mien’. »
Des vacances… ou pas
Au début, White, dans son mélange nuancé d’introspection, d’honnêteté intellectuelle, d’opportunisme et d’ambivalence, s’interroge sur ses motivations réelles pour ce séjour parisien :
Sure, I’d won a Guggenheim and a small but regular contract with Vogue to write once month on cultural life. Right now, I was writing a piece about why Americans liked Proust so much. Back in America I’d worked around the clock heading the New York Institute for the Humanities and teaching writing at Columbia and New York University. I never seemed to have time for my own writing. When I was president of Gay Men’s Health Crisis, the biggest and oldest AIDS organization in the world, I hadn’t liked myself in the role of leader; I was power mad and tyrannical, much to my surprise, always ordering people to shut up and vote. And secretly I’d wanted the party to go on and thought that moving to Europe would give me a new lease on promiscuity. Paris was meant to be an AIDS holiday. After all, I was of the Stonewall generation, equating sexual freedom with freedom itself. But by 1984 many gay guys I knew were dying in Paris as well – there was no escaping the disease.
(Ma traduction):
« Bien sûr, j’avais obtenu une bourse Guggenheim et un petit contrat fixe avec Vogue pour un article mensuel sur la vie culturelle. En ce moment, j’écrivais un texte sur les raisons pour lesquelles les Américains appréciaient autant Proust. Aux États-Unis, j’avais travaillé comme un fou en tant que responsable du New York Institute for the Humanities et j’enseignais l’écriture à l’Université de Columbia et à celle de New York. Je ne trouvais pas de temps pour écrire. Quand j’étais président de la Gay Men’s Health Crisis, la plus grande et la plus ancienne des organisations anti-SIDA, je ne me sentais pas à l’aise dans ce rôle de leader, à ma grande surprise, j’étais devenu autoritaire et tyrannique, je leur intimais l’ordre de la boucler et de voter. Et, secrètement, je voulais continuer la fête et pensais qu’un séjour en Europe me donnerait une rallonge dans la débauche. Paris, ce devait être des vacances loin du SIDA. Après tout, j’étais de la génération Stonewall, pour qui la liberté sexuelle, c’était la liberté tout court. Mais dès 1984 de nombreux gays de mes connaissances étaient en train de mourir à Paris, aussi – impossible d’échapper à la maladie. »
Michel Foucault

Edmund White fait un très beau et très touchant portrait de Michel Foucault, qu’il avait déjà eu l’occasion de connaître au New York Institute for the Humanities où le philosophe était venu accompagner son compagnon Daniel Defert invité pour un séminaire :
Foucault spoke English through an act of will – I don’t think he’d ever studied it and he wasn’t worried by his very strong accent. I thought anyone as smart as he would of course speak English – or any other language he set his mind to. He was surrounded with beautiful ephebes such as Hervé Guibert, Mathieu Lindon, and Gilles Barbedette, but sexually his type was burly and macho. But he never thought the sexual identity of someone was all that revealing, and as his disciple I mustn’t pretend I’m saying something profound about him by talking about his kinkiness. He was both fiery and sweet, a rare combination of traits. He showed me that you can be passionately aggressive about advancing your views, arguing your position, but in the bosom of your friends mild and even humble, certainly sweet. (…) Toward the end of his life, Foucault thought the basis of morality after the death of God might be the ancient Greek aspiration to leave your life as a beautiful, burnished artifact. Certainly in his case his gift for friendship, his quick sympathy, his gift for paradox, his ability to admire left his image as a man, as en exemplary life, highly burnished. The people who said his promiscuity or his death from AIDS diminished him were just fools.
(Ma traduction)
« Foucault parlait l’anglais par un acte de pure volonté – je crois qu’il ne l’avait jamais étudié et son fort accent n’était pas un sujet de préoccupation. Je pensais que quelqu’un d’aussi malin que lui parlerait forcément l’anglais – ou n’importe quelle autre langue s’il s’y mettait. Il était entouré de superbes éphèbes tels Hervé Guibert, Mathieu Lindon et Gilles Barbedette, pourtant d’un point de vue sexuel, sa préférence allait aux baraqués et aux machos. Mais il a toujours pensé que l’identité sexuelle n’était pas si significative que ça, et, en tant que disciple, je ne pense pas affirmer quelque chose de profond en parlant de ses préférences. Il était à la fois fougueux et tendre, une combinaison rare. Il m’avait démontré qu’on pouvait être passionnément agressif pour défendre ses opinions, ou pour affirmer une position, mais qu’auprès de ses amis on pouvait être réservé, et même humble, et vraiment doux. (…) Vers la fin de sa vie, Foucault pensait qu’après la disparition de Dieu, la base de la morale pourrait bien être l’aspiration des Grecs antiques à se dépouiller de sa vie comme on le ferait d’un magnifique outil usé jusqu’à la corde. En ce qui le concerne, c’est sûr que son dévouement pour l’amitié, son empathie, son don du paradoxe, sa capacité à admirer laisse l’image d’un homme qui est allé jusqu’au bout et d’une vie exemplaire pleinement vécue. Les gens qui ont affirmé que la débauche ou sa mort par le SIDA l’avaient diminué n’ont rien compris. »
Les années SIDA
C’est qu’on est au tout début de l’épidémie du SIDA qui emportera Foucault quelques années plus tard. Lors d’une nouvelle rencontre à Paris, White évoque le sujet lors d’une conversation :
Michel Foucault, for one, had welcomed me warmly during a brief visit in 1981, but he and Gilles Barbedette, a mutual friend and one of my first translators, had both laughed when I told them about this mysterious new disease that was killing gay men and blacks and addicts. “Oh no,” they said, “you’re so gullible. A disease that only kills gays and blacks and drug addicts? Why not child molesters, too? That’s too perfect !” They both died of AIDS, Foucault first, then Barbedette, I helped Foucault’s surviving partner, Daniel Defert, start up the French AIDS organization AIDES.
(Ma traduction)
« Michel Foucault, le premier, m’avait chaleureusement accueilli pendant une courte visite en 1981, mais lui et Gilles Berbedette, un ami commun et un de mes premiers traducteurs, avaient éclaté de rire quand je leur avais parlé de cette maladie mystérieuse qui tuait les gays, les Noirs et les drogués. « Oh non », ils me disaient, « tu es trop crédule. Une maladie qui ne tue que les gays, les Noirs et les drogués ? Pourquoi pas les pédophiles pendant qu’on y est ? C’est trop parfait ! » Les deux sont morts du SIDA, d’abord Foucault, puis Barbedette. J’ai aidé Daniel Defert, le compagnon de Foucault, à mettre sur pied AIDES, la version française d’AIDS. »
À ce propos, la description par Edmund White, lui-même séropositif, de son compagnon Herbert en phase terminale de SIDA, avec qui, sur sa demande, White fait un dernier voyage à Agadir où il mourra dans un hôpital de fortune, est un des passages les plus touchants et les plus poignants du livre.
Incapable de supporter la dureté d’un quelconque vêtement, Herbert ne porte plus que des djellabas. Il ne retient plus sa nourriture, vomit partout, et somnole la majeure partie du temps. Les deux se retrouvent à parcourir le désert en voiture dans une fuite en avant voulue par le mourant, dont le corps sera rapatrié plus tard, laissant White dans un choc, une souffrance et un désarroi terrible dont il mettra beaucoup de temps à se remettre.
Le Gay Tout-Paris (Bianciotti, Rinaldi, Matzneff, Hocquenghem, Schérer…)
Inside A Pearl évoque évidemment toute l’intelligentsia gay parisienne de l’époque, et notamment l’écrivain argentin Hector Bianciotti et le redoutable critique littéraire Angelo Rinaldi :
Hector had begun to write in French, not Spanish, a few years previously. People said he was helped by his lover Angelo Rinaldi, a Corsican novelist and the extremely acerbic critic for L’Express. (…) I would often see Angelo, always grimacing, each time his hair a color never encountered in nature, headed to his chambre d’assignation on the Île Saint-Lois, usually in the company of a teenager he’d met at a gym during wrestling practice.
(Ma traduction)
« Quelques années auparavant, Hector avait commencé à écrire en français, pas en espagnol. Les gens disaient qu’il était aidé par son amant, Angelo Rinaldi, un romancier corse, et critique mordant pour L’Express. (…) Je voyais souvent Angelo, toujours grimaçant, avec à chaque fois une couleur de cheveux impossible à trouver dans la nature, se dirigeant à sa chambre d’assignation à l’Île Saint-Louis, accompagné, en général, par un adolescent qu’il avait rencontré à la gym, pendant l’entrainement de lutte libre. »
On y évoque aussi Gabriel Matzneff :
Matzneff came from a White Russian family and started riding horses at age ten. He majored in classics and studied philosophy with Gilles Deleuze and Vladimir Jankélévitch. He became close to President Mitterrand, who wrote an article testifying to their friendship (imagine Bush or even Obama bearing witness to a friendship with an artist, much less a notorious pedophile).
(Ma traduction)
« Mazneff venait d’une famille de Russes Blancs et avait commencé l’équitation à dix ans. Il avait fait ses humanités et avait étudié la philosophie avec Gilles Deleuze et Vladimir Jankélévitch. Il était devenu proche du Président Mitterrand, qui avait écrit un article sur leur amitié (imaginez Bush ou même Obama témoignant de leur amitié pour un artiste, et un pédophile notoire qui plus est). »
… et Guy Hocquenghem:
Hocquenghem was usually with René Schérer, his high school philosophy teacher whom he’d started having an affaire with when he was sixteen and Schérer was in his forties. Twenty years later, they were still close friends and they somewhat programmatically called themselves lovers. Schérer was yet another apologist for pedophilia. He was the younger brother of the filmmaker Éric Rohmer.
(Ma traduction)
« Hocquenghem était en général en compagnie de René Schérer, son professeur de philosophie au lycée, avec qui il avait eu une histoire d’amour quand il avait seize ans alors que Schérer en avait dans les quarante et des poussières. Vingt ans plus tard, ils étaient encore proches et ils se définissaient, un peu de manière militante, comme des amants. Schérer était un autre apôtre de la pédophilie. C’était le frère cadet du cinéaste Éric Rohmer. »
Houellebecq ou le camping dans l’évolution des mœurs
En observateur des mœurs, Edmund White relève certaines particularités françaises et leur impact sociologique et sexuel :
I’ve always suspected these French campings were witness to the hottest teenage sex in the country. While the parents from France and Germany and Holland reclined in plastic and aluminum chairs or cooked wieners on the portable grill, the adolescent girls and boys ran off together, excited by a sudden lack of supervision and the randy exoticism of all this freedom and all these nationalities. In fact, the now middle-aged novelist Michel Houellebecq, author most famously of The Elementary Particles (Les Particules élémentaires), and the great white hope of the French novel, has explored in the bitterest terms the laxity of his parents’ generation – the soixante-huitards (sixty-eighters), with their sun-battered faces, receding hairlines, and gray ponytails (whose tents and trailers you see in campings all over France) – and he blames them for the moral fecklessness of his own generation. As Houellebecq recounts it, the campings were notorious wifes-swapping (échangiste) venues – and at least as he’d like to tell it, the reason for so many divorces and fractured families and fucked-up offspring in France.
(Ma traduction)
« J’ai toujours pensé que ces campings français devaient être le terrain parfait et torride pour la vie sexuelle des adolescents. Pendant que les parents originaires de France, d’Allemagne, de Hollande se vautraient dans des chaises de plastique et d’aluminium, ou faisaient griller des saucisses sur un grill portable, les ados filles et garçons partaient ensemble, excités par cette soudaine absence de surveillance et par l’exotisme lubrique de cette liberté et de toutes ces nationalités. D’ailleurs Michel Houellebecq, le romancier aujourd’hui cinquantenaire, auteur célèbre de Les Particules élémentaires, et grand espoir blanc du roman à la française, a exploré en termes les plus amers le laxisme de la génération de ses parents – le soixante-huitard, visage marqué par le soleil, calvitie avancée, queue-de-cheval grise (celui dont on voit les tentes et les caravanes dans les campings partout en France) – et il lui met sur le dos la mentalité irresponsable de sa propre génération. Vus par Houellebecq, les campings étaient des lieux notoires d’échangisme – et, selon son point de vue, une des causes de nombreux divorces, de familles en lambeau et d’une génération suivante complètement larguée. »
Julia Kristeva et Philippe Sollers
On aimera aussi les quelques coups de griffes bien sentis – et magnifiquement exprimés – d’Edmund White, qui, dans sa veine comparatiste entre les États-Unis et la France, évoque aussi le féminisme à densité variable de Julia Kristeva, qu’il a eu l’occasion de rencontrer à l’Île de Ré :
She wore big barbaric jewelry and designer clothes and was a feminist only in America, at Columbia, where she often taught. In France, she was way beyond anything so primitive as feminism (too seventies) !
(Ma traduction)
« Elle portait de gros bijoux primitifs et des habits de marque et n’était féministe qu’en Amérique, à l’Université de Columbia. En France, elle était bien au-dessus de quelque chose d’aussi primitif que le féminisme (trop seventies) ! »

Quant à son mari Philippe Sollers, dont White relève la suffisance toute française à propos de tout et de rien, mais en particulier au sujet de Jean Genet (White est l’auteur d’un Jean Genet (1983) devenu une référence) –, il n’allait pas laisser passer la chose :
When Genet’s The Balcony was presented at the Odéon, he participated in a colloque. Sollers’s stance was that he alone had actually read Genet and that everyone else was talking through his or her hat (I’d heard him adopt a similar strategy about Céline and Sade). If anyone dared to challenge him, he drew on his cigarette and exhaled a cloud of smoke, smiling all the while a big, mocking smile.
(Ma traduction)

« Quand Le Balcon de Genet a été présenté à l’Odéon, il participait à un colloque. La position de Sollers c’était que lui seul avait vraiment lu Genet et que tous les autres disaient n’importe quoi (je l’avais vu adopter la même stratégie au sujet de Céline et de Sade). Si quiconque s’avisait de le contredire, il tirait sur sa cigarette et exhalait un nuage de fumée avec un grand sourire ironique. »
©Sergio Belluz, le journal vagabond (2019)

Je suis français et vit depuis 13 ans dans l’archipel du Cap Vert sur l’Ile de SANTO ANTÃO.
J’e viens d’avoir 72 ans et suis un passionné de lectures telles que André GIDE, Jean GENET, Yukio MISHIMA.,Bernard TREMBLAY, Armistead MAUPIN, et bien d’autres que j’ai ramenés de France dans des malles.
Je découvre en ce moment Edmund WHITE, j’ai terminé “Un jeune américain” et suis entrain de terminer “La symphonie des adieux”, et ensuite d’autres comme “Un cœur écorché”, etc..je suis entrain d’écrire mon autobiographie et voudrais joindre cet incroyable et fantastique écrivain qu’est Edmund WHITE, pouvez-vous me dire comment je peux le contacter pour qu’il me donne son avis sur mes écrits.
Merci d’avance
Joēl BEAUDAN
Cher Joël Beaudan, merci pour votre message intéressant. Quant à vous transmettre les coordonnées d’Edmund White, dont nous vous recommandons aussi la très bonne évocation biographique de Rimbaud, parue chez Rivages (Payot), nous ne saurions le faire faute de les connaître, mais ses éditeurs parisiens le pourront sans doute, auxquels nous vous renvoyons. Si vous avez des textes à publier à l’occasion, sachez que nous sommes volontiers preneurs. Avec nos cordialités. Le Passe-Muraille