Un sujet bien singulier



À propos de l’oeuvre en cours d’Antonin Moeri,
par Alain Bagnoud
En 1986,Antonin Moeri a remporté le Prix littéraire de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la revue [vwa]. Son Journal fiaction (1) y faisait figure de révélation. On y découvrait une voix nouvelle, sûre, originale, personnelle, bien loin des balbutiements de quelques autres débuts.
Antonin Moeri répète volontiers que ses trois premiers romans constituent une trilogie. On y trouve effectivement une unité de ton et de thèmes. Il s’agit en quelque sorte d’une suite familiale. Le même narrateur se confie, dans un monologue teinté d’oralité, tente de se définir au milieu d’un monde insaisissable, analyse ses relations avec ses proches, épingle en passant les ridicules et les bassesses avec un humour impitoyable. Pour simplifier à outrance, Le fils à maman parle d’une mère, figure centrale autour de laquelle gravitent un père, un frère et une maîtresse, L’île intérieure traite la figure d’une sœur, Les yeux safran enfin raconte l’agonie de la mère, qui termine la trilogie. Sa cohésion n’est d’ailleurs pas seulement thématique. Elle se fait dans l’écriture et la position du narrateur, un je obstiné, qui voit passer en lui le flux de l’existence, ne parvient pas à le retenir, l’observe, passif, agi, et ne trouve un sens à sa vie que dans l’écriture, la promenade et le chant de la phrase.
A partir de ce noyau, fondement de l’œuvre, on peut comprendre les livres suivants de Moeri comme une tentative de renouvellement. Allegro amoroso (L’Age d’Homme 1993) est une suite de textes courts, qu’on peut si on veut appeler des nouvelles. Moeri y fait la preuve que la concision lui va bien. On y retrouve un narrateur qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de la trilogie (et, il faut l’avouer, qui n’est pas sans points communs avec l’auteur). Ce promeneur solitaire se perd dans des lieux périphériques, évoque des ambiances et des personnages en se servant d’une langue musicale qui est une réussite parfaite.
Les deux romans suivants, les derniers que notre écrivain a publiés jusqu’à aujourd’hui, tentent une ouverture vers d’autres voies.
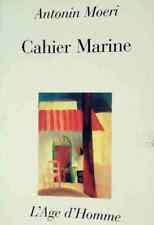
Cahier Marine (L’Age d’Homme, 1995) plonge dans le passé d’un ancien acteur et dans la passion qu’il a eue pour une actrice, femme éclatante et bizarre, qui aime les aventures sordides proches du viol. Cahier marine raconte leur voyage vers le sud, voyage sentimental qui se transforme au fil des jours en voyage initiatique sur l’amour et la séparation. Ce livre est thématiquement plus lâche que les premiers, mais trouve sa force dans la folie à peine suggérée qui pousse le narrateur désespéré toujours plus loin.
Igor, enfin (Bernard Campiche, 1998), tente le passage à la troisième personne et cherche à se créer en entité plus proprement romanesque, en même temps que, selon les confidences de l’auteur, il exprime son côté slave. Des repères romanesques plus précis que dans les textes précédents sont en effet placés ici et là. Des lieux, des personnages, des bribes d’histoire. Moeri a également recours, pour la première fois dans un long texte, à un personnage principal qui tente de se démarquer du narrateur. Le livre se tient cependant dans une continuité moerienne. On y retrouve le goût des observations précises, le rythme personnel de la phrase, et l’absence d’intrigue montre qu’il s’agit, plus que d’un roman proprement dit, d’un long monologue intérieur, parfois passablement déconcertant. «Sans doute Antonin Moeri, en faisant trébucher ainsi son lecteur, veut-il lui donner à éprouver activement, à fleur de texte, pour ainsi dire, la quête d’identité que son incertain personnage – «un homme (mettons qu’il s’appelle Igor)» – poursuit en remontant vers ses souvenirs d’enfance», écrit ainsi de ce texte une autorité sûre, Jean Kaempfer, professeur à l’Université de Lausanne, grand esprit, lecteur attentif et rigoureux.(2)
Et maintenant, une vue générale. Kundera, dans L’art du roman (Folio, 1986, pp. 176-177), fait une distinction entre romancier («… un découvreur qui, en tâtonnant, s’efforce à dévoiler un aspect in-connu de l’existence. Il n’est pas fasciné par sa voix mais par une forme qu’il poursuit…») et l’écrivain («L’écrivain a des idées originales et une voix inimitables. Il peut se servir de n’importe quelle forme (roman compris) et tout ce qu’il écrit, étant marqué par sa pensée, porté par sa voix, fait partie de son œuvre»).
Si l’on se sert de cette différenciation, on peut dire que Moeri est un écrivain. Un pur écrivain. Il voit le monde à travers sa subjectivité affirmée, revendiquée. Son moi est une lentille déformante braquée sur l’univers. C’est elle qui a de l’importance, plus que le spectacle vu. Quel que soit le narrateur qu’il utilise, celui-ci accorde plus de valeur à ses sensations, à ses observations qu’au sens du monde qui l’entoure, qu’il voit par fragments discontinus, parfois irréels.
C’est vrai pour les anecdotes qu’il observe. C’est vrai aussi pour les personnages qu’il croise. Ceux-ci sont souvent de simples silhouettes, ont peu de densité, n’importent que par rapport à ce narrateur, à ce qu’ils lui transmettent.

Toute l’œuvre de Moeri est ainsi fondée sur une présence au monde forte, individualisée, mais passive. Ses héros subissent ce qui leur advient et trouvent leur revanche dans l’examen des émotions et la description des faits, qui peut aller d’une froideur exempte de sentimentalisme à la satire la plus drôle. Il est ainsi symptomatique que leur grande action, c’est la promenade, qui fait changer de lieux, suscite des impressions, permet de recueillir des scènes et des anecdotes.
Cette démarche a ses dangers. Le lecteur peut se retrouver face à un texte éclaté, à une suite de scènes discontinues, vaguement répétitives, qui minent la cohérence interne du livre, gênantes comme des branches qui empêchent d’avancer et qu’on a l’envie d’écarter. Il peut aussi se trouver confronté à un moi tellement considérable qu’il ne rayonne plus que d’un narcissisme complaisant ou s’assoit en posture d’écrivain.
Les textes les plus réussis de Moeri, là où naît l’œuvre d’art, sont ceux qui opèrent un équilibre parfait entre ces deux pôles. Une fusion se fait entre repères romanesques, observations, notations quotidiennes, anecdotes autobiographiques. Tous les éléments du texte s’amalgament en structure du moi narratorial, exprimés dans une langue souple et musicale.
C’est ainsi que Mœri a une des écritures qui ont à dire aujourd’hui: un personnage sans importance collective parvient à surmonter son angoisse des origines en produisant un monologue tantôt dé-taché, tantôt grinçant, tantôt lyri-que. Un personnage qui pourrait dire, comme Schopenhauer, un des maîtres de Moeri: «Le monde est ma représentation.»
A. B.
1 [vwa], numéro 8, hiver 1986/1987.
2 Un numéro de la revue [vwa], d’ailleurs, a été consacré à ce travail: Avec Philippe Renaud, N° 22, été 1996.
3 Jean Kaempfer, Igor, héros sans qualités, «Le Temps »
(Le Passe-Muraille, No 38, Octobre 1998)
