Un sage à la douce dinguerie
À propos de Ravelstein, de Saul Bellow, et de son irrésistible portrait d’Allan Bloom,
par JLK
Saul Bellow a failli passer l’arme à gauche, comme on dit familièrement, et l’expression convient à un livre aussi libre et désinvolte en apparence qu’il est lesté de longue expérience et de souriante gravité, arraché in extremis à la bonne vie grâce, d’abord, à la jeune femme charmante qui a remplacé dans l’intimité de Bellow une beauté sans coeur, mais aussi grâce à l’art des médecins doublement sollicité par un empoisonnement alimentaire et un arrêt cardiaque.
Or, comme rien n’est jamais perdu pour un écrivain vivant, son incursion sur les bords du Styx, ou plus prosaïquement son séjour aux soins intensifs dont il était supposé sortir les pieds devant par à peu près tout le monde, nous vaut, en fin de volume, un récit très suggestif de ce voyage « à la limite ». C’est l’occasion en outre, pour le romancier octogénaire, de vriller un clin d’oeil à son ami Ravelstein un peu trop sûr du fait qu’il le suivrait dans le tombeau… fissa!

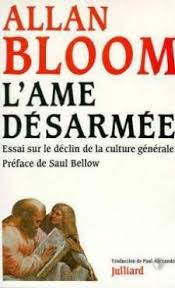
Ne cherchez pas midi à quatorze heures : le vrai nom de Ravelstein est Allan Bloom. Nulle part ce n’est précisé dans le livre, mais la rumeur, frottée de polémique idiote, l’avait annoncé bien avant que ne nous parvienne la version française du dernier livre de Saul Bellow : que celui-ci y faisait un portrait de son ami Allan Bloom, auteur du très fameux essai L’Ame désarmée (Julliard, 1987), et qu’il y révélait (motif de la chicane imbécile) les préférences sexuelles homophiles du grand prof décédé du sida en 1992.
C’est à Saul Bellow, qui le préfaça d’ailleurs, que Bloom devait l’idée de son essai, qu’il écrivit sans imaginer que ses thèses et synthèses feraient le tour du monde et lui permettraient, d’un jour à l’autre, de s’adonner à ses goûts de luxe en matière d’installations stéréophoniques (rien de trop chic pour écouter de la musique baroque sur instruments d’époque), de vêtements griffés et de voitures allemandes, entre autres collections de gravures et de beaux objets.
Au début du roman (puisque cela joue à en être un), Ravelstein et son ami Chick sont à Paris, au Crillon, amusés par la présence de Michael Jackson et sa suite, mais ces dehors de luxe, ou d’éventuelles mondanités, n’ont aucune espèce d’importance dans cette histoire qui est essentiellement d’amitié et de passions parallèles, où deux amis dotés d’intelligences supérieures, mais non confinées dans leurs sphères, se confrontent ensemble au monde en général et à leurs préoccupations personnelles en particulier. Dès les premières pages, nous savons que Ravelstein-Bloom désire que Chick-Saul lui tire son portrait dans un livre, manifestement persuadé qu’il ne saurait y avoir pour l’écrivain de plus beau sujet.
Comme on pouvait s’y attendre de la part de Bellow, le monument en question ne tiendra ni du buste académique ni de l’hommage convenu à l’éminent professeur de philosophie politique ou à l’humaniste oscillant entre Athènes et Jérusalem — c’est d’ailleurs à peine s’il revient sur les thèses de L’Ame désarmée.
Non : c’est dans la vie que puise et brasse le romancier, durant leurs dernières années de voisinage à Chicago, dans le compagnonnage affectueux et réservé (ils se voussoient) de deux hommes dont rien ne laisse à penser qu’ils sont célèbres (Bellow a quand même un Prix Nobel à son actif, et Bloom s’est fait tapoter l’épaule par Madame Thatcher…), dans la tension dramatique soudainement accentuée de la maladie, à laquelle Ravelstein oppose un surcroît de pétulance dialectique, puis dans la séparation et l’absence, enfin dans l’accomplissement de ce livre promis.
« J’ai encore merdé », remarque Ravelstein quand il constate qu’il vient de répandre un peu de son espresso serré sur la veste Lanvin à 24 000 francs dont il a fait l’acquisition le matin même. C’est qu’une conversation ne peut se faire sans force gestes, que Bloom a les mêmes maladresses qu’on imagine à Falstaff (il choquera le pauvre T. S. Eliot, le regardant «avec horreur » boire un Coca «à la bouteille »), que l’Eros ne supporte ni chichi (il déteste le genre folle autant que l’ostentation style coming out) ni mesquine retenue, enfin Saul Bellow le résume en une image le ramenant à sa chère Antiquité : «Cet homme d’idiosyncrasies et de travers, d’une avidité gloutonne de sucreries et de havanes interdits, constituait lui-même un prodige homérique…»
JLK
Saul Bellow. Ravelstein. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Rémy Lambrechts. Gallimard, coll. Du monde entier, Paris, 2002. 265 pages.
(Le Passe-Muraille, No 52, Mars 2002)


