Un maître de l’érudition joyeuse
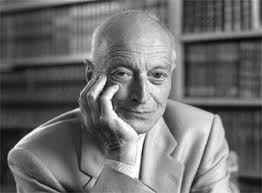
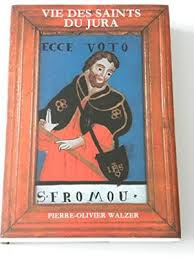
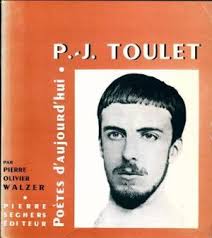
Un entretien de 1994 avec l’incomparable Pierre-Olivier Walzer (1915-2000 ), passeur de littérature à la générosité sans pareille, ami de Cendrars et de Cingria, entre tant d’autres, grand professeur snobé par les cuistres du pouvoir universitaire et médiatique – serviteur humble et jovial des Lettres dont tant se servent de tabouret,
par JLK
Une littérature ne vit pas que de ses romanciers et de ses poètes. Un préjugé contemporain veut que seuls la fiction ou le lyrisme relèvent de la «création», accordant par exemple plus de prestige à un romancier de pacotille qu’à un essayiste de premier ordre. Ainsi, dans la littérature romande, un Pierre-Olivier Walzer, de même qu’un Alfred Berchtold, est-il rarement cité au nombre des écrivains, même s’il a plus écrit (et parfois mieux) que beaucoup de ceux-là. Qu’il soit, selon la définition d’Audiberti, plutôt que de ces écrivains «qui avec une sincérité, une bonne foi, une tranquillité absolues, considèrent qu’ils sont consubstantiels au langage», un lettré de la race des écriveurs, historiens, mémorialistes ou critiques «qui emplissent les bibliothèques d’une considérable quantité d’oeuvres toutes plus parfaitement rédigées et pensées les unes que les autres», et pour qui le langage est d’abord un instrument de communication, n’ôte rien à ses mérites.

A l’approche de sa quatre-vingtième année (il est né en 1915 à Porrentruy, dans le Jura), Pierre-Olivier Walzer persiste d’ailleurs en signant deux nouveaux petits ouvrages de sagacité malicieuse qui font suite à une trentaine d’études (sur Toulet, Valéry, Renfer, notamment), essais profanes (sur Mallarmé, Lautréamont, Rimbaud, Cros, Nouveau… ou la mendicité culturelle en Helvétie) voire hagiographiques (sa réjouissante Vie des saints du Jura), guides littéraires (il a dirigé le Dictionnaires des littératures suisses) et autres travaux d’édition, des oeuvres complètes de Charles-Albert Cingria à celles de Laforgue. Professeur de littérature française pendant trente ans (de 1955 à 1985) à l’Université de Berne, fondateur de l’édition des Portes de France, co-directeur de la collection Langages à la Baconnière, Pierre-Olivier Walzer est également directeur de la collection Poche-Suisse, à L’Age d’Homme, où il réalise en somme la bibliothèque idéale de nos littératures.
— Quel est votre premier souvenir de lecture ?
— La première fois que j’ai eu le sentiment que la littérature existait, c’était à la gare de Porrentruy. J’avais dix-sept ans (je ne fus jamais bien précoce) et, intéressé obscurément par le monde des lettres, j’avais acheté le dernier numéro des Nouvelles littéraires. Il y avait là, en première page, une chronique de Suarès, très écrite, qui offrait pas mal de résistance à la lecture. Or c’est très précisément en déchiffrant cet article que je ressentis pour la première fois, au moins à ce point, tout ce que l’écriture pouvait déceler d’obscurité, de mystère et de richesse. Au fond je faisais pour mon compte cette découverte, banalisée déjà par deux écrivains que je ne connaissais pas encore, Mallarmé et Valéry, que le langage peut revêtir deux fonctions totalement différente: le chant et le vrai. De même que les jambes peuvent servir à deux choses, dira Valéry: la marche et la danse.
— Comment votre goût littéraire s’est-il affirmé ?
— Par les livres évidemment. Mais à la maison, il n’y en avait pas beaucoup. Manquait en tout cas ce qui fait la nourriture ordinaire des futurs littéraires, Balzac, Stendhal, Ronsard… En revanche, mon père avait une édition populaire des oeuvres de Daudet, dont Le petit Chose me faisait venir les larmes aux yeux, et ma mère (institutrice) possédait la précieuse petite anthologie en trois volumes de Walch, où j’appris à connaître avec délice Le vase brisé de Sully Prudhomme et le Colloque sentimental de Verlaine. Au lycée, le cours de littérature était fort sérieux; on ne sortait guère du programme et je me souviens plutôt avec ennui des heures passées sur Rousseau ou Musset. En revanche j’avais un professeur de piano passionnant, tout à fait français de culture, au courant de tout (il venait encore de passer un an à la Schola Cantorum), qui me refilait des livres auxquels, sans lui, je n’aurais eu accès que beaucoup plus tard, entre autres Claudel, Bloy, Jammes, Barbey d’Aurevilly…
— Vous vous êtes intéressé à des auteurs singuliers, tels Carco, Derème, Toulet. A quoi correspondait plus précisément ce goût ?
— C’est probablement que je me méfie des gens qui se prennent imperturbablement au sérieux. Alors j’appréciais -j’apprécie toujours – chez les poètes que vous citez la façon délicate, parfois désinvolte, qu’ils ont de mettre une sourdine aux grands sentiments. C’est ce qui m’avait amené à penser consacrer à Paris une thèse au groupe des poètes dits «fantaisistes». Mais l’on m’expliqua en Sorbonne (le cher professeur Levaillant) que tous n’étant point morts, il m’en fallait choisir un qui le fût bel et bien. Ce fut Toulet.
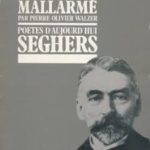
— Plus généralement, quelle forme d’esprit appréciez-vous particulièrement chez un écrivain ?Avez -vous une «famille spirituelle» de prédilection ? Quels poètes préférez-vous ? Quels héros dans la fiction ? Quelles héroïnes ?
— Je suis d’un éclectisme confondant. Quand je suis dans Voltaire (le Dictionnaire philosophique ), c’est le plus grand écrivain du monde, et si je lis les Confessions, c’est Rousseau qui est insurpassable. Je pense aimer dans un auteur les qualités et les défauts qui forment sa voix, qui font de lui un artiste singulier et unique. J’ai du goût pour tout ce qui porte l’écriture à un degré où elle est à la fois nourriture et délice, selon des normes et des techniques qui peuvent être totalement différentes. J’aime les poèmes de Valéry (Fontaine, ma fontaine...), mais aussi ceux de Prévert (Rappelle-toi, Barbara...), ce qui faisait bondir mon vieux camarade Marc Eigeldinger. Lesquels me furent particulièrement chers ? Dans le style grandes orgues, Claudel et Saint-John Perse; au clavecin, Verlaine, Toulet, Corbière. Pour les héros de la fiction, j’ai une sympathie particulière pour Monsieur Bergeret de l’Histoire contemporaine, ou le Solal de Belle du seigneur, ou le Costals des Jeunes filles. Quant aux dames, j’hésite entre l’Ellénore d’Adolphe et madame de Mortsauf dans le Lys. De toute façon je préfère les eaux dormantes aux Walkyries.

— Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Charles-Albert Cingria ? Et que la fréquentation de l’homme vous a-t-elle apporté ?
— Pendant la guerre, j’habitais Fribourg où j’assumais un enseignement au Camp universitaire polonais. J’y fréquentais assidûment la librairie de l’Université où j’avais de bons amis, comme Aloys-Jean Bataillard, le directeur littéraire des éditions Egloff, et Georges Borgeaud, le futur romancier, alors libraire. Durant toute la guerre, cette librairie fut un centre très vivant où l’on pouvait faire connaissance avec une foule de gens passionnants, le Père de Menasce, Georges Cattaui, Pierre Jean Jouve, l’abbé Journet, Roger Nordmann, le Père Duesberg, et aussi les frères Cingria, Alexandre et Charles-Albert. Ce dernier avait alors élu domicile dans une curieuse maison penchée sur le vide (maison qu’il évoque superbement dans Musiques de Fribourg), au N° 5 de la Grand’ Rue, maison habitée aussi par Bataillard et par Borgeaud. Quand Borgeaud quitta Fribourg, je pus reprendre son logement, de sorte que nous composâmes quelque temps, Bataillard, Cingria et moi, un fidèle trio qui remontait souvent le soir, après le dîner, jusqu’aux Grand’Places, dans ce temps-là herbeux terrain vague où pouvait s’ébattre en toute quiétude la petite Airedale de Bataillard, qui s’appelait Bella en souvenir de la chienne de Giraudoux. Au cours de ces déambulations, Charles-Albert parlait tout le temps, interrompu seulement de temps à autre par une interjection ironique de Bataillard, enfilant anecdote sur anecdote et racontant la suite de ses livres, dans tous les sens, avec une merveilleuse invention. Je ne savais qu’écouter béatement, alors que si j’eusse eu le bon esprit de noter ce qui tombait de cette bouche d’or (comme Max Jacob, qui s’excuse de parfois l’avoir fait), je disposérais d’assez d’histoires pour faire concurrence à Schéhérazade.

— La littérature romande existe-t-elle à vos yeux ?
— Ayant dirigé récemment la publication d’un Dictionnaire des littératures suisses, ce serait bien paradoxal de vous répondre qu’à mon avis elle n’existe pas. Je crois au contraire qu’elle existe, et même de plus en plus fortement. Qu’on l’appelle «littérature suisse d’expression française», ou plus simplement «littérature romande», elle a ses écrivains, ses éditeurs, ses (quelques) journaux, son aire de développement et de respiration (la fameuse «province qui n’en est pas une» de Ramuz), et peut par conséquent se considérer et être considérée comme une fille sevrée et même majeure de la littérature française.
— N’avez-vous jamais été tenté par l’écriture
— S’adressant à un bonhomme qui a mis son nom, comme auteur ou comme éditeur, sur une trentaine de publications, votre question pourrait paraître désobligeante. Disons que je m’efforce, dans le domaine de l’histoire, de la critique ou de l’histoire littéraire, ou même dans celui de l’hagiographie, où il m’est arrivé de m’égarer, d’atteindre à un niveau d’écriture suffisamment personnel pour que la tonalité, les qualités et les ressources de cette écriture fassent de moi au moins un commencement d’écrivain.
Propos recueillis par JLK
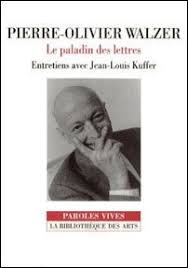
Frasques de Charles-Albert Cingria
Ce que nous savons de la la vie de Charles-Albert Cingria tient essentiellement de la chronique sporadique, épistolaire ou bien orale, souvent aussi de la légende. Sa biographie systématique ne sera pas facile à établir, mais peut-être est-ce précisément hors système qu’il faut l’envisager, ainsi que le proposent les deux premiers volumes de ces Vies de Charles-Albert Cingria où Pierre-Olivier Walzer s’attache à faire plus de lumière sur deux épisodes mouvementés de la vie de l’écrivain.

Deux «affaires» assez pittoresques, apparemment anecdotiques, mais qui n’en disent pas moins long sur certains aspects de la vie littéraire de l’époque et sur la personnalité de Charles-Albert, constituent en effet le point de départ de ces deux coruscantes études. La première s’attache aux circonstances dans lesquelles le jeune Cingria fut amené, le dimanche 19 mars 1911, sur le parvis de l’église Saint-Joseph, à Genève, à gratifier d’une volée de coups son collègue Gonzague de Reynold, relevant d’une opération des hémorroïdes et sortant du sanctuiaire au bras de son épouse légitime. Derrière cet attentat qui fit jaboter les gazetiers de l’époque: un différend opposant deux idéologies au sein de La voile latine, revue littéraire où voisinaient Ramuz et Morax, Spiess et les frères Cingria, Reynold et Robert de Traz, avec d’un côté le parti latin des Cingria très maurassiens, et de l’autre le parti helvétique de Gonzague et de Traz ouverts à la germanitude (oh !) et au protestantisme (ah!), entre autres diableries. Par delà les idées cependant, c’est à une querelle de tempéraments et de cultures que nous assistons dans la reconstitution de Walzer, ponctuée de scènes hilarantes. Ainsi de l’arrivée intempestive d’un Robert de Traz brandissant sa canne dans la maison des Cingria, et de force lettres et papiers vengeurs où les compères se traitaient mutuellement de «ver-mine» ou de «papier mâché»…
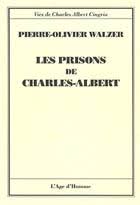
Des moeurs «politiques» de la joyeuse bande, l’on passe aux moeurs tout court de Cingria en découvrant, dans Les prisons de Charles-Albert, le détail des circonstances qui lui valurent d’être jeté, en 1926, dans la prison romaine de Regina Coeli. Surpris par la maréchaussée en train de peloter deux vauriens de douze et quinze ans sur la plage d’Ostie, emprisonné, jugé et condamné pour «corruption de mineurs et outrage à la pudeur» à sept mois de prison, Charles-Albert ne dut son élargissement prématuré qu’à l’intervention en haut lieu du même Gonzague de Reynold qu’il avait giflé quinze ans plus tôt. Dans un cas comme dans l’autre, Pierre-Olivier Walzer met bout à bout de nombreux documents fort éclairants qui, loin de nous faire juger plus sévérement l’écrivain, soulignent ses traits de caractère et sa difficulté de vivre incessamment sublimée ou édulcorée par affabulation. Il faut le voir, ainsi, transformer ses piteuses tribulations pédérastiques en affaire politique (Mussolini aurait identifié en lui quelque dangereux opposant…) pour évaluer la naïveté de sa rouerie et resituer, par la même occasion, ses occasionnelles déclarations «politiques». Or l’image du merveilleux Charles-Albert n’est aucunement entachée par les investigations de Pierre-Olivier Walzer, qui fait tranquillement la part des petites misères quotidiennes et celle du génie poétique
J.-L. K.
Pierre-Olivier Walzer, Le sabordage de La voile latine et Les prisons de Charles-Albert. L’Age d’Homme, 1993.
(Le Passe-Muraille, Nos 11-12, mars 1994)
