Swing n’blues des choses de la vie
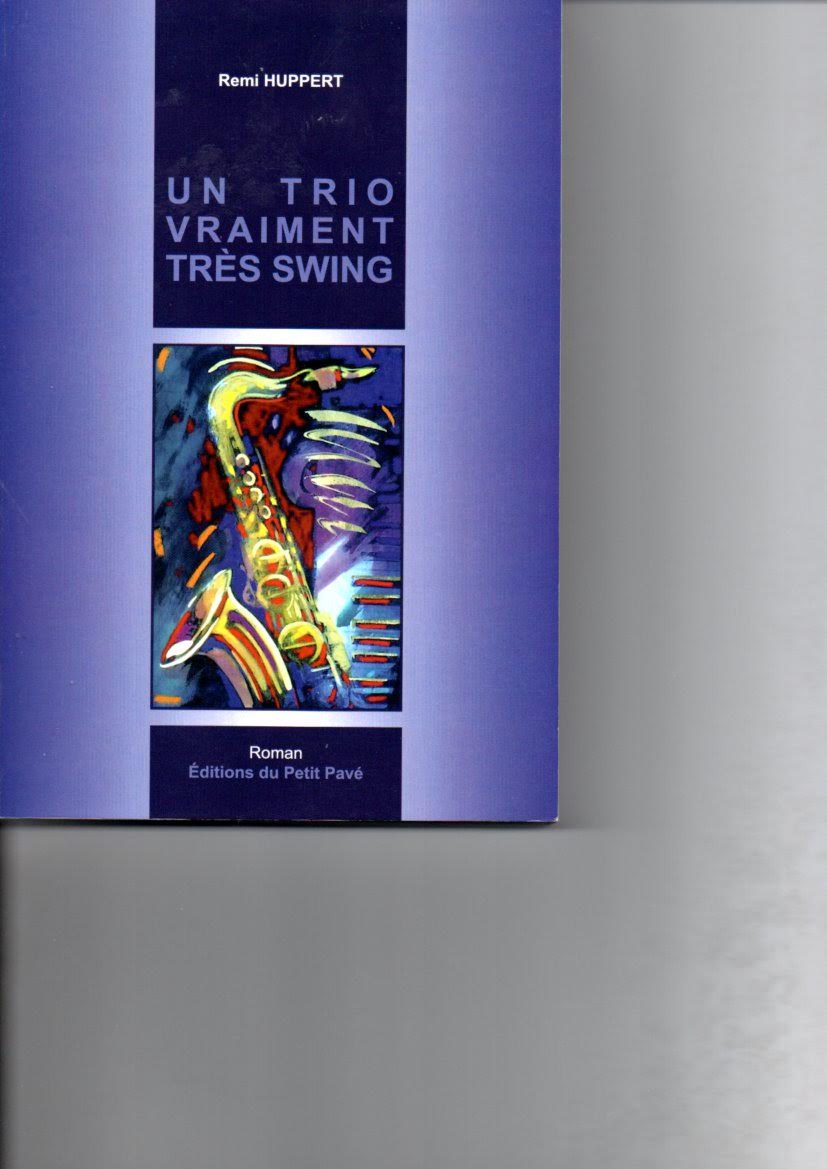
À propos d’un roman de Rémi Huppert
par Francis Vladimir
Fin des années 1960. Fil conducteur des rencontres de trois personnages, la musique annote les pages du roman de Rémi Huppert. Présence constante mêlant diversité des formations et des inspirations où le trio, mis en exergue dans le titre, remonte aux origines des vocations, aux racines de l’existence, aux soubassements de l’errance. Deux hommes et une femme. O. pianiste d’origine coréenne, originaire de Busan, port marqué par la guerre de Corée en 1950, s’embarque sur le vol, Séoul – Paris, attirée par la légende de Claude Debussy. Mêlant les temporalités tout au long du livre, Rémi Huppert se plaît à imaginer leur rencontre en 1910. « Claude Debussy replace deux statuettes, feint de ranger des paperasses. Pochette, Lavallière et légion d’honneur rehaussent la veste de velours noir. Le demi-jour jaunit commodes, tableaux, colofichets, éventails et napperons de dentelle. En angle, un piano, comme si un piano devait se contenter d’un angle. – Asseyez-vous donc, vous auriez tort de rester debout. » De cette trajectoire toute tracée le roman dévie formidablement et s’opère alors, page après page, paragraphe après paragraphe, une remontée dans le temps où flash back et présent s’entremêlent de manière déconcertante obligeant le lecteur à une vigilance et une acuité sans lesquelles l’amplitude du roman ne pourrait être saluée.
Il y a dans le propos de Rémi Huppert un décompte, compte à rebours des vies, dans la longue remontée du présent vers le passé des protagonistes. Deux hommes font face à O., Bukka pianiste de jazz, noir américain âgé de l’Alabama, (« Pas un cadeau du ciel d’être noir, un jazzman noir revenait à être deux fois noir ») rencontré dans un bar de Montmartre, chacun agissant comme un révélateur et un engagement de ce que porte et sous-tend la musique de l’autre : « Au fond de la pièce, une ombre se rencogne, colle son empreinte au plafond. Difficile de savoir si l’ombre se tapit pour échapper à la vue, ou si elle se blottit sans intention de se cacher. Subitement un noir s’arrache de son siège, élégance chic, vraiment chic, pochette et cravate rouges égayant la veste blanche. Il porte beau, ce dandy ! Il chaloupe comme un loup de mer, lisse les bords de son feutre bistre à ruban épais et affiche un charmant sourire, éclairant sa mélancolie. » L’autre, c’est Ben, jeune américain de Chicago, saxophoniste, juif, qui apparaît au mitan du récit. Le roman ne musarde pas. Il conte d’une manière subtile et précise les protagonistes qui, s’ils sont d’authentiques musiciens, doivent leur formation d’artistes à la douleur de l’apprentissage jamais facilité. Du passé lointain de Bukka ressurgissent les fantômes de la pauvreté, de la dureté du noyau familial, de l’aveugle qui lui lèguera son premier piano : « Un loufoque fredonnait ça, près de chez moi. Prénom, Kelly, nom inconnu, un demi-siècle d’avance au compteur, à côté mes seize ans pesaient trois grains de riz. Plus il chantait, plus sa voix devenait rauque, ses refrains menaçants, ah, ça ! Il menaçait la terre entière… derrière quatre murs. ». D’O. On lit l’intransigeance routinière de Eom-ma, la mère, qui attelle la fillette à son instrument ne lui accordant aucun temps libre sauf à s’échapper sur les collines de la baie de Busan pour y retrouver l’arbre symbole : « L’arbre arqué sous le vent lui adressait la parole, une parole d’ami préférable aux dentelures du chêne, à la majesté du pin, aux nervures de l’érable…. Alors du haut de sa grandeur, le roi de la colline, souverain de l’air et de la terre, répliquant aux humiliations et à la méchanceté. Et l’arbre s’écriait . – Vis tes rêves ! »
C’est donc de rêves sur les brisées, les désastres du réel dont il s’agit là. Des enfances reléguées qui remontent par le truchement des générations précédentes. Et si chacun est porteur d’une histoire qui les dépasse, chacun d’eux n’en est pas moins la caisse de résonance de l’histoire du monde et notamment du XXème siècle. O. porte en elle la partition de la Corée. « D’un champ d’ombres émergeaient du Nord vers la pointe Sud, les ghettos de famine et les poches de misère, les boutiques en bois et les marchands ambulants. L’exode. On avançait le jour, parfois la nuit, sans lanterne ni fanal. Les charrettes crevassaient les boyaux, les roues raclaient l’asphalte. Des gouttes d’eau perlaient sur la peau et trempaient les chemises. Les mains gerçaient, les pieds gonflaient, on perçait ses ampoules à l’aiguille, on triait assiettes et pichets, bols et verres, ébréchés, dépareillés à couper la soif et la faim. » Le hasard a voulu qu’elle ait grandi au Sud mais les oncles, les tantes, les cousins sont dans cet ailleurs du Nord, inaccessible, impossible à rejoindre, fut-ce pour de brèves rencontres. Bukka, vieil homme porte le lourd héritage de la ségrégation raciale, des attentats et de la misère. « Seule une poignée de blancs célébra l’attentat. – Vous pensez, dégommer « quatre nègres »…/ -Quatre nègres de moins,, toujours ça de pris…/- Au fait qui a posé la bombe ?…/- Nous l’avons posée ensemble…. Tous soûlés au bourbon, ces fantômes portaient un nom identique, les United Klans of América. Au fond des pinèdes, ces blancs d’Alabama déployaient leur arsenal de croix en braises et de torches en flammes, dansaient un ballet de toges blanches, une pantomime de masques pointus. » Inlassablement Bukka parcourra les STATES, de club en club, les seuls lieux où s’accomplit en lumière et en intensité, en plénitude de sa musique, sa destinée, lui qui a vu en O., cette toute jeune femme son égale en musique garde à jamais la désillusion du premier amour entre lui, le fils d’ivrogne ( Dad qui déjà ronflait comme une toupie), et Betsie, la fille de pasteur. Précédemment, Rémi Huppert avec lettre à Moïse, avait déroulé les chemins d’une mémoire familiale. Cette mémoire là, Ben, qui entretemps aura épousé O., la déroule à son tour. Comme O. y revient à sa façon en acceptant d’écrire, sur commande, une partition qui mêle en toile de fond l’histoire tragique de la Corée. Elle quittera Ben à moins qu’à bien y regarder chacun quitte l’autre. Comme ils s’étaient trouvés, ils se sont perdus, pour se découvrir en solitaires et aller vers eux-mêmes.
Le roman restitue les lieux jusqu’à retrouver les territoires sacrés que la mémoire conserve enfouis, les échappées aussi, notamment Saint-Jean de Luz en référence à Debussy. Par la magie de l’écriture, cette manière tout à fait singulière de glisser d’une vie à l’autre, de maîtriser son propos qui est de dire la difficulté du vivre quand les fêlures, les silences, les attentes ont été le décor de l’enfance, cette manière aussi de composer les personnages à l’encontre de la fatalité, marqueur des existences, l’auteur se plaît à prendre à témoin le lecteur comme si, par un effet de proximité voulue, il consentait à partager ce qui est de l’ordre d’une souveraineté qui douterait d’elle-même. Celle de l’écrivain qui consent à dire les ruptures, l’engloutissement, mais aussi l’ascension et le cérémoniel sans lesquels les âmes ne pourraient habiter ce monde.
Il y a quelque chose de l’ordre de la foi, en Rémi Huppert, foi en la musique qu’il connaît si bien, mais aussi en la musicalité de la vie et des instruments qui s’y prêtent, ici le piano et le saxophone. La mort de Bukka, dans sa chambre d’hôtel, du vieil homme qui s’est retiré du projet initial qu’aurait voulu mener à bien O., un jazz Debussien, éloignement volontaire, émargeant aux abonnés absents, par admiration et amour impossible pour la jeune femme, s’il est un point d’orgue n’en est pas moins dans l’ordre des choses, cet ordre que tant de cataclysmes n’ont eu de cesse de perturber l’hier et l’aujourd’hui. La venue de Ben à Vienne, la lettre du père (« Chez Shaul, Wien se prononçait Kristal ») sur les pérégrinations et l’exil de ses grands parents, Samuel et Léa, relèvent d’un autre possible après la faillite, l’apparent non-sens de son mariage avec O.. « Il marchera longtemps, entendra une mélodie de Rilke, de Malher le chant de la terre, prêt à aimer une langue, des parcs des canaux, prêt à aimer Vienne. Il lira encore une dernière fois la lettre de Shaul, selon le souhait de Salomé, articulera un… Attends, maman, tu n’as encore rien entendu, ma maman à moi ! » Quand à Mme O., à présent consacrée et reconnue, c’est d’une vieille dame, revenue au pays, dont on parle à la fin du roman avec ses souvenirs, son silence intérieur, son havre, son écoute, sa quiétude, son acceptation d’elle-même.
« Un trio vraiment très swing » comme les mots l’indiquent est un condensé enfumé et éclairé à la fois des musiques blues, bop, jazz, rag-time, country, folk sur lesquelles flottent la modernité de Claude Debussy, un brassage revendiqué auquel nous convie, dans un chassé-croisé de destinées, l’écrivain Rémi Huppert.
Francis Vladimir
Un trio très swing de Rémi Huppert. Un trio très swing. Éditions du Petit Pavé (2022) – 186p – 18€
