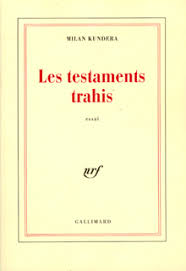Sagesse frondeuse de Milan Kundera
À propos des Testaments trahis,
par René Zahnd
«Vous êtes communiste, monsieur Kundera ?
– Non, je suis romancier.
– Vous êtes dissident ?
– Non, je suis romancier.
– Vous êtes de gauche ou de droite ?
– Ni l’un ni l’autre. Je suis romancier.»
Cette obstination, et cette certitude d’être romancier, uniquement romancier, entièrement romancier, habite Milan Kundera au point de marquer et son œuvre, et sa vie. En ouverture de son premier essai, L’Art du roman (1985), déjà il nous prévenait: «Dois-je souligner que je n’ai pas la moindre ambition théorique et que tout ce livre n’est que la confession d’un praticien ?» Un praticien: en l’occurrence quelqu’un qui lit et qui écrit.
Huit ans plus tard, l’auteur de L’Immortalité entre à nouveau en matière et publie un fort volume, écrit directement en français, qui reprend, développe, élargit certains thèmes abordés dans L’Art du roman. Le prière d’insérer précise même, non sans malice, que «l’art du roman est le héros principal du livre». Admettons la formule. Cependant, dans sa manière éblouissante, dans sa composition, dans son tourbillonnement de références et de réflexions, Les Testaments trahis va loin.
Nous sommes dans une société qui paraît basée sur la superficialité, le confort individuel, le profit. On connaît la chanson de l’image qui pousse l’écrit aux oubliettes. On a une indigestion de certaines rengaines: l’abrutissement généralisé, la perte du sens, la dissolution de la culture dans l’air du temps, l’impasse de l’art moderne, l’ineptie de la musique contemporaine, la mort de la littérature sans oublier, annoncée avec quelle jubilation par certains mandarins et leurs épigones, la fin de l’Histoire. On se le demande: dans quel monde vivons-nous ?
Dans un monde, en tout cas, qui subit le poids du passé et qui, dans son être (oui: l’être du monde) recèle des traumatismes, des fractures qui le conduisent à une forme de désarroi. Pour preuve: on ne se pose plus guère de questions importantes, et certains mots ou idées, comme des anges déchus des utopies passées, sont voués aux gémonies. Ose-t-on le regretter (on ne résout pas un problème en l’ignorant) qu’on est traité de rétrograde, de barbon avant l’âge qui n’y pige que dal, pour n’évoquer ici que les jugements les plus aimables.
Or, certains livres, dans ce tableau sombre, viennent comme des agitateurs de neurones. Et, en tout premier lieu cet automne, Les Testaments trahis de Milan Kundera. Car cet enchaînement de neuf textes, qui dessinent une forme de spirale, touche bien à des questions primordiales: par exemple le sort réservé à l’art dans notre société. Mais la force et, justement, l’art de Kundera sont de ne pas sembler y toucher. Son livre repose sur son expérience personnelle, et c’est au travers d’exemples, scrutés avec la plus extrême des attentions, que certaines idées sont défendues. Au lecteur d’en tirer le bilan: Kundera, lui, non sans grâce et légèreté, déroule son brillant propos, le parsème d’humour, d’ironie, de pensées, de révolte, de colères ou de sagesse.
Dès les premières lignes, on est emporté dans le tourbillon. Les pages nous envoient ricocher de Rabelais à Rushdie: le livre s’ouvre sur un texte consacré à l’improbable dans le roman, à l’humour («la grande invention de l’esprit moderne», selon Octavio Paz), en cheminant allégrement aux côtés de Thomas Mann, de Fuentes, de Sterne, de Diderot, de Broch et de quelques autres. C’est donc comme une exposition générale, qui reprend les grands thèmes et les conceptions de Kundera, qui fixe les lignes du paysage, puisque, pour l’écrivain, le roman est un art européen né de l’humour: «L’humour: éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l’homme dans sa profonde incompétence à juger les autres; l’humour: l’ivresse de la relativité des choses humaines; le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude.»
Ensuite, on entre dans un domaine beaucoup plus spécifique. Quelles sont les barrières qui empêchent d’accéder à la vérité d’un œuvre ? Suivent alors des exemples, très fouillés, et qui traversent l’ensemble du livre: Kafka et ses relations avec son ami Max Brod (les méfaits terrifiants des «kafkologues»), Stravinski et Ansermet («Mais vous n’êtes pas chez vous, mon cher», écrivait le premier au second, lorsque celui-ci lui demandait d’autoriser des coupures dans la partition de Jeu de cartes), Hemingway et la gangrène de ses biographes, le génial et méconnu compositeur Janacek («… avec sa petite nation»).
On reste parfois arrêté par quelques passages fulgurants, qui forcent à poser le livre et à regarder le ciel par la fenêtre. Un exemple: «Une image me poursuit: selon une croyance populaire, dans la seconde de l’agonie celui qui va mourir voit se dérouler devant ses yeux toute sa vie passée. Dans l’œuvre de Stravinski, la musique européenne s’est souvenue de sa vie millénaire; cela a été son dernier rêve avant de partir pour un sommeil éternel sans rêves.»
Et tout cela se mêle, s’entremêle, se complique de thèmes apparemment digressifs (l’émigration, la traduction, la critique littéraire, les procès intentés à l’art, la pudeur, l’indiscrétion comme signe de l’époque, et cent autres choses) avec de constants va-et-vient entre les lectures et la réalité vécue, dans un entrelacs de discours, historiques, esthétiques, littéraires, polémiques parfois, pour s’achever sur une forme de sagesse existentielle.
L’ensemble – la comparaison est un peu facile – est composé à la façon d’une œuvre musicale. D’ailleurs, comme un disque appelle plusieurs écoutes, Les Testaments trahis invitent à plusieurs relectures, pour en fouiller les recoins, en saisir les subtilités, en percer la densité. La rigueur s’y mêle à une part de liberté, d’improvisation, dans une manière qui est celle que Kundera développe aussi dans ses romans. Il remet les pendules à l’heure, pose les bornes de son territoire, et lance un réquisitoire pour le respect de l’artiste, de son œuvre, et donc de la personne. Car là réside, à mon sens, le thème principal du livre. Ce qui arrive à un roman ou à une partition (les exemples historiques en témoignent), déformés aux dépens du créateur, parfois avec les meilleures intentions du monde (Max Brod et Kafka), de la traduction à l’interprétation, de la critique à l’exégèse, est, appliqué à l’art, ce qui menace l’individu dans ce qu’on pourrait appeler «sa vérité».
R. Z.