Pourquoi il faut (re)lire Dino Buzzati

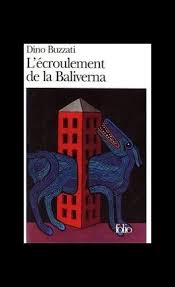

À propos de L’Écroulement de la Baliverna
par Livia Mattei
Le nom de Dino Buzzati est devenu célèbre, en littérature contemporaine, associé au titre de son chef-d’œuvre, Le désert des tartares, ou aux recueils de nouvelles dans lesquels son intelligence et sa sensibilité font merveille, tels Le K, Le Rêve de l’escalier ou Les nuits difficiles. Le conteur fascine, chez Buzzati, mais le moraliste et le poète touchent plus profondément encore, comme cela ressort de la lecture du florilège de récits paru en poche sous le titre de L’écroulement de la Baliverna.
Sans vouloir prophétiser, l’on peut supposer que l’œuvre de Dino Buzzati restera, aux yeux de la postérité, comme l’une des plus significative, mais aussi des plus transparentes, quant au sens orientant ses thèmes et ses images, des angoisses et des obsessions de l’Occident d’après-guerre.
Plutôt mal vu de la critique italienne contemporaine et du petit monde académique, que son anticommunisme et son scepticisme lucide ont de quoi défriser, Buzzati est en revanche apprécié par un large public, à l’instar d’un Marcel Aymé en France. Pourquoi cela ? Nous y voyons deux raisons : en premier lieu, Buzzati raconte des histoires ; et avec celles-ci, apparentées à la fois au conte et à la fable, par le truchement de symbole adaptés aux mythologies actuelles, l’écrivain sait inciter son lecteur au rêve et à la réflexion.
Chroniqueur de son époque, qui s’inspire volontiers des faits divers dans l’élaboration de ses récits, Buzzati nous donne en outre l’exemple d’une attitude éthique où la droiture le dispute à la clairvoyance.
Adversaire des idéologies, terrien (rappelons qu’il est né à Belluno, en Vénétie, dans une famille de propriétaires campagnards) que ne peuvent abuser les grands mots de l’utopie sociale ou politique, il prend le parti de dire très clairement ce qu’il pense, en se gardant toutefois de prêcher, c’est à savoir d’user du même discours univoque des doctrinaire. Il faut alors citer plus précisément ses thèmes et figures, car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons évoquer les grandes lignes de l’œuvre de Buzzati. À cet égard, notons encore que certains des récits de L’écroulement de la Baliverna sont si denses qu’ils parviennent à concentrer, en quelques pages, les hantises fondamentales de l’écrivain.
Dans l’arène du monde
Il y a, par exemple, le combat atroce que se livrent deux araignées, dans Les gladiateurs, dont la plus faible a été jetée dans la toile de la plus forte, à titre d’expérience, par un paisible Monsignore. Dans l’atmosphère élégiaque d’une fin d’après-midi d’été, nous voyons là comme une saisissante représentation de la condition humaine, car l’expérience cruelle du Monsignore le conduit lui-même jusqu’à l’angoisse panique, la nuit venant, avec la soudaine conscience d’avoir ajouté au mal scandaleux: un monstre le guette lui aussi, dans l’ombre, sur cette toile du monde où Dieu sait qui l’a jeté….
Ou bien il y a le très inquiétants loueur de voiture du Garage Erebus, au fond de son impasse, qui négocie ses fauves roulants, synonymes de griseries luxurieuses et de glorieux succès, aux jeunes gens prêts à lui laisser leur âme en échange – et l’on ressent alors, en fait de damnation, la fuite inexorable du temps bien plus que le poids des péchés. Ou encore, dans Rendez-vous avec Einstein, nous voyons celui-ci prendre conscience, atterré, de la portée catastrophique des ses découvertes.
Dino Buzzati voit le monde en pessimiste. Agnostique, car il ne peut tolérer l’idée d’un Dieu assez cruel pour châtier ses propres créatures, ainsi qu’il l’exprime dont la passionnante série d’entretiens avec Yves Panafieu publiée sous le titre de Mes déserts, ils n’en est pas moins chrétien de fibre, avec un sens du péché et une nostalgie de l’innocence qui donnent à toute son œuvre sa résonance pathétique. Il y a chez lui de l’enfant déçu et du stoïcien, un mélange de sensibilité exacerbée et de goût pour le courage viril. Son univers confine en apparence au fantastique, auquel il emprunte volontiers ses procédés de narration. Cela étant, tout comme le Kafka des nouvelles, Dino Buzzati ne manie le paradoxe que le temps de nous faire prendre conscience de l’inquiétante étrangeté de l’existence.
Dans l’ensemble de ses récits, tout n’est pas, il s’en faut, de la même veine, et du même niveau –mais il faudrait faire la part aussi, des traductions françaises parfois très médiocres, comme celle, notamment, du Rêve de l’escalier. Pourtant c’est bel et bien l’ensemble qu’il faut évaluer, qui constitue un univers cohérent
Un chant aux « Enfers du siècle »
Les lecteurs du recueil intitulé Le K se rappellent sans doute le reportage que Dino Buzzati est chargé de faire aux Enfers, dont on a découvert par hasard l’une des entrées dans un tunnel du métro de Milan. Réplique de notre monde moderne, ces Enfers ne s’en distinguent que par le grossissement de nos folies et de nos maux. Sous le contrôle de fort alléchantes diablesses, les damnés de cet univers parallèle subissent les nuisances du « progrès » que nous connaissons bien, à cela près que les embouteillages y durent des siècles ou que les accélérations y sont mortelles. Les solitudes sont également une des composantes de « ce négatif » cinématographique (toute une étude pourrait être développée sur la remarquable architecture visuelle des récits de Buzzati), et l’on assiste à cette horrible fête de l’Entrüpelung durant laquelle les habitants des Enfers accoutument de jeter tous leurs déchets par les fenêtres, y compris leurs vieillards…
Là-dessus, ces quelques propos pourraient laisser à penser, aux lecteurs ignorant tout de l’œuvre de Buzzati, qu’il il s’agit là d’un auteur acide aux visions sinistres. Or il n’en est rien.
Si la philosophie latente de Buzzati se rapporte en quelque sorte au « vanité des vanités » de l’Ecclésiaste, ne voyons pas chez lui de l’amertume ni du désabusement, mais une immense nostalgie ; non pas de la délectation morose, mais une tendresse sans mièvrerie a l’endroit des créatures humaines. Aussi bien, dans La chute du saint, trouvons-nous un Bienheureux assez fou pour préférer les peines de coeur et les espérances d’un petit groupe de jeunes gens, dans un bar enfumé qu’il aperçoit de son balcon céleste, à son éternelle et monotone félicité.
L’homme pourrait vivre en harmonie au milieu des siens, en s’efforçant ne pas gâcher la vie si courte qui lui est accordée. Au lieu de quoi, comme le navigateur poursuivi par le K, ce monstre marin dont il s’imagine qu’il va le dévorer alors qu’il détient le secret de la sagesse, il fonce tête baissée dans toutes les voies fatales. La passion sentimentale est elle-même une maladie épouvantable, comment s’en aperçoit en lisant Un amour cet admirable petit roman. Or, ces trappes qui nous entourent, ces menaces partout présentes ne font que nous rendre l’existence plus précieuse, dussions-nous à notre tour fuir le K, nous agiter comme des automates ou tomber amoureux de la première call-girl venue…
Peut-être est-ce le alors le signe mystérieux, chez Buzzati, d’un sacré toujours présent, qui fait que son œuvre nous est si nécessaire ?
L.M.
Dino Buzzati, L’écroulement de la Baliverna. Gallimard Folio, 1980.
