Panaït Istrati, Prince des vagabonds

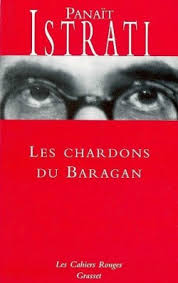

Adios Schéhérazade, III
par Alain Dugrand

Pour saluer le grand retour éditorial de l’immense bonhomme…
Les écrivains ne meurent jamais ! À l’égal d’Octave Mirbeau, Panaït Istrati bénéficie d’une impressionnante redécouverte éditoriale. Biographies, correspondances, BD de Golo, jeunes éditeurs libertaires, la vénérable maison Gallimard, longtemps oublieuse… on assiste à une floraison de rééditions de romans du « prince des vagabonds ». Sous la houlette de Christian Delrue, la Revue des Amis de Panaït Istrati, le Haïdouc, n’est pas pour rien dans ce florilège ! (un site www. Panaït-istrati.com).
Léger panorama sur la biographie d’un écrivain des temps présents:

Nice. Janvier 1921. Sur la Promenade des Anglais, le photographe ambulant s’époumone, il n’en peut plus de héler le chaland pour lui tirer le portrait. Le 3 janvier, tuberculeux, misérable, solitaire, Panaït Istrati tente de se couper la gorge, square Albert Ier. Il est sauvé in extremis par un médecin de l’hôpital Saint-Roch, qui découvre une lettre dans les frusques du désespéré. Celle-ci, accompagnée d’un manuscrit de vingt-sept pages, est adressée à l’écrivain Romain Rolland. L’auteur de Jean Christophe, prix Nobel de Littérature 1915, répond aussitôt à l’inconnu de Nice : « J’attends l’œuvre. » Romain Rolland convoquera Jean-Richard Bloch, son ami, pour aider l’auteur inconnu à mettre au point Kyra Kyralina, qui sera publié chez Rieder en 1923. Oncle Anghel paraît l’année suivante, Présentation des haïdoucs en 1925, puis Domnitza de Snagov en 1926. Le cycle romanesque du héros, Adrien Zograffi – quatre volumes -, rencontre un succès immense. Préfacier du premier volume, Rolland prévient : « On voudra bien se souvenir que l’homme qui a écrit ces pages si alertes a appris, seul, le français il y a sept ans, en lisant nos classiques. »

Panaït Istrati voit le jour en 1884 à Braïla, le grand port de commerce roumain, « une garce plantureuse qui contemple le Danube son amant ». Sa mère, roumaine, est blanchisseuse à la journée ; son père, négociant en tabac, contrebandier crétois de Céphalonie en mer Ionienne, meurt de phtisie alors que son fils n’a que quelques mois. (1) À Braïla, cité cosmopolite des Balkans, l’enfant fréquente l’école primaire six années durant, puis, adolescent, il est placé chez un cabaretier grec, où il acquiert la langue de son père. Dès lors, le jeune Istrati pratique mille métiers, vendeur à la sauvette, colporteur, calfateur de coques sur les docks de Braïla. Sans un sou, en 1906, il embarque, clandestin, sur le navire Imparatal Trajan, un des bâtiments de Méditerranée orientale. Ce lecteur impénitent est tenaillé par une rage de voyages, Bucarest, Constantinople alors capitale de l’Empire ottoman, Chypre, Le Caire, Naples, Paris et la Suisse, enfin. Bilingue, Istrati apprend des bribes des langues albanaise, turque et même française.

- À 20 ans, fervent des causes sociales, le gamin de Braïla avait commis ses débuts de rédacteur à Roumanie Ouvrière, avant d’être élu secrétaire du Syndicat des dockers. Mais son goût de l’errance l’entraîne vers les grands ports de Méditerranée. D’Alexandrie il veut gagner Marseille, mais, passager clandestin selon son habitude, on le débarque à Naples. Tantôt valet de chambre, ouvrier peintre, manœuvre, préparateur de narguilé, ses lectures vagabondes renforcent une manière d’observation qu’il rendra splendide dans une œuvre d’un style réaliste, brutal, d’une vigoureuse originalité.
- La Roumanie va entrer en guerre. Revenu au pays, Istrati rompt avec un premier amour, une militante socialiste. Il vend un petit élevage de cochons, s’offre un billet de train et s’en va se réfugier en Suisse. Au sanatorium de Leysins, il se lie avec un malade, le militant sioniste Josué Jehouda. Celui-ci l’ouvre à la découverte de Balzac, mais surtout à l’œuvre du pacifiste Romain Rolland. Peu à peu, son compagnon de chambrée lui enseigne le français. Dès lors, l’œuvre de Romain Rolland devient un guide pour le futur auteur. Nombre de mots des vocabulaires roumain, hongrois, grec et turc ponctueront cette prose élégante, chaleureuse, musicale.
À Paris, chaperonné par Henri Barbusse, qui lui ouvre sa revue Monde, Istrati, installé dans le sous-sol de l’atelier de son ami bottier Georges Ionesco, affine son premier manuscrit, Kyra Kyralina grâce à l’aide de J.R. Bloch. La réception du roman est exceptionnelle. Adulé, convié par revuistes et journalistes, Istrati, désormais auteur de best-sellers, accède au statut de star internationale lors des années 1925 à 1930. Son œuvre est bientôt traduite en seize langues.
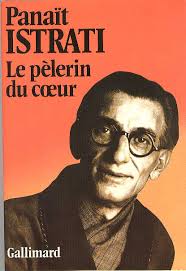
Contemporain des surréalistes, il est loué autant par l’avant-garde qu’une coterie de jeunes écrivains et d’artistes. Parmi ceux-ci, Georges Bataille, Joseph Kessel, Blaise Cendrars et Frans Maserel. En Allemagne, Kyra Kyralina est traduit, puis édité par Stefan Zweig dès 1924. Cette réception unanime est illustrée par un point de vue sur la littérature qu’Istrati confie dans une correspondance privée. Il raille « l’écrivain distingué » : « C’est lui qui n’a su que trop rarement se faire comprendre de ces gens simples et mal préparés, en se bornant le plus souvent à déclamer des subtilités stylistiques surannées, accessibles à quelques centaines de lecteurs ‘’esthètes’’ comme lui-même, pendant que les hommes sincères du peuple ‘’d’en bas’’, assoiffés d’émotions littéraires et sentimentales, étaient la proie des forbans du porte-plume. » À ce titre, l’œuvre d’Istrati est admirée par les écrivains prolétariens, ainsi Marcel Martinet, Henry Poulaille.

Quels sont donc les ressorts de thèmes istratiens aussi séduisants ?
Les récits baignent dans un climat, une atmosphère, un sentiment oriental dominé par les évocations de potentats osmanlis et de leurs personnels dans l’empire des Turcs. Les romans déploient encore une héroïsation des vaincus, tissent une étoffe constituée de contes oraux, de propos de gargotes, de confidences et d’observations du grand voyageur.
Ses héros sont les « haïdoucs », des hors-la-loi, robin-des-bois dressés contre l’oppression ottomane féodale et ses affidés les « boiards », les propriétaires terriens, les « gospodars ». Le haïdouc d’Istrati se dresse contre les despotes, leurs obligés, le clergé des moines aussi rapaces que mercenaires brutaux dévoués aux puissants. Istrati campe ainsi une fresque grouillante de latifundaires esclavagistes, oppresseurs des communautés soumises, des peuples tziganes et des groupes minoritaires. La conscience morale éveillée du haïdouc fonde sa révolte, « chez lui tout résonne, et il aime à se mêler de tout ce qui est humain ». Impitoyable à l’égard des tyrans, des indifférents, des résignés du « laisser faire », le haïdouc dévoue son existence à la cause de la justice. Ce Vengeur tue, mais son crime n’est en rien conséquence du vice, d’une cruauté dévoyée.

- Lors du dixième anniversaire de l’Octobre rouge, Panaït Istrati est convié à Moscou par la VOKS, société pan-soviétique pour les relations culturelles avec l’étranger. Il quitte Paris en compagnie d’un fidèle ami d’antan, Cristian Rakowski, ambassadeur soviétique en France. Tout au long de ce voyage, Istrati sera témoin de l’exclusion de son ami du parti bolchevik. Déporté à Astrakan, Rakowski sera exécuté en 1941 dans la forêt de Medvedev, non loin de la prison d’Orel, par décision de Staline. Lors du périple russe – il prendra fin le 15 octobre 1929 -, Istrati noue une profonde amitié avec un journaliste, le Crétois Nikos Kazantzaki, futur auteur d’Alexis Zorba. Mais si Kazantzaki conserve ses convictions socialistes, il garde le silence sur les choses vues en URSS. Istrati, par contre, décide de témoigner sur ce qu’il a vécu et observé en seize mois de son voyage soviétique.
Tancé par des amis français qui lui reprochent ce pas de côté à l’égard de la patrie du socialisme, Istrati aura cette réplique : « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, dites-vous. Je vois bien les œufs cassés, mais où donc est l’omelette ? »

- À l’âge de 45 ans, bien avant les critiques des visiteurs français en Russie soviétique – Louis-Ferdinand Céline et son Mea Culpa (1936), La Ligne de force de Pierre Herbart, puis, la même année, Retour d’URSS d’André Gide -, Istrati publie Vers l’autre flamme. C’est là un récit lucide, aussi radical que les pages que publiera le Croate Ante Ciliga en 1938, Dix ans au pays du mensonge déconcertant, dix ans d’isolateurs concentrationnaires, de déportations sibériennes. Dans son propre texte, une expérience maligne du pouvoir totalitaire, Istrati dresse un constat accablant du stalinisme et de sa bureaucratie. En 1928, afin d’exposer en pleine lumière le récit de la persécution de son ami Victor Serge, déporté dans l’Oural avec son fils Vlady pour délit de trotskisme, Panaït redouble de colère dans le numéro 193 de la NRF de Jean Paulhan. Dans un long article d’octobre 1929, « L’affaire Roussakov ou l’URSS aujourd’hui », Istrati dénonce l’arrestation de ce vieil ouvrier anarchiste propre beau-père de Victor Serge. Ce texte, d’ailleurs, constitue le pivot du tome 1er de Vers l’autre flamme.
À Paris, le romancier Henri Barbusse, puis le journal L’Humanité stalinienne dénoncent aussitôt le livre. Istrati désormais est qualifié de « fasciste cosmopolite », « agent de la Sigourantsa », la police politique roumaine. Romain Rolland lui bat froid, puis c’est l’ostracisme, la brouille générale avec une grande partie des progressistes d’hier, ces « idiots utiles » de la révolution selon Lénine.
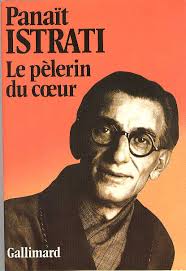
Honni, abandonné de tous, de la « femme de sa vie », la jeune Bilili, qui l’avait accompagné pendant la seconde partie du voyage soviétique, Istrati se réfugie en Roumanie. Il tente de guérir de la tuberculose, puis il épouse Margareta, qu’il entraîne dans son ultime voyage-pèlerinage français. Il est à Nice de juillet 1933 au début de l’année suivante, où de rares fidèles lui ont conservé leur amitié, Matisse, Marinetti, Signac lui rendent visite à son hôtel. Il meurt à Bucarest en avril 1935. Tout juste après sa fin, paraît chez Gallimard le premier livre de George Orwell, La Vache enragée. André Malraux avait pris la décision d’en demander préface à Panaït Istrati, « frère d’Orwell en humanité ». Selon sa dernière volonté dans l’hommage silencieux des Bucarestois hissés dans les arbres tout au long du parcours de ses funérailles, Istrati est conduit au cimetière Bellu sur un char tiré par des bœufs recouverts de tapis paysans. Il n’y aura pas de pope devant la tombe.


Pour des raisons historiques, politiques que l’on sait, l’œuvre d’Istrati demeurera placée sous le boisseau pendant près de trente ans. Jusqu’à ce qu’un groupe de fidèles, Joseph Kessel est à leur tête, obtiennent la réédition complète de ces quelque vingt titres, dont la moitié appartient au cycle Adrien Zograffi, en quatre volumes chez Gallimard. Et c’est ainsi qu’Istrati nous est rendu !
Panaït Istrati et Romain Rolland, Correspondance (1919-1935), Gallimard. Édition établie, présentée et annotée par Daniel Lérault et Jean Rière.
Alain Dugrand

Merci de nous faire (re)découvrir un homme intègre et courageux ; une victime de plus de l’infâme nomenklatura intellectuelle française qui a cadenassé les Lettres pendant si longtemps.