Metin Arditi le répète: que l’art est pacificateur


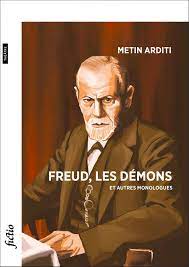
Un beau roman, évoquant le parcours d’un peintre d’icônes du XIe siècle, en Palestine, obéissant à l’amour humain plus qu’à la présumée Loi divine, et trois variations sur les errances de l’autorité « patriarcale », prolongent la réflexion d’un homme de bonne volonté engagé dans une œuvre de médiation fraternelle.
Par JLK
L’usage du mot icône s’est tellement dégradé, dans la profusion actuelle des images insignifiantes, que n’importe quelle célébrité s’en voit affublée par les temps qui courent, de Ronaldo l’ «icône du foot » aux « icônes » de la mode ou de la gastro, entre mille autres exemples.
Or l’icône, à son origine orthodoxe et canonique, est l’image par excellence du sacré, pour ainsi dire le visage de Dieu, de la Trinité ou des saints, qui devrait éclipser toute autre beauté. La Joconde, selon les canons de l’iconographie, devrait se voiler la face, ou c’est nous qui devrions la brûler comme fausse image selon les critères des iconographes, mais à ceux-là s’opposent, plus radicaux encore, les iconoclastes musulmans opposés à toute représentation des saintes figures ; et pire encore : toute forme d’art était suspecte au très pur et très dur Blaise Pascal en son djihâd janséniste mené à la pointe de la séculaire « querelle des images ».
Le cynique contemporain ricanera probablement à l’évocation de tels thèmes en une époque où, par exemple dans les ports-francs de la région genevoise et environs, les icônes les plus chargées de spiritualité pure font l’objet d’un trafic juteux – mais faisons comme si l’affaire était encore d’actualité…
Donc transportons-nous en l’an 1079 de notre ère, en « terre sainte » où cohabitent trois religions, pour assister à l’apprentissage d’un jeune fils de juif de stricte observance au prénom d’Avner, touché par les chants des moines orthodoxes auxquels il livre son poisson de petit pêcheur palestinien (il est encore ado au début du roman de Metin Arditi), qui découvre la beauté des icônes et décide d’en peindre à son tour , ou plus exactement d’en «écrire» , car son premier initiateur, un certain Anastase, lui apprend qu’une icône s’écrit.
Problème : le petit Avner, juif de souche mais désirant s’initier à l’iconographie dans les ateliers des monastères, consent à se faire baptiser sans avoir la foi au sens orthodoxe: il ne croit ni à la révélation ni à la résurrection comme ses frères ordonnés croient qu’on doit croire, donc les icônes qu’il apprend à «écrire», et qui seront bientôt plus belles que les autres constitueront autant de blasphèmes virtuels du genre de la Joconde déguisée en vierge Marie, etc.
Un conte aux (multiples) résonances actuelles
Sous la forme d’une espèce de conte romanesque à valeur d’apologue ou de parabole, L’homme qui peignait les âmes s’inscrit dans le droit fil du roman précédent de Metin Arditi, Rachel et les siens, « travaillant » déjà le thème de la cohabitation des trois religions du Livre sur le timbre-poste géographique de la terre sainte, dans un esprit de conciliation voire de pacification.
Le départ du roman est l’icône représentant un Christ guerrier qu’on croyait l’œuvre d’un moine du XVe siècle, et qui serait à vrai dire beaucoup plus ancienne, reliquat de la production d’un iconographe du XIe siècle. Scientifiquement avérée (chacune et chacun connaît évidemment le pouvoir révélateur d’une étude dendrochronologique permettant d’évaluer l’âge d’un bout de bois par ses cernes de croissances), l’hypothèse fonde la vérité historique de l’enquête (sur le terrain,) devenue roman, avec ce paradoxe apparent qu’un peintre d’âmes pacifiées ne nous laisse qu’une représentation de combattant armé comme l’étaient les croisés – les lecteurs découvriront ce que « cela » cache, au figuré et au propre…
Immédiatement attachant par ce qu’on pourrait dire sa beauté intérieure, sa porosité sensible et plus encore sa farouche indépendance d’esprit Avner ne séduit pas seulement sa belle cousine Myriam, avant la lectrice et le lecteur, mais aussi le moine Anastase et le marchand Mansour, deux mentors se substituant à un père moralisateur et rabat-joie ; et puis Avner est ancré dans le concret, il est sensuel et artisan autant qu’artiste, il sait recevoir comme il sait donner. Le noyau de son art particulier tient au fait que, « plutôt que de représenter la part d’humain dans le Christ et ses Saints, Avner inversait la démarche, faisait surgir la part de divine enfouie en chacun ». Autant dire que ce «retournement» ne peut qu’inquiéter les gardiens du Temple, quel qu’il soit, et que ce sont les autorités religieuses associées qui présideront à l’élimination par le feu des œuvres et de la personne de l’hérétique.
Il y a, de toute évidence, du Metin en lui, ou disons que l’écrivain propose, avec ce personnage, une incarnation avenante de son idéal de conciliation, sans esquiver les obstacles de la réalité et la déraison envieuse ou dogmatique des hommes. Avner lui-même est constamment menacé par sa propension à l’orgueil du «créateur», mais ses faiblesses autant que son génie particulier (comme chez Leonard de Vinci, Rembrandt, Van Gogh et tout artiste authentique en somme) s’inscrivent essentiellement dans la ressemblance humaine.
Où science et religion, art et morale dialoguent en liberté
À la fin des ses « réflexions d’un physicien » parues sous le titre de La Vie dans l’univers, le célèbre Freeman J. Dyson, hérétique lui aussi, affirme que « la religion est une part essentielle de la condition humaine, elle est enracinée plus profondément et partagée plus largement que la science ». Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle « la religion », et pas question pour lui de fondre science et religion dans un méli-mélo spiritualisant.
« Si la science et la religion sont complémentaires, écrit encore Dyson, il vaut mieux qu’elle vivent séparément, en se respectant mutuellement, mais avec des identités et des comptes en banque séparés ». Et ceci : « Toute grande religion est associée à un grand art et une grande littérature, depuis la plus haute Antiquité ». Et cela : « Si l’on cherche des perspectives sur la nature humaine pour guider l’avenir de la religion, on en trouvera plus dans les romans de Dostoïevski que dans les revues de science cognitive ». Et cela enfin : « La littérature est le grand entrepôt de l’expérience humaine ».
Quel rapport avec un «écrivain» d’icônes du XIe siècle judéo-chrétien ? À chacune et chacun de le trouver. Avec un point de convergence: la Beauté, dont un personnage de Dostoïevski disait qu’elle sauverait le monde. La Beauté conjuguée, s’agissant d’Avner-Metin, avec la Bonté. Et cela avec ou sans les dogmes théologiques, les «lois de la physique » ou les codes de la morale courante – en toute liberté.
À préciser enfin que la défense de la ressemblance humaine ne serait qu’un conte à l’eau de rose si elle ne passait pas par l’expérience de la complexité et de la solitude, des feux de l’envie et de la violence. Ce à quoi l’auteur de L’Homme qui peignait les âmes s’est attaché au fil de trois monologues nous faisant sonder les cœurs, les âmes et les tripes de trois « pères », en les personnes de Sigmund Freud, d’un chef d’orchestre de renom mondial en train de perdre la mémoire et du pasteur Cornelius Van Gogh, père d’un irascible peintre d’icônes profanes au prénom de Vincent.
Quel rapport avec Avner ? Il serait intéressant de voir celui-ci peindre ceux-là… Mais c’est, là encore, Metin Arditi qui a «fait le job», avec l’empathie d’un écrivain sondant les cœurs comme le «petit Anastase » peignait les âmes…
Metin Arditi. L’homme qui peignait les âmes. Grasset, 2021. 291p.
Metin Arditi, Freud, les démons et autres monologues. BSN Press, coll. Fictio, 2021, 96p.
Freeman J. Dyson. La Vie dans l’univers, réflexions d’un physicien. Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2009, 256p.
»
