Mari Vargas Llosa dans l’arène

À propos de la somme mémoriale que constitue Le Poisson dans l’eau.
Dans ses Mémoires que traverse un souffle épique, le romancier péruvien alterne les chapitres de son autobiographie et ceux du récit de sa campagne présidentielle de 1990. Rencontre à Paris, en mars 1995.
S’il est de nombreux écrivains à s’être engagés politiquement en ce siècle, pour le meilleur et parfois le pire, ceux qui ont réellement été amenés à exercer le pouvoir sont rares.
Deux exemples à l’Est: le romancier serbe Dobrica Cosic, sacré «père de la nation» mais finalement écarté de la présidence par Slobodan Milosevic, et le dramaturge tchèque Vaclav Havel assumant, en homme providentiel, un pouvoir effectif.
A ces deux cas faillit s’ajouter celui de Mario Vargas Llosa, romancier péruvien de renom mondial passé de la gauche bon teint à un libéralisme éclairé au nom duquel, de 1987 à 1990, il se laissa convaincre d’entrer dans l’arène (il avait déjà refusé un portefeuille de premier ministre à Fernando Belaunde dans les années 1980) sous la pression d’un véritable mouvement populaire.
C’est de cette aventure marquée par la «sale guerre» finale dont profita l’obscur Alberto Fujimori, lequel n’eut de cesse de récupérer les thèmes de son adversaire, que Mario Vargas Llosa fait le récit et le bilan dans Le Poisson dans l’Eau, où il entremêle le récit de son apprentissage de la vie et la relation des tenants et aboutissants de sa campagne présidentielle.

Entretien, à Paris.
— Vous parlez du ressentiment comme d’une véritable «maladie nationale». Qu’est-ce à dire, plus précisément?
— C’est un phénomène courant en Amérique latine et dans tous les pays du tiers monde, mais il est particulièrement marqué dans la société péruvienne où les disparités entre riches et pauvres sont énormes. A cette opposition s’ajoutent de multiples facteurs culturels de division liés à une quantité d’ethnies mal intégrées et au faible niveau intellectuel de la classe aisée. Je cite en outre le profond ressentiment de mon père à l’égard de ma famille maternelle cultivée et tournée vers l’Europe. A ses yeux, être écrivain ou «pédé» revenait à peu près au même…
— Vous affirmez que c’est par «devoir moral» que vous vous êtes lancé dans la bataille présidentielle. Mais le goût de l’aventure, ou du pouvoir, n’a-t-il pas aussi joué son rôle?
— Si je suis devenu romancier, c’est certainement pour accomplir, par compensation, mon rêve d’enfant d’être un aventurier, et ma femme, qui a beaucoup fait pour me dissuader de me lancer dans le combat politique, pense elle aussi que c’est par goût de l’aventure que j’ai sacrifié trois ans de ma vie d’écrivain. Quant au pouvoir, je ne le briguais pas par intérêt personnel mais pour aider mon pays. Mon regret n’est pas d’avoir échoué à titre individuel, mais de voir une fois de plus l’arbitraire triompher. J’étais content de voir M. Fujimori, parti sans programme, se rallier à mes positions visant à libéraliser l’économie, réduire l’inflation et lutter contre le terrorisme, et c’est pourquoi je me suis tenu sur la réserve. Il a fallu que la démocratie fût sacrifiée pour que je revienne à la charge en avril 1992.
— Quel bilan tirez-vous de cette expérience?
— Si je suis amer en ce qui concerne mon pays, l’enrichissement que j’en ai tiré du point de vue de la connaissance des hommes est considérable. J’y ai appris que la politique est une pratique, ou plus exactement une technique très spécifique, qui n’a rien à voir avec ce qu’imaginent la plupart des intellectuels. Je n’ai certes jamais été un idéologue en chambre, et je ne débarquais pas dans le monde politique en naïf ou en irresponsable. Sartre, que j’ai passionnément admiré, et beaucoup d’intellectuels de ce siècle, ont été d’une incroyable et complaisante naïveté à l’égard de la politique. Cela étant, je ne m’attendais pas à ce qu’une campagne électorale donne lieu à une guerre si sale.
— Votre retrait de la scène politique est-il définitif ?
— Irrévocable! Mais notez que rien n’est changé quant à mon engagement. J’ai toujours pensé que le rôle de l’écrivain était d’exercer une résistance au pouvoir. Ma position par rapport à l’injustice n’a jamais varié. En préservant ma liberté — d’où ma distance par rapport au communisme — je n’ai cessé d’intervenir publiquement contre les dictatures de droite et de gauche. Cela m’a valu l’opprobre de maints «idiots utiles», et j’ai même été la cible des terroristes. Or je poursuivrai, parallèlement à mon travail de romancier, cette lutte «contre vents et marées »
Le roman d’une vie
Il y a quelque chose d’un éternel ardent gamin rêvant d’îles à trésors chez Mario Vargas Llosa, et le double récit de sa jeunesse ardente, marquant plusieurs de ses livres de violence et passion (de La Ville et les Chiens à La Tante Julie et le Scribouillard) et de sa course à la présidence du Pérou ont un même panache de roman picaresque.
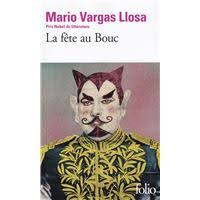
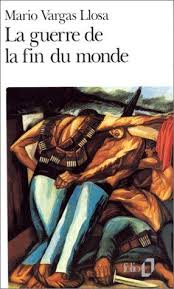
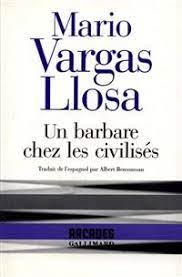
Ce n’est pas, pour autant, que l’auteur sacrifie au goût de l’anecdote. De son propre dire, son dessein initial était de témoigner, avec le recul, de ce qu’il a vécu sur la scène politique. Ensuite seulement lui est apparu la nécessité de situer son action par rapport à ses origines et son éducation, les relations conflictuelles l’opposant à son père, son initiation sentimentale et politique et sa traversée de la société péruvienne. A la puissance d’évocation retrouvée de La Maison verte ou de Conversation à «La Cathédrale», Mario Vargas Llosa allie en ces pages le vaste savoir de l’homme de culture décidé à en remontrer à son paternel «philistin» et l’intelligence pénétrante et mobile d’un intellectuel de premier plan, qui ne s’est jamais contenté de regarder le monde du haut de sa tour d’ivoire sans se faire jamais non plus au cynisme de ce qu’on dit la realpolitik…
Mario Vargas Llosa. Le Poisson dans l’Eau. Traduit (excellemment) de l’espagnol par Albert Bensoussan. Gallimard, coll. Du monde entier, 505 pages.
