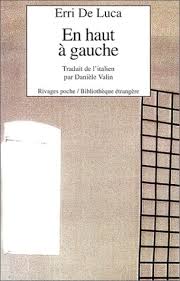L’ouvrier aristocrate du sud profond
Le monde selon Erri de Luca,
par Claire Julier
«Je suis d’un siècle et d’une mer mineurs. Je suis né en leur milieu, à Naples en 1950»…
Entre la mer insolemment bleue et la misère étalée au soleil, les pieds ancrés sur le sol méditerranéen et le pressentiment des secousses volcaniques, Erri de Luca voit le monde tel qu’il est. Il le voit de sa hauteur d’homme, avec le froid du Sud à jamais imprimé sur la peau et l’envie de marcher à pas réguliers, conscient de chaque empreinte laissée dans le sol.
Erri de Luca choisit des instants qu’il a vécus, des instants infimes et les restitue avec toutes les impressions qui y sont liées, mettant ses sens en correspondance. Il donne le parfum d’une peau, la stridence d’un cri à jamais gravé dans tout le corps, l’éclair de feu éjecté par les entrailles indifférentes de la terre, l’odeur de la brioche encore chaude qui se mêle à «l’odeur salée du bois de la barque», le contact avec un anneau soudé au mur, poli par les mains des prisonniers qui se sont succédé dans la prison, «fer variolé de rouille, salé par la graisse des peines», la saveur des cuillerées de bouillon de poule, instillant la vie dans son corps malade. «Les douleurs sont une clef de sol pour qui est musicien de l’intérieur», et en revivant les coups de ses sens, l’écrivain en retrouve les caresses et les stigmates. Il trouve les mots d’accompagnement à son expérience, pétrit la masse glaise et en extrait une forme précise et achevée.
Issu d’un milieu bourgeois, Erri de Luca s’est engagé en politique. Ouvrier par choix, pour mieux comprendre, pour mieux être dans «l’atrocité et la modestie des vies», il éprouve du dedans ce dont il parle, puisant dans les humiliations de la classe choisie avec l’orgueil de l’aristocrate la matière brute de son œuvre. Il connaît la situation du travailleur et sa dignité sans cesse froissée. «Un jour, le contremaître s’adressa à l’un d’entre nous en l’appelant le noir. L’homme s’arrêta et à haute voix répondit qu’il était ouvrier, qu’il avait un nom et un salaire comme les autres et qu’il ne permettait à personne de le prendre par la peau.»
L’écrivain est au plus près du travail de force, de l’autorité abusive des chefs, des départs dans les matins glauques, de la fatigue dont on ne se débarrassera jamais tout à fait, de l’attente du soir pour reprendre enfin son vrai visage sous la douche et du sentiment omniprésent d’injustice qui fait que l’on a envie de crier, d’imposer à chacun de l’éprouver au moins une fois, avec un dos rompu et les mains pleines de cals, mais qui fait aussi parfois voir des éclairs de solidarité qui refont de vous un homme dans sa dignité.
En quelques livres inclassables, Erri de Luca trouve une place parmi les écrivains dont la lecture hausse d’un cran, alliant le miracle d’une prose poétique qui s’adapte aux errances de l’âme, aux sinuosités de la réflexion et aux tressaillements de la conscience. Il a étudié l’hébreu et lu la Bible, disponible au texte, y ajoutant modestement «quelque chose qu’elle contenait déjà et qui n’a pas encore été exprimé pour refléter une part de lumière qu’elle offre». Un retour aux sources, à la langue grand-maternelle afin de découvrir les origines perdues, une résonance à sa propre sensibilité et au sens du monde depuis le temps des Hébreux jus-qu’à l’infamie renouvelée dans le ventre de l’Europe du XXe siècle. Et de ces pages qui relisent la Genèse, l’homme ne peut que tirer une réflexion sur notre siècle vaniteux de son évolution technologique et orphelin du sacré.
Vivant l’expérience de nudité, se confrontant régulièrement avec la peur par la pratique d’ascensions du sixième degré, Erri de Luca sait que «le départ et l’arrivée sont deux prétextes et un seul embarras. Ce qui compte c’est d’aller, d’être dans le courant de sa propre solitude exposée, inutilisable à toute visée.» Laïque au milieu des travailleurs de la chaîne humaine ou des convoyeurs humanitaires, observateur de notre époque et de ce qu’il partage avec les autres, Erri de Luca réfléchit à chaque situation, dans un désespoir assumé. Et c’est à coups de burin qu’il puise dans la matière première de l’homme pour en extraire la singularité et la multiplicité, le tangible et l’intangible.
Avec la régularité de l’artisan, il se souvient de Naples, de son père, des femmes avec qui il a partagé quelques pages de sa vie et il s’interroge, il interroge allant jusqu’au bout de la mise à nu du questionnement quand justement la question devient impudique, blesse ou est si claire qu’elle ne peut que se refouler. Que répondre à l’homme qui a besoin de se réchauffer après avoir tué un autre homme, qui est plongé dans un froid intérieur total et qui formule son désir unique, absolu d’une chaleur à prendre auprès d’une femme ? «Mes étreintes ne cherchaient pas d’amour, n’étaient pas même du désir, mais autre chose, l’immense autre chose qui est derrière les gestes les plus simples.» Que répondre à ces fossoyeurs d’égout, creusant sans aucune sécurité, dans l’obscurité des ténèbres, «cette matière humaine qui ruisselle sous l’infamie» ? Qu’ajouter aux longs bavardages dans le noir entre le père atteint d’un cancer des os et son fils, le fils accompagnant le père vivant ses dernières heures, le père transmettant encore au fils sa vision des choses, lui donnant un message de vie ?
Le lecteur tourne les pages en haut à gauche comme une lente entrée en miséricorde.
C. J.
Erri de Luca, En haut à gauche, Rez-de-Chaussée, Un Nuage comme un Tapis, traduits de l’italien par Danièle Valin, Editions Rivages, 1996.

(Le Passe-Muraille, No 26, Octobre 1996)