L’imaginaire au pouvoir
À propos de L’Enchanteresse de Florence, de Salman Rushdie,
par René Zahnd
Dans la foule bigarrée des personnages qui peuplent L’Enchanteresse de Florence se trouve un artiste qui, après avoir terminé un cycle de peintures, disparaît à l’intérieur d’un de ses tableaux, comme si c’était l’unique issue pour un créateur: se fondre dans son œuvre, lui appartenir davantage que l’inverse pour qu’elle puisse, en toute auto-nomie, déployer ses richesses et ses mystères.
On a ainsi l’impression que Salman Rushdie a pris place dans son dernier livre, ouvrage virtuose dans ses jeux de miroir et son art de cultiver les paradoxes féconds. «Je voulais que cela se lise comme une histoire vraie que j’aurais inventée», n’hésite pas à dire l’écrivain lors d’entretiens. Comme pour troubler davantage encore la frontière entre la «fiction» et la «réalité», une bibliographie digne des études les plus savantes cueille le lecteur au sortir des quatre cents pages du roman.
Partagé dans son existence entre son Orient natal (une enfance à Bombay, berceau d’expériences et de contes sans fin) et un Occident où il vit depuis des lustres (après sa venue en Angleterre pour des études), Rushdie semble puiser dans ce déchirement son eau vive, s’employant à lutter contre l’incompréhension et la non connaissance qui règnent de part et d’autre des frontières politiques, culturelles ou religieuses. Une telle posture, que notre homme épice volontiers d’humour et d’ironie, a d’ailleurs, on s’en souvient, provoqué l’ire de personnages aux pensées considérablement moins larges: une fatwa(mot devenu soudain célèbre et qui désigne une sorte de permis de tuer pour cause de blasphèmes) lancée en 1989 par les ayatollahs de Téhéran après la publication des Versets sataniques.
Le résultat de cet appel au meurtre consista en dix ans d’existence sous haute protection, avec un effet collatéral redoutable: on parlait beaucoup de Rushdie pour la condamnation qui le frappait, on ne le lisait plus guère.
Les rapports de l’Orient et de l’Occident: c’est sans doute, très exactement, là que palpite le cœur de L’Enchanteresse de Florence, diastole et systole en plein XVIe siècle, dans un va-et-vient entre la renaissance florentine et celle qui, en Inde, met sens dessus dessous la cour du Grand Moghol.
Dès la première page, le sortilège agit. Un voyageur au vêtement d’Arlequin, se faisant appeler «Mogor dell’Amore», se prétend dépositaire d’un message de la plus haute importance. Est-ce un imposteur, un mythomane, ou comme il le prétend un ambassadeur? Il va même jusqu’à suggérer qu’il existe un lien de parenté entre lui et l’Empereur, pourtant d’essence divine. Le sacrilège menace. De péripéties en coups d’audace, d’intrigues en rebondissements, Mogor va se mettre à raconter son histoire… Sa vie ne tient d’ailleurs qu’à ce fil.

Alors s’ouvre un tiroir, puis un autre, et plusieurs autres, cependant que certains semblent se refermer. Mais tout cela n’est peut-être qu’illusion. Car la fresque est ici savante, traçant un réseau de chemins buissonniers et de pistes brouillées, évoquant bien sûr les grands corpus de contes orientaux, les Mille et Une Nuits en tête.D’innombrables personnages traversent ce monde enchanté, trois amis aux destins pour le moins contrastés, quatre guerriers géants et suisses de surcroît, une magicienne qui connaît le secret des parfums, des catins au grand cœur et des princesses, des érudits et des négociants, des rustres, un éléphant fou chargé de rendre la justice (joliment baptisé Hiran), sans oublier cette fascinante Dame Yeux Noirs, qui par sa seule beauté fait chavirer les royaumes.
À l’heure des proses minimales et de l’apogée du rase-quotidien, une telle poussée baroquisante a de quoi réjouir. Ce joyeux excès n’est d’ailleurs pas tant dans la phrase elle-même que dans la construction du livre, dans les situations et même, voire peut-être surtout, dans la pensée de l’écrivain. Les espaces ouverts par Rushdie ressemblent à des jardins luxuriants. Il est agréable de s’y délasser. Il est également bon d’y méditer. Ceci, par exemple: «Le drame des hommes n’est pas que nous soyons tellement différents les uns des autres, mais que nous soyons tellement semblables.»
R.Z.
Salman Rushdie, L’Enchanteresse de Florence,excellemment traduit de l’anglais par Gérard Meudal, Plon, 2008.
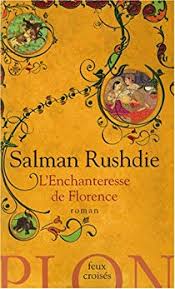
(Archives du Passe-Muraille, No 77, avril 2009)

