Librairies

Une chronique de Philippe Banquet
Avec le temps, j’ai fini par développer une étrange affection, surtout pour un écrivain : je suis allergique aux librairies.
Dès l’enfance, j’ai adoré les livres. Adorer aux deux sens du mot, plaisir suprême et vénération. Longtemps j’ai dû me contenter d’une maigre ration d’ouvrages, empruntés au centre culturel du quartier. J’avalais gloutonnement mes trois « Bibliothèque rose » ou « Bibliothèque verte » de la quinzaine, puis, avec un peu de honte et en cachette, ceux de ma sœur cadette – des livres pour filles, mais des livres malgré tout.
Pendant mes lectures, mon environnement immédiat, quotidien, disparaissait. En quelques phrases j’étais projeté aux côtés de Tom Sawyer, de Jean Valjean ou de mes copains du Club des Cinq qui m’accueillaient volontiers comme sixième membre honoraire. Cette nouvelle vie m’était tout aussi réelle que l’autre, en plus colorée, plus intense et chargée d’émotions. Envoûté par les mystérieuses landes bretonnes, terrorisé par Joe l’Indien, bouleversé par la mort de Gavroche ; je parcourais des univers, si loin de mon petit lit où, en chien de fusil, la tête calée sur l’oreiller, j’étreignais mon livre, passage secret ouvrant sur ces autres mondes. Il fallait pour m’en sortir un appel répété de ma mère, « à table ! », « éteins la lumière !», et parfois même une intervention de la voix sévère de mon père. Que d’heures dérobées à l’enchaînement des jours, que de trésors accumulés dans l’île secrète de ma mémoire !
La lecture m’offrit la seule intimité des années suivantes, cloîtré dans un internat de garçons, soumis à la promiscuité du dortoir et à la surveillance tatillonne de l’encadrement. La bibliothèque de l’établissement était limitée. Les censeurs, heureusement peu cultivés, avaient éliminé les ouvrages jugés subversifs, mais demeurait un fonds classique conséquent, agrémenté de quelques auteurs contemporains supposés inoffensifs ou qu’ils n’avaient pas lus (Troyat, Pagnol, Cesbron, Camus et même Roger Peyrefitte). Nous avions droit à deux emprunts par semaine. S’y ajoutaient les livres de poche que j’achetais à la Maison de la Presse de la grand-rue, quand mes moyens me le permettaient. Je quémandais un supplément auprès de certains camarades – plus souvent des magazines de sport que de vrais livres, la mode n’était guère à la littérature dans notre petit monde. Autant dire que ces années d’enfermement furent aussi celles d’une pénurie de lecture. J’avais en permanence faim de mots et de phrases. À tel point que je finis par trouver une solution. Je me décidai à écrire moi-même ce que je brûlais tant de lire, et débuta ainsi ma « carrière » d’écrivain.
Mes sources d’inspiration principales – j’avais onze ans – furent d’abord les œuvres de Jules Verne et d’Alexandre Dumas, mais surtout divers romans d’aventure, parmi lesquels les exploits du trop oublié Bob Morane.
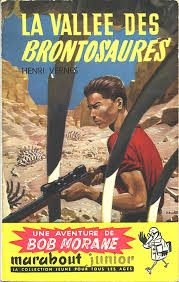
Ah Bob Morane ! Créé par un autre Verne(s), Henri et belge, qui me semblait tout aussi talentueux, cet aventurier, flanqué de son acolyte le colossal Bill Ballantine, luttait contre l’Ombre Jaune, terrible génie du mal. Les péripéties de ce surdoué, tout à la fois aviateur, ingénieur, journaliste et espion, me transportaient loin des dimanches pluvieux et mornes de la Sarthe, vers les moiteurs des moussons et les brumes tièdes des fumeries d’opium. J’appréciais aussi l’absence presque totale de femmes. Jamais le viril Bob ne perdait son temps à roucouler ou, pire, à se livrer à de dégoulinantes embrassades et autres fricotages dégradants. J’estimais alors qu’un héros véritable a mieux à faire de son temps et de ses talents que de minauder avec les filles.
Mes premières tentatives d’écriture occupaient les longues heures de l’étude du soir. J’enrôlais comme personnages les camarades de classe que j’affectionnais le plus, dans des histoires de guerre ou d’agents secrets. Je les vieillissais de quinze ou vingt ans, en leur attribuant des métiers choisis selon leurs capacités physiques et scolaires d’alors. Les derniers de la classe compensaient leurs études écourtées par des prouesses sportives de haut niveau ou un instinct de tueur redoutable ; le premier en maths se retrouvait bombardé ingénieur en chef d’un centre de recherche nucléaire ultrasecret ; quant à moi, je m’accordais modestement un rôle de journaliste/écrivain.
Plus tard, étudiant à Paris, je découvris la FNAC de la rue de Rennes. Ce fut un enchantement. J’ai passé des heures à arpenter les allées entre deux paradis, le rayon Livres et le rayon Disques. Je ne parvenais pas à m’arracher à cette profusion de couvertures et de pochettes, mille délices à portée de main. Il me suffisait de glisser d’auteur en auteur ou de chanteur en groupe de rock, n’en revenant pas de disposer si facilement d’une telle source de potentielle félicité. Potentielle, car la plupart du temps mes poches étaient vides. J’aurais voulu tout acheter, ramener ce butin dans ma chambre et dévorer, à longueur de jour et de nuit. Quand j’avais reçu quelques subsides, l’argent du mois par mes parents ou de rares cadeaux de mes oncles et tantes, je m’offrais un festin littéraire et musical, une orgie de sensations qui me laissait pantelant, rassasié pour quelques heures, ébloui et comblé.
De grandes découvertes changèrent le cours de mon existence, comme un séisme peut détourner une rivière ou ouvrir en deux un massif montagneux, pulvérisant mes petites certitudes, le cadre alors si étroit de ma vie, contrainte tant d’années par l’absence d’horizons.
Hemingway me révéla l’importance de la phrase vraie ; Marguerite Duras et Virginia Woolf m’extirpèrent de mes préjugés imbéciles ; Joyce libéra ma syntaxe ; Dostoïevski m’étourdit de sa folie ; et Céline acheva d’ensevelir sous les cendres mes petites illusions. Son Voyage au bout de la nuit m’embarqua un vendredi soir et m’abandonna le dimanche, épuisé, meurtri et exsangue.
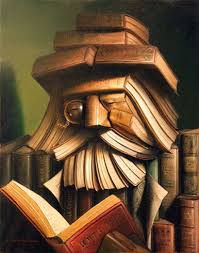
Tant d’écrivains m’ont nourri, emplissant mon être à travers leurs chefs-d’œuvre, mes si chers amis au-delà du temps, Flaubert, Balzac, Dickens et l’inestimable Proust.
Et maintenant ?
Maintenant, les belles librairies parisiennes m’intimident et m’angoissent. Je redoute en particulier certains temples littéraires germanopratins. Je lorgne leur devanture qui présente si joliment les œuvres de la semaine, comme je lorgnais la vitrine de la pâtisserie de mon enfance. Je suis pris d’envie, gourmandise de mots, de phrases, enrobés d’une belle couverture glacée, sobre ou ornée d’une illustration plus ou moins explicite, parfois ceinturée d’un bandeau, lettres blanches sur fond rouge, invite irrésistible.
Mais dès que je me glisse à l’intérieur du sanctuaire, osant à peine déranger la lourde porte qui a salué tant d’illustres littérateurs, je me décompose. Où que porte mon regard, étagères jusqu’au plafond, tables couvertes de plusieurs épaisseurs, ce ne sont que livres, livres, et encore des livres. Tous importants, essentiels, tous respectables, solennels ; ils m’ignorent, me narguent, et pourtant tous attendent et s’attendent à ce que ma main tremblante les caresse, hésite et se décide à les choisir ; à la choisir, elle, l’œuvre indispensable, sans laquelle ma vie serait irrémédiablement manquée.

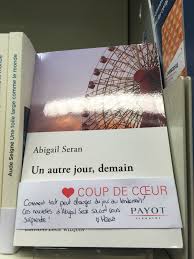

Ayant cédé à l’appel de la « découverte du mois », au « chef-d’œuvre bulgare », ainsi qu’à la « bouleversante écriture ! », sans oublier « un devoir d’urgence », les bras pleins, je prends le chemin de la caisse. Baissant les yeux pour ignorer le mur chargé des cohortes de La Pléiade – tout Tchekhov, Balzac intégral, Proust – chancelant dans le redoutable défilé des auteurs étrangers – Buzzati Dino, Mansfield Katherine, Mishima Yukio – je finis par atteindre, échevelé, livide, le comptoir final. Il me reste à affronter l’employé, impassible et vaguement dédaigneux, qui comptabilise mes acquisitions comme s’il s’agissait de denrées communes, du bas de gamme ne méritant pas un regard. Je paye, prends mon sac et file en me jurant que jamais, plus jamais.
Tous ces livres.
Impossible d’en venir à bout. Je mourrai enseveli sous le « reste à lire », asphyxié ou mort de soif et de faim, expirant en plein milieu d’une phrase dont j’ignorerai si elle se clôt d’un point simple, d’exclamation ou d’interrogation.
Après une incursion en librairie – et je ne parle pas des bibliothèques – il me faut des semaines avant de me décider à reprendre ma tâche. Pourquoi écrire, comment prétendre ajouter ne serait-ce qu’un mot à cette immensité de littérature ? Un à quoi bon formidable s’abat sur moi, écrasant mes velléités.
Écrire, quand il y a tant à lire, écrire, perdre du temps qui pourrait être consacré à s’enfouir dans tant de phrases, de merveilleuses phrases ?
Pourtant, chaque fois, l’écriture finit par remonter à la surface. Timidement, je pose mes doigts sur le clavier ou j’attrape un stylo. Quelques mots apparaissent, s’unissent, forment une chaîne qui lentement se déploie et, prenant son rythme de virgule en virgule et de point en point, dessine la muette mélodie de mes pensées. J’écris, seul à seul, réconforté de savoir qu’avant moi, autour de moi et après moi, d’autres, illustres, inconnus, plus ou moins talentueux, ont partagé, partagent et partageront cet étrange besoin de combler le vide d’une feuille en la transformant en page.
Alors qu’importe le destin de mes mots, je m’en suis acquitté, advienne que pourra, que les librairies les dédaignent ou qu’elles les accueillent, ils auront existé.
Ph.B.

Superbe texte, plein d’humour et de vérité
J’adore, tout simplement.