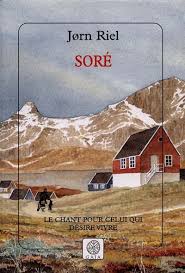L’étreinte du merveilleux
À propos du Chant pour celui qui désire vive, de Jørn Riel,
par Jil Silberstein
Est-ce cela que leur avaient un jour crié les vieux gesticulant sur l’inlandsis: qu’une fois franchi le colossal pont de glace, parvenus sur une terre que nul chasseur de caribou – de mémoire d’homme – n’avait foulé, ils périraient ? «N’y allez pas !» Etait-ce le sens des paroles arrachées à leurs bouches distordues et qui, à mesure que la troupe progressait dans le sillage des traîneaux, prenait l’allure d’une infime buée ? Pauvres suppliques. Injonctions. Malédictions. Douleur. Vingt mille années plus tard, comment ne pas sentir la folle douleur des anciens qui jamais plus n’entendraient le rire rauque ou flûté de leurs trop hardis rejetons? Fermant les yeux, je peux les voir. Je vois des mères qui se traînent à terre, se blessent cruellement pour n’avoir su convaincre leurs fils ni leurs filles. J’entends se pétrifier le cœur des hommes et retentir l’aboi frustré des chiens restés sur place. Face à l’éclipse, je sens l’effroi s’emparer du chamane tan-dis qu’il dépose son tambour. Je vois le deuil qui s’abat, ourlé de tous les noms qu’on ne prononcera plus.
Ils étaient donc partis – follement anxieux, follement grisés par l’incroyable perspective. S’apostrophant. Crânant. Faisant claquer, avec leurs fouets, des exclamations forcenées. Tenaillés par la faim, hantés par un be-soin d’espaces à leur mesure, ils s’étaient éloignés des contrées familières. Sur les traces du gi-bier ils avaient traversé le détroit de Béring pour s’avancer vers l’inconnu. Certains, alors, avaient couru leur chance vers le sud. D’autres, longtemps, avaient évolué le long des côtes de l’Alaska, ou du nord du Yukon… avant de se risquer vers l’est. Quoi d’étonnant à cette progression quand chaque mythe fondateur parlait de la nécessité des migrations. De la beauté des migrations. De la poignante nostalgie des migrations. Les animaux migraient. Fidèles au grand cercle de l’an, de ses métamorphoses, la nature elle aussi migrait à sa façon. Que l’Inuit, que l’homme vrai, partie prenante de la Création, cesse de migrer, comme les plus âgés s’allongent sur la glace pour y mourir et cesser d’entraver l’avance des cadets… à quoi bon vivre ?
Du temps avait passé. Des siècles. Mais qu’est-ce que le temps en regard des cycles chassant le blanc, le brun, puis le vert tendre de l’été, pour les attirer à nouveau ? Non pas que, pour autant, les saisons se laissent confondre. Première chasse. Premières règles. Premières étreintes sous les fourrures. Première femme ou premier pourvoyeur. Premiers enfants ou premiers drames. Les imprévus. Les accidents. Les morts en chemin. Les épisodes drolatiques. Les mauvaises rencontres avec tel groupe indien ou tel amortortoq – tel esprit terri-fiant. Avec tel animal féroce. L’insurpassable bravoure d’un chasseur. Cet autre qui était femme et homme à la fois. Ou qui s’en fut vers l’outre-monde pour y soustraire un nouveau-né défunt. Et les furieux blizzards. Et les famines. La tenaillante attente du gibier dont dépendait la vie… jusqu’à ce qu’un beau jour, retentisse ce cri: E-then ! E-ten thie ! «En l’espace d’un instant, ils étaient tous dehors. Et ils virent à l’ouest un grand troupeau de caribous, mené par une femelle gris-blanc. Elles les dirigeait vers le sud avec grande assurance. Des loups flanquaient le troupeau et derrière trottaient de petits groupes de renards. Au-dessus des caribous volaient des nuages de corbeaux noirs.» Sauvés ! Alors les hommes qui s’élancent. Les femmes allègres qui apprêtent le festin. Autant d’histoires bénies aux yeux d’un peuple pour qui «le don de raconter était un des plus grands cadeaux qu’une personne puisse recevoir des esprits, puisque ceux-ci ne pouvaient se faire entendre qu’au travers des conteurs».
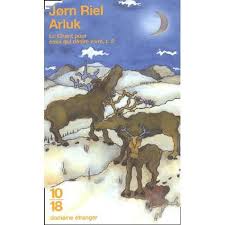
Que des générations persistent à téter le lait grisant des exploits et des combats passés… il se trouverait toujours un jeune pour diriger les siens vers Apsuma Sukanga. «Il expliqua: le monde, que nous appelons Nunarjaq, est plat, ce que tu peux voir de tes propres yeux. Le ciel est comme une tente et à l’extérieur de la tente se trouve l’univers. Le monde est porté par quatre piliers, et la voûte céleste, que nous appelons Qilaq, par quatre autres. Apsuma Sukanga est le pilier tout au nord. C’est là que nous allons.»

Clamons-le: ces êtres rudes constituaient un peuple d’inspirés. D’où ce fait que, d’appel en appel, il atteignit Inuit Nunat, le Groenland – cette terre que certains avaient vue dans leurs rêves. Accomplie et sereine, la vieille Shanuk s’était alors éteinte. Heq, son fils, avait aussi consenti à la mort: «On a découvert qu’on était prêt, quand l’ours m’a demandé ma vie.» Ayant transmis la longue suite des histoires, Teweeso, la belle-fille, s’était éteinte à son tour. Il y a de ça longtemps déjà. Longtemps ? Mais qu’importe le temps puisque, sur une terre toujours plus investie par les colons danois, ces histoires merveilleuses avaient hanté Arluk – jeune aspirant chamane – avec une violence telle que, contre tout espoir, ressuscitant l’esprit des époques héroïques, il avait entrepris de visiter «tous les merveilleux pays de la terre». Même plus tard encore, après qu’ait retenti le glas des migrations sous la triple contrainte de l’Etat, de la religion et du confort, après aussi que le racisme, l’inaction, l’humiliation, l’alcool et le dégoût de vivre aient engendré les pires turpitudes, viendrait Soré. Son lancinant désir de retrouver les lieux de ses ancêtres. Son goût passionné du voyage. Son don de raconter afin que tout, encore, demeure.
Un hymne bouleversant
Saga liant obstinations, moments de grâce, de tendresse et épreuves traversées par un peuple pour qui la mort familière est «un voyage comme tous les autres», la trilogie de Jørn Riel intitulée Le Chant pour celui qui désire vivre constitue l’une des plus belles tentatives romanesques qui soit. Pas un détail qui ne s’impose comme juste, nécessaire, mûri autant par une connaissance méticuleuse des gestes et des faits que par l’esprit et l’émotion.
Mémoire des paroles, des rires, des mouvements qui sauvent, qui délivrent un instant du dur privilège de survivre, Heq, Arluk et Soré forment un hymne bouleversant à un peuple du grand froid que l’auteur, Danois, apprit à apprécier durant les seize années qu’il a passées au Groenland. Louange à l’existence, à sa splendeur et à son âpreté première que notre condition de sédentaire ne parvient pas à nous faire oublier tout à fait, cette sidérante réussite permet aussi d’apprécier à sa juste valeur, en ce début d’avril 1999, le fol espoir des Inuit qui viennent de recevoir – enfin – des mains du Canada quelque 500000 kilomètres carrés constituant le Nunavut, une terre rien que pour eux et pour que vive le droit à l’autodétermination.
J. S.