Les voix intimes de l’universel
Une rencontre et un entretien avec Jean Starobinski,
par JLK, en 1996.
Evoquant sa longue amitié avec Jean Starobinski, Yves Bonnefoy écrivait il y a quelques années que l’essayiste genevois était de ceux qui ne cessaient de lui prouver, dans une «continuité chaleureuse», que «la raison et la poésie ne sont pas ennemies, bien au contraire». Le poète disait aussi la part prépondérante du simplement humain chez le penseur, n’oubliant jamais la «priorité du mot ouvert de l’exister quotidien sur la lettre close du texte». Or c’est à ce double point de rencontre, de l’intelligence claire et des fulgurances intuitives, mais aussi de la simple vie et de sa ressaisie par les œuvres, que nous ramène incessamment, en effet, cette parole d’empathie et d’ouverture, de pénétration sensible et d’encyclopédique connaissance.

– Vous souvenez-vous de votre premier acte intellectuel qui puisse être dit «créateur» ?
– Ce furent d’abord des envies de traduire. Du grec ancien (L’éloge d’Hélène), de l’allemand (Kafka, Hofmnanstahl)… Mon goût d’écrire s’est éveillé moins à l’appel des textes qu’à celui du monde. J’ai fait ma petite classe d’écriture, cahin-caha, en écrivant des chroniques de la poésie dans la Suisse contemporaine, entre 1942 et 1945. J’essayais d’être à la hauteur des circonstances. J’attribuais sans doute trop de pouvoir à la poésie.
– Qu’est-ce qui, selon vous, distingue fondamentalement l’écrivain de l’écrivant ? Et quand vous sentez-vous plutôt l’un ou plutôt l’autre ?
– Je ne me sens pas concerné par l’opposition, établie par Barthes, entre ceux qui écrivent sans souci de la forme littéraire (les «écrivants«) et les écrivains préoccupés par l’effet esthétique. Mon propos n’est pas de manifester une singularité littéraire. Je cherche à transmettre ma réflexion le plus nettement possible. Il y faut un très sévère travail sur le langage. Et il faut savoir effacer les traces du travail. A quoi ai-je abouti ? Je n’en sais trop rien.

– «Création et mystère forment le trésor de Poésie», écrivait Pierre-Jean Jouve. Or la critique peut-elle saisir et dire le mystère ?
– Le propos de Jouve est lui-même de la critique. La fonction du critique est d’aviver la perception du «mystère» poétique, d’apprendre au lecteur à mieux s’y exposer. Au reste, savoir quelles ont été les règles du sonnet, ou celles de la fugue, ce n’est pas faire outrage au mystère de la poésie ou de la création musicale. Bien au contraire.
– Avez-vous essayé ce qu’on dit «la fiction», ou la poésie, avant ou à côté de votre œuvre d’essayiste ?
– Sporadiquement. L’essai en prose m’a convenu. Je suis ferme-ment convaincu qu’une espèce de beauté peut résulter de l’invention d’une recherche – du parcours et des justes proportions de l’essai. Le grand livre de Saxl et Panofsky, Saturne et la mélancolie, ne donne-t-il pas l’impression qu’il peut exister un lyrisme de l’érudition ?
– Vous sentez-vous participer d’une filiation littéraire ou scientifique ?
– Les exemples de Marcel Raymond, de Georges Poulet, de Roger Caillois, de Gaston Bachelard, de Georges Canguilhem, d’Ernst Cassirer, etc. ont compté lors de mes débuts. Puis j’ai tenté d’inventer mon parcours. J’accepte qu’on dise que mon désir de comprendre s’inscrit dans la filiation de la philosophie des lumières. Je n’éprouve en tout cas aucun attrait pour l’irrationalisme raisonneur si répandu à notre époque.
– Y a-t-il un livre particulier, ou des auteurs, auxquels vous revenez régulièrement comme à une source ?
– Je suis beaucoup revenu à Rousseau. Mais sans le considérer comme ma source. C’est un irritant.

– Y a-t-il à vos yeux, malgré les formes d’expression variées, un «noyau» central commun à l’expression artistique ?
– Je tente plutôt d’écouter le son particulier de chaque voix, de percevoir le caractère particulier de la relation au monde et à autrui que chaque œuvre (ou groupe d’œuvres) établit. Nous unifions aujourd’hui sous la notion moderne d’art, des manifestations dont l’intention était très diverse: magique, religieuse, fonctionnelle, didactique, ou dégagée de toute finalité.
– Dans quelle mesure la littérature et la peinture peuvent-elles se vivifier mutuellement ? Et peut-on définir le «moment» où la première tendrait plutôt à parasiter, voire à stériliser la seconde ? Y a-t-il un «pur moment» de la littérature ou de la peinture ?
– Assurément, la lettre (que ce soit celle de la Bible, des mythologistes ou des historiens) a longtemps précédé et commandé l’image.La peinture d’histoire a survécu jusqu’à notre siècle, en se renouvelant et se métamorphosant, jusque dans l’art surréaliste. D’autre part tout un secteur de l’art d’avant-garde, qui ne suscite que peu de plaisir sensoriel, est inséparable des dissertations, souvent des boniments, qui l’expliquent et le légitiment. Avec un mode d’emploi sophistiqué, on peut proposer les pires pauvretés. C’est là que j’éprouve le plus vivement l’impression de «parasitage». Mais il y a, heureusement, des œuvres de peinture qui établissent un rapport au monde et au spectateur sans passer par des relais intellectuels arbitraires. Je ne veux donc en rien jeter l’interdit sur une peinture qui «pense». Ce fut le cas de Poussin, de Delacroix, de Cézanne, de Klee…

– Les écrivains forment-ils une catégorie à part dans la critique d’art ?
– En France, la critique d’art est née avec le discours des artistes eux-mêmes, et avec Diderot. La ligne de crête de la critique d’art passe par Baudelaire. Ce sont des écrivains, et parfois des philosophes qui ont su poser, mieux que d’autres, le problème du sens de l’art. L’admirable Giacometti de Bonnefoy en est la preuve la plus récente.
– Comment un thème cristallise-t-il dans votre processus de réflexion ? Qu’est-ce qui vous a fait, par exemple, vous intéresser particulièrement aux rituels du don ? Pourriez-vous désigner le fil rouge courant à travers votre œuvre ?
– Les thèmes qui me retiennent sont des composantes simples de la condition humaine: la perception que nous avons de notre corps, la succession des heures de la journée, l’acte du don, l’opposition du visage et du masque, etc. Je les considère à travers la diversité des expressions concrètes que j’en puis connaître, selon les moments de l’histoire. Ce qui me met en alerte, ce sont les contrastes, les différences, les mises en œuvre qui varient à travers les divers moments culturels. Il s’agit donc de thèmes qui sont d’un intérêt très large, et dont les expressions révolues, les évolutions récentes pourront, si possible, mieux mettre en évidence notre condition présente. Pour ce qui concerne le noyau originel du livre sur le don (Largesse), mon attention s’est éveillée en constatant la répétition d’une même scène d’enfants pauvres qui se battent, en se disputant des aliments qu’on leur jette, chez Rous-seau, Baudelaire et Huysmans. Il a fallu interpréter, développer une explication historique, réfléchir sur le système de rapports violents qui se manifestait dans ces textes. Des avenues s’ouvraient de toute part, avec, à l’horizon, les pauvres de l’âge moderne.
– Votre expérience en psychiatrie a-t-elle constitué un apport décisif à votre travail d’interprétation ?
– L’expérience du travail psychiatrique a été brève (à Cery, en 1957-1958). Mais j’en ai beaucoup retenu, pour mes activités ultérieures. La maladie mentale se manifeste en altérant la relation vécue. Ce qui est mis en évidence par la maladie, ce sont les états-limites, les souffrances de la relation. Mais il ne s’agit pas d’une relation différente de celle qui entre en jeu dans la vie normale, ou dans l’imaginaire de la fiction. La perturbation mentale révèle l’édifice de l’esprit humain (sa fragilité, ses excès, ses déficits).
– Avez-vous le sentiment d’écrire en Suisse et de participer de la littérature romande ?
– Je me sens Genevois, donc Romand, donc Suisse, donc Européen. J’avoue (en ce qui me concerne) ne pas bien savoir où commence et où finit la littérature romande. Mais il y a une cause à défendre: celle de nos compatriotes qui sont de grands écrivains de langue française (Ramuz, Cingria, etc.) et qui ne sont pas encore suffisamment reconnus et lus en France.
– La critique a-t-elle une fonction particulière à jouer dans l’univers de «fausse parole» que représente souvent la société médiatique ?
– L’analphabétisme gagne. Et l’antiscience (ou la pseudo-science). Il faut que des critiques, «littéraires» ou des «philosophes», s’obstinent à protester. Au temps du nazisme, la revue Lettres, à Genève, a pris pour épigraphe cette phrase que j’avais trouvée dans Vauvenargues: «La servitude abaisse les hommes jusqu’à s’en faire aimer». On peut le redire des diverses dégradations de notre temps qui se propagent au nom du «goût du public», de la «liberté d’expression» ou (en d’autres pays) de l’«identité nationale».
– Quel est selon vous, et particulièrement aujourd’hui, l’honneur de la littérature ?
– L’honneur de la littérature ? C’est de viser plus haut que le succès littéraire.
– Y a-t-il un jardin secret personnel dans votre œuvre ? Écrirez-vous des Mémoires ou nous cachez-vous un monumental Journal intime ?
– Mon seul jardin secret: des textes autrefois publiés en revue, qui ne me satisfont pas, mais que je n’oublie pas, et que je garde en instance de révision en attendant de les publier pour de bon… Parmi ceux-ci, quelques rares poèmes.
– Pasternak disait écrire «sous le regard de Dieu». Avez-vous le sentiment d’écrire sous un regard particulier ?
– Ecrire sous le regard de Dieu, quelle garantie ce serait ! Je n’ai pas cet orgueil. «Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur»…
Questions posées par JLK

De l’essai comme un art
Un préjugé d’époque fait qu’aujourd’hui tout romancier, même médiocre, se voit qualifié de «créateur» et considéré dans les dictionnaires de littérature, tandis que l’essayiste y garde figure secondaire, sinon négligeable. Or comment ne pas voir que l’essai figure parfois le genre le plus ouvert, où l’écriture la plus inventive se donne cours, de Montaigne à Rozanov ou, plus proches de nous, de Charles-Albert Cingria à Jean Starobinski ?
Le rapprochement de ces deux derniers noms est moins saugrenu qu’il n’y paraît, et non seulement à cause de la ferveur avec laquelle le cadet a célébré l’aîné. Mais l’érudition joyeuse, l’ouverture à de multiples disciplines, la circulation entre les cultures européennes variées, apparentent ces deux grands Genevois malgré tout ce qui les différencie quant au tempérament, aux sujets qu’ils traitent respectivement et, surtout, à la découpe de leur écriture.

Il est évidemment de bon ton de considéer Jean Starobinski comme un spécialiste suréminent. Ses titres académiques multiples l’attestent, et quelques grands prix. Pourtant c’est dans une autre perspective que nous aimerions situer le lecteur merveilleux, le sensible écrivain, l’érudit aux mises en rapport si éclairantes (encore une parenté avec Cingria), et le moraliste, le quêteur et le donneur de sens.
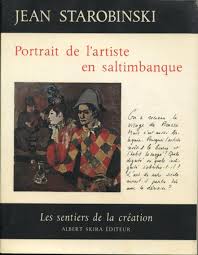
Que lire alors de Jean Starobinski pour qui ne l’aurait pas encore abordé ? Pour commencer par la fin: lire Largesse, magnifique méditation anthropologique sur les rituels du geste donateur dont les motifs se font écho de la littérature aux arts plastiques, ou de la philosophie à la religion, publiée en 1994 à l’enseigne de la Réunion des musées nationaux. Là joue le plus librement l’art de l’essayiste, où le commentaire «en marge» devient parole d’unification. Mais aussi: lire Montaigne en mouvement (Gallimard, 1982) où Denis de Rougemont voyait justement une sorte d’autoportrait indirect. Lire La relation critique (Gallimard, 1970) et L’œil vivant (Gallimard 1961), pour remonter aux sources vives de l’œuvre critique, ou encore Portrait de l’artiste en saltimbanque (Skira, 1964) autre belle variation fuguée de l’essayiste grappillant sur les sentiers de la création…
JLK
(Le Passe-Muraille, No 26, Octobre 1996)


