Les beaux jours

Suite autobiographique de Fabrice Pataut

12
Delabordère, encore
Il est temps je crois de faire une pause, d’oublier rien qu’un peu la deuxième adresse, jusqu’à l’île et son eau verte, gracieuse et trouble, de laisser respirer à son aise et pour le pur plaisir ce lieu rêvé de vie parallèle, cette rue Delabordère si neutre dans sa facture et si étonnante par sa perfection consolatrice. Rien n’y est — comment dire ? — formellement décidé. Tout y est sereinement stable, en attente de fracture, notamment tout ce qui plus tard me tiendra éveillé suite à la mort des protagonistes, et même longtemps avant, une fois faites les premières vraies lectures qui sont comme les premiers baisers. Le goût s’attarde sur les lèvres, parfume depuis ce fragile promontoire doux comme les fraises le corps tout entier. J’y suis encore vierge, ne lisant rien, enfin rien qui nuise ou compromette, facilement convaincu par les conseils bienveillants — et encore, je n’y crois pas trop. Mais c’est sans importance. On se doute bien que je ne suis pas tout à fait dupe, que j’ai un tour dans mon sac. C’est donc encore une chambre d’enfant, et le premier signe que l’enfance est révolue est que la deuxième chambre avec vue sur le chevet de Notre-Dame de Paris n’a ni coffre ni mappemonde, mais plutôt une grande table qui fait figure de bureau, sur laquelle viennent se poser d’eux-mêmes début septembre un livre de latin et un autre de mathématiques.
Avant, maman dort à côté dans une pièce qui sert à parts égales de salon et de bureau, une belle pièce fortement lumineuse où est installé son desk en palissandre de la Maison danoise depuis lequel, assise derrière ses dossiers, une boîte à timbre en argent embossée de dragons chinois et une autre en ébène mat qui sert pour les trombones posées côte à côte, elle concocte toutes sortes de fantaisies immobilières destinées à nous faire vivre tous les trois dans un confort qui va de soi. Rien n’est trop cher, ni d’une qualité reservée à quiconque serait élu, ni si loin des conséquences inattendues de sa volonté inflexible qu’il ne puisse un jour nous faire le plaisir d’être nôtre. Grâce à quelques codicilles qui font de parfaits intrus les uniques héritiers de biens de famille, l’appartement de la rue Delabordère, qui a sa vie propre, son autonomie, une âme à soi et des murs très blancs, se peuple de choses de marque, d’artéfacts de prix et de matières nobles sans que rien n’y paraisse trop. Il nous fait des mimiques, des sourires en coin et de ces petits gestes impudiques des maîtres qui imitent innocemment les gens de maison à force de vie commune et pour ainsi dire conjugale.
Je n’ai encore aucune obligation, les jours passent comme enchâssés dans une douce nonchalance qui aurait la couleur dorée des cadres en citronnier. Ce n’est qu’après, dans l’Île, que je m’égare cent fois, que des efforts sont nécessaires et que le profil net et dessiné d’un but à poursuivre se construit, qu’on doit s’efforcer d’atteindre et qui dépasse de loin ce qu’une vie pleine d’embûches nous réserve dans sa phase sublunaire. Il y a une loi à respecter, sans nul doute plusieurs, organisées dans une sorte de Pentateuque inflexible dont la lecture et la morale restent fermées aux imbéciles, des obligations dont on se dit avec quelque difficulté qu’il faut s’y soumettre bien qu’elles n’auront pas leur sanction dans la vie présente. Mais avant, puisqu’il y a aussi bien un mais qu’un avant, ah non, pas du tout, les bouquets sont des bouquets, les petits mensonges des petits mensonges et ainsi de suite, d’autant plus qu’une vaste multiplicité de gestes féminins s’emparent des choses de la vie avec une indéfectible grâce. Les doigts de Sidonie qui s’affairent aux moules et aux cuillers, remettent le col de ma veste, pressent ma paume au moment du départ, ceux de maman qui poussent le levier de vitesse en avant, le tirent en arrière et le forcent enfin sur le côté droit, le bras allongé sur le dossier de mon siège pour garer comme il faut la décapotable lorsque nous sommes arrivés à tel restaurant, à tel salon de thé, à tel grand magasin, protégés par des mitaines de conduite en cuir fauve trouées aux articulations, et qui glissent pour défaire mes cheveux après avoir serré le frein à main. C’était pour rire, bien sûr, elle les recoiffe et Paris est à nous.

Un fil toujours nous relie à notre rue préférée où rien ne se passe, une rue vierge pour un immeuble neutre aux paliers encaustiqués, à notre étage, à notre porte qui est tout à fait comme la porte d’un coffre dont le jeu de clefs est en deux exemplaires. Et derrière la porte et la salle d’eau aux chaudes vapeurs, il y a encore et toujours la chambre et le bureau à mappemonde, avec, posés sur le sous-main d’enfant imité des vrais sous-mains pour grandes personnes, des notes, des dessins avec des titres, des dialogues, des historiettes. Agité par une volonté de datation et de classement, peut-être sous l’effet d’une peur que ces choses sans prix se froissent et se perdent, j’en fait des petites piles organisées par genre que maman glisse dans des enveloppes pour notre postérité comme elle fait avec les photos de son passé que je connais pas, le passé de Tel-Aviv et celui plus ancien encore de la rue Vaneau. Toutes ces notes et dessins sont quant à eux du temps de la rue Delabordère, un temps hors du Temps qui ne passe ni s’étire, reste sagement figé et attend que quelqu’un vienne lui dire ses quatre vérités. Les mots jetés là sont encore astreints à leur fonction utilitaire. C’est à peine s’ils disent plus ou autre chose que ce à quoi les dictionnaires les destinent. En scribouillant par drôlerie, je dévie à peine, petitement (quoique…) de l’usage.
F.P.
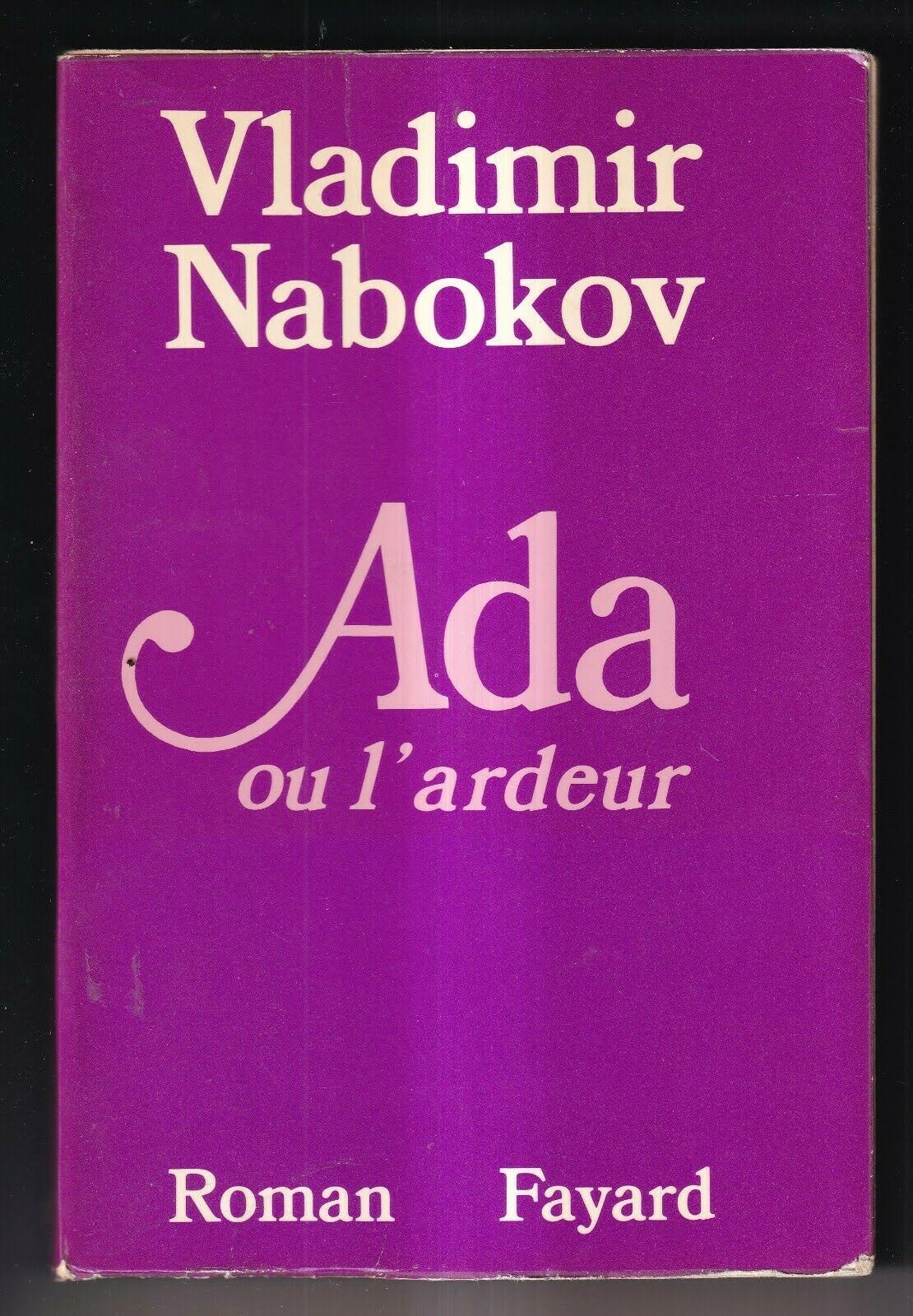
CODICILLE AU BEAUX JOURS
La fin des Beaux Jours rend hommage à l’année 1975, l’année fastidieuse du baccalauréat. Je révise, c’est entendu, mais je me laisse plus encore volontiers promener en voiture par maman avec Ada posé sur la banquette arrière. Il y a entre nous une entente silencieuse. Je dois travailler pour un diplôme qui m’ouvrira les portes d’une classe préparatoire. Mais il y a bien d’autres choses contre lesquelles le baccalauréat, les honneurs, les mentions, sont impuissants. De temps à autre, à la faveur d’un embouteillage ou du faux bond d’un client désinvolte, maman me fait la lecture. Et sa lecture de Nabokov est assez drôle, fluide et même tout à fait désinvolte. Elle va en sens inverse des révisions et de l’esprit de sérieux. Maman ne bute jamais, ne manque pas d’être théâtrale quand il le faut, comme si la voiture tenait lieu de chapiteau ambulant. Cette lecture fidèle au ton moqueur et nostalgique joue avec l’idée que ce qui se passe dans Ada vaut plus que la réalité lassante de l’année du bac dont on voudrait qu’elle soit close aussitôt entamée.
Cette valeur fictionnelle est attestée par la musique des phrases, par leur valeur mélodique, tantôt musette, tantôt lyrique et passionnée. Où alors la voix de maman leur prête-t-elle ces qualités. Le livre est posé sur le volant comme sur un pupitre, le soleil tombe sur la page si nous sommes garés du bon côté de la rue avec les fenêtres ouvertes, ou alors les passants nous regardent-ils faire du côté opposé, à l’ombre fraîche, fenêtre relevées, immobiles comme deux poissons dans un aquarium.
J’essaye de retrouver beaucoup plus tard cette musique particulière, d’écouter rétrospectivement le son de sa voix sans faire attention au sens de ce qui est dit, comme si maman parlait hongrois ou mongol. Un autre aurait enquillé des kilomètres de prose nabokovienne sans broncher. J’essaye plutôt — c’est souvent peine perdue — de retrouver chacun des instants qui ont conduit à cette lecture, le rituel qui a précédé le concert privé : le livre glissé en douce dans le sac, la descente en ascenseur jusqu’au hall de l’immeuble, la lumière orangée de la rue, comme voilée par un store entièrement baissé, l’ouverture de la portière, les feux rouges, la couverture violette à rabas. C’est une tâche vaine et impossible. Tout : ascenseur, hall, portière, claquement des talons sur le pavé, sont faits d’une écorce impossible à peler. Nous pourrions aussi bien être allongés sur un plaid à la plage, ou assis en montagne à la terrasse d’un châlet suisse avec le même livre à la couverture violette, dangeureusement épais. Ses pages sont faites d’innombrables lignes qui se serrent les unes contre les autres, ses paragraphes ont une densité inhabituelle. En voiture, au bord de la mer, sous les sapins, où que nous soyons, l’égrenage est impossible. Il faut tout prendre d’un geste lent, tout garder dans la main, dans la bouche, jusqu’au bout.
Le voyageur de la nouvelle « Invitation à un remontage » du Cas Perenfeld essaye de retrouver quelque chose de la même nature. « Nous en arrivâmes enfin (avoue-t-il en évoquant le souvenir d’une salle de concert de Budapest) aux deux chansons d’automne de Béla BartÓk, aux belles allitérations de Az Öszi Lárma et de Az Agyam Hivogat, puis enfin au merveilleux chant de la mer, Egyedül A Tengerrel, brave et nostalgique, avec ses douces et suaves répétitions de « dalol » et du minuscule « dalolo », perdus là comme des gouttelettes à l’avant-dernière strophe alors que les vagues grondent et se font sauvages. La recollection fut alors consommée. »
Vraiment ? Est-ce seulement possible ? Peut-on se reconstituer à ce point ? Le voyageur avait été morcellé ou, si l’on préfère, réparti en différents endroits de sa valise (un coup un bras, un coup une jambe) dans une nouvelle précédente intitulée « Invitation à un démontage ». Où ? Dans un compartiment de train. Par qui ? Précisément par la soprane qu’il va écouter en roulant comme il peut jusqu’à son fauteuil d’orchestre le soir du concert. La même exactement, qui lui donne les forces nécessaires pour tout revisser et remboîter.
Et puis, il y a tout ce qui vient après ce petit paradis perdu quand la bougie est soufflée. Une fois Ada lu en entier de première main (puisque j’ai suivi les conseils de maman), j’ai renvie de relire Naissance de la tragédie. Je ne le fais pas comme un wagnéromane. Au contraire. Quand je relis Naissance, c’est comme si Nietzsche avait toujours préféré Bizet à Wagner sans qu’une conversion esthétique lui eût été nécessaire. C’est tout de suite méditérannéen — à cause de la voix.
Ce n’est pas ma voix silencieuse et intérieure qui relit, mais une autre, une voix proche de celle qui m’a donné les passages d’Ada choisis pour leur license, leur poésie et les rigueurs de leur humeur fantaisiste. Pas exactement la même, d’ailleurs, mais plutôt une voix qui s’éloigne peu à peu du grain et du timbre de l’original au fur et à mesure que ma lecture progresse.
Cette fuite prend ses aises. Ce n’est bientôt plus qu’une résonance très faible, un écho, un fil. Il aurait peut-être mieux valu trancher avec un sabre, mais le Temps fait les choses autrement, sans respect pour la continuité, les causes et les effets, la peur affreuse d’avoir tout perdu. Le désordre est tel qu’une fois Naissance de la tragédie refermé, c’est moi qui prend les devants. Sans doute ai-je lu ensuite des livres que maman n’aurait ni aimé ni même compris. Ces livres-là sont par la force des choses faits d’une autre matière sonore. Plus claire, cristalline ou cuivrée, mais aussi plus faible, sans aucune des modulations qui rendaient l’histoire d’Ada si mystérieuse et me l’offraient pleine de difficiles promesses.
Le Cas Perenfeld, Pierre-Guillaume de Roux, 2014
Les beaux jours, Héliopoles, 2022.
