L’enfance d’un poète

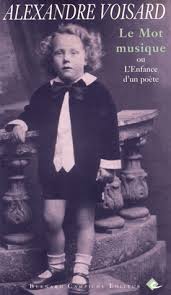

Un extrait inédit du récit autobiographique d’Alexandre Voisard, Le Mot musique
Ce qui domine la scène, dans l’évocation de ma première enfance, ce qui me revient avec insistance est une image de nature occupant tout l’espace. Alors que le paradis d’enfance se révèle comme menu et fragile (un mouchoir de poche, un bateau de papier), ce paysage qui le contient, comme une grande peinture dont l’encadrement a été gommé, déborde de partout avec ses forêts profondes, ses rus jaillissant des flancs de la montagne et ses rivières échevelées au long des plaines, ses villages étirés à n’en plus finir…
Il y a des fleurs à profusion, même dans la neige et le froid, sur les murs et parfois jusqu’au plafond, les bêtes innombrables s’y poursuivent et dansent, des plus petites aux plus grandes elles produisent des sons en se frottant les unes contre les autres et c’est une musique aigre et douce, ample et soyeuse, étrange et cocasse qui enveloppe toutes choses et vibre entre les clochers, les fils électriques et les hauts sapins jusqu’au ciel. La musique, la musique qui était partout et non seulement vers les cimes, qui gagnait les pro-fondeurs et les ventres, les pieds et les chemins hantés de chars à grandes roues et de sabots ! Sur ce panorama enfantin dégingandé, je portais un regard insistant et ébloui mais je continue à me demander si, au fond, mes premières émotions ne me vinrent d’abord à l’oreille, c’est-à-dire en caresses musicales, comme des appels d’amour infiniment modulés en tous lieux, du jardin au grenier et de la forêt au lit. Ce goût d’irréel que retient la mémoire et qu’elle sous-titre aussitôt magie doit sans doute sa survivance à cette capacité d’étonnement qu’entretinrent en moi les leçons de choses que père improvisait toujours à bon escient et sans insistance, à la manière d’un récit qu’on écoutait bouche bée. La science alors était entendue telle une ritournelle charmante qui, à me la remémorer, s’affiche comme le tableau des premières connaissances dont je tapissai mon subconscient…
Que ces éboulis de réminiscences soulèvent de poussière ! Que de rumeurs et de photos floues, que de précipités à la hauteur du coeur ! Et que de mots surtout, des mots dansant en fanfare avec les objets familiers, en harmonie valsant avec un univers inconnu qui venait à moi en grappes de mots sans autre réalité que cette pure musique dont je m’assure qu’elle fut cause, sans aucun doute, de mes toutes premières ivresses. Ô iris et mésange… alouette et luzerne… colimaçon et orpin… Ô tourterelle et mélilot, palissade et serfouette, aubépine et sittelle, Ô framboise! Carnaval et scarabée, vive l’étoile d’araignée!
J’aimais le mot cornouiller, pour lui-même, et il aurait pu tout aussi bien désigner une vague friandise qu’un certain lézard, peu importait puisque le mot, comme bien d’autres de cet acabit, s’énonçait en bouche avec gourmandise. Chèvre-feuille et aquarelle, tournesol et fauteuil avaient des résonances de violoncelle. Puis, en écoutant les voisins s’exclamer ou chuchoter sur le pas des portes, la musique s’enrichit d’elle-même.
— Vos caramels, madame Fluc, une vraie délicatesse !
— Oui, monsieur Mario, mais vos chanterelles nous ont enchanté l’estomac, un régal!
Donc, père enseignait que chaque chose comme chaque être vivant sur la terre comme au ciel portait un nom qui les distinguait de tous les autres. Que toute chose nommée avait une importance et un rôle. Que tout ce qui avait un nom devait être préservé. C’est en apprenant à donner un nom aux choses, comme on nommait les gens, que le monde peu à peu prit un sens. Et puisque ce monde avait dès lors un sens grâce aux mots, il faudrait ne jamais les oublier. On apprendrait à les faire reluire et resplendir sur chaque chose, sur chaque sentiment humain. Plus tard nous viendraient le goût et, à force de travail, peut-être aussi le talent, de les faire jaillir et crépiter au long de phrases flamboyantes et nécessaires…
À chaque instant de notre existence tranquille, on apprenait quelque chose de lumineux sans que père impose la moindre contrainte de rabâchage. Il disait : « La mousse vient aux arbres du côté du vent, et si tu connais le côté du vent tu sauras toujours te repérer dans l’inconnu. » Je m’étais promis d’y aller voir un jour. Seulement, à chaque fois, dès que j’étais au bois, bien d’autres pensées m’occupaient l’esprit, comme ce qui, justement, survenait à tout instant sous mes yeux, un cri de buse dans les frondaisons, une fourmilière en goguette, un levraut débusqué des ronces, la senteur du muguet…
Un après-midi d’été, je devais avoir six ans, je m’étais équipé pour une expédition au loin qui serait une aventure. Pain et chocolat dans la musette, canif en poche, sans oublier les allumettes pour le bivouac qui commencerait à la tombée de la nuit. Quelques heures s’écoulèrent durant lesquelles je ne fis guère que récolter la provision de bois mort destinée au feu que j’allumerais plus tard. Et sans doute meublai-je le temps en rêvant beaucoup. Alors que le jour commençait à baisser, j’entendis, à l’orée du bois en lequel j’avais pris mes quartiers, des appels répétés qui se rapprochèrent et où je reconnaissais à la fois mon nom et les voix conjuguées de maman et de ma soeur Line.
Celles-ci me trouvèrent donc assis en tailleur à côté de ma musette. Devant moi, sur une pierre, j’avais installé une bougie vierge.
— Mais qu’est-ce que tu fais là ? s’exclama ma mère stupéfaite. La nuit vient et on te cherche partout…
— J’attends, répondis-je avec le plus grand naturel, que la nuit arrive pour allumer ma bougie.
Si le vocabulaire me vint en musique, le nom des choses établit l’évidence des rapports qu’elles entretenaient entre elles. C’est ainsi que je devins curieux de tout, comme bien des enfants de mon âge. Je voyais père comme un puits de science connaissant tout sur tout et je ne tarissais pas de questions. Tout instituteur qu’il fût, il refusa toujours obstinément d’avoir ses propres enfants en classe sous sa férule. Son enseignement buissonnier n’en fut dès lors que plus chaleureux et familier.
Il me répondait toujours, sauf quand il était « dans la lune», absorbé par ses propres
pensées, ce qui n’était pas rare. Il répondait parfois probablement avec malice sans que je m’en rende compte, mais jamais comme d’autres grandes personnes qui à votre question vous rembarraient sèchement.
— C’est quoi, une angine?
— De la graine de curieux!
Il est vrai qu’on considérait toute curiosité enfantine comme un défaut qu’il fallait réprimer. Les questions se posaient à l’école, pas dans la rue. Belle sagesse ! Grâce à Dieu, notre route fut parsemée de rencontres décisives avec des contrebandiers et des braconniers qui, tel notre paternel, se révélèrent d’éblouissants passeurs, à la barbe des tenants de l’ordre et des usages consacrés.
M’est resté le souvenir brûlant d’un après-midi de juillet… Je devais avoir six ans et je jouais derrière la maison (une maison à plusieurs familles oit nous vivions, à six et bientôt huit, dans quatre petites pièces) pendant que père non loin jardinait posé-ment, prenant son temps pour affiner son terreau en binant, sarclant, émiettant les grumeaux de terre entre ses doigts, parmi ses plates-bandes où poireaux et oignons étaient alignés au cordeau, à la perfection comme des petits soldats toujours prêts pour la revue. Aucune peine, en jardinage, n’était inutile ni aucun soin de trop…
Tandis que père s’en prenait aux mottes, je lui posais toutes questions que m’inspi-rait ma rêverie devant celui qui maniait et gouvernait la terre. Et celle-ci jaillit en toute innocence: Qu’est-ce qu’il y a dans la terre?
— Il y a des vers, il y a des insectes, des souris…
— Quoi encore?
— Il y a d’autres sortes de terre, plus bas, de l’argile, cette terre qu’on mouille pour en faire des modelages.
— C’est tout?
— À peu près… Et au fond, alors vraiment tout au fond, il y a le coeur de la terre.
— Le coeur? On peut le voir, le toucher ? — Il est si loin… Mais si tu creuses assez, avec de la patience…
Voilà qui était bien singulier. Dans ce jardin, sous cette terre, derrière notre maison… Mon imagination fit des bonds. Je trouvai une piochette dans la remise à outils. Sans délai, j’entreprenais des fouilles au pied de la maison où le sol était sablonneux et pas trop difficile à creuser. Si la terre a un cœur, on allait le vérifier. Devant un tel projet grandiose, un chercheur inspiré et instruit considérerait comme incongrue toute prudence et absurde la moindre retenue. En avant pour la découverte au bout de l’aventure. Je grattais le sol, je creusais, écartant les pierres, voilà, j’y entrais dans cette terre, en ces entrailles mystérieuses. Et bientôt je m’arrêtai, stupéfait. Une forme flasque de la grosseur d’une noix gisait dans la petite cavité que ma piochette avait creusée. Après une hésitation, je saisis délicatement la chose qui dans ma main semblait imperceptible-ment battre en répandant une douce chaleur. Presque aussi-tôt me vint la certitude qu’il s’agissait d’un coeur, du coeur même de la terre dont père m’avait parlé. Mais l’émotion était si intense devant une découverte aussi soudaine et capitale que je fus saisi de panique. J’enfouis à la hâte le coeur dans le creux où il était apparu et le recouvris de gravier puis je pris mes jambes à mon cou jusqu’à la cave de la maison en balbutiant, comme ivre : «Le coeur, j’ai trouvé le coeur de la terre. » J’aurais dû être heureux et fier, j’étais effrayé et accablé d’un senti-ment de culpabilité. Au lieu de rejoindre mon père au jardin et de lui raconter ce qui m’arrivait, je restai prostré longtemps, longtemps, dans l’obscurité et la fraîcheur qui finit par me secouer de fris-sons. J’avais commis un sacrilège, j’avais dérangé le coeur de la terre, j’avais attenté à l’ordre secret du monde. Cet événement, qui eût pu se restreindre à une anecdote vite oubliée, me tenailla des semaines, des mois, toujours mon geste (le petit coeur d’ans la main) me revenait tel un refrain lancinant, insupportable. Au fait, il ne s’était peut-être agi que du coeur d’un petit animal, qui avait été enfoui là par qui ? Pourtant c’était trop. Pour la première fois de ma vie, j’allais devoir aller de l’avant avec le poids terrible d’une faute dont personne, jamais, ne m’absoudrait. (…)
A. V.
Alexandre Voisard, Le Mot musique ou L’Enfance d’un poète, à paraître le 15 novembre 2004 chez Bernard Campiche Editeur.
Retour à la source

Peu à peu s’était insinué en moi, l’âge venant, le besoin obscur de baliser ma route en amont afin que les miens, les tout premiers, soient enfin au clair sur ce parcours maintes fois évoqué, à demi-mots, en poèmes sibyllins ou à l’occasion énigmatiques. Puis la mort du père mit en branle une remémoration tumultueuse, à laquelle je ne résisterais pas, qui m’imposait de dire vrai avec les mots justes. Le récit qui en est résulté n’est pas une confession désabusée mais l’évocation, sans fards et à grands traits, d’aventures portées par une curiosité et une exaltation incessantes.
La mémoire rompt les amarres, défait ses liens et déferle… Voici le scribe astreint à apaiser, ordonner et insérer dans une cohérence des souvenirs désemparés survenant par-fois en haillons effilochés, aux-quels il faut bien redonner figure. J’ai renoncé à vérifier «sur le terrain» quelque détail que ce soit, de caractère topographique ou historique, m’engageant ainsi à ne recourir qu’à ma seule souvenance, avec ses trous et ses flous au milieu desquels je devais prendre parti. Ainsi, certains détails anecdotiques pourront-ils paraître «arrangés mais je jure que mon récit est foncièrement sincère et de bout en bout authentique.
A. V.
(Le Passe-Muraille, No 62, Octobre 2004)
