Lecture indiscrète
Nouvelle inédite d’Adriana Langer

Lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle maison à Verrières-le-Buisson, en rangeant le sous-sol j’ai trouvé un paquet de feuilles accrochées par une agrafe. Il s’agissait visiblement de notes intimes, et même si la personne qui les a écrites y apostrophe régulièrement le lecteur (non sans une certaine animosité d’ailleurs), j’aurais tendance à croire que ces feuilles étaient destinées à rester privées. Elles portaient un titre intrigant, et dérangeant aussi : « Le jour où j’ai cessé d’aimer mon fils ».
Je les recopie telles que je les ai trouvées (j’ai seulement corrigé les fautes d’orthographe, je ne peux pas m’en empêcher).
« Le jour » c’est un effet de style, vous vous doutez bien que ça a été progressif. Vous n’imaginez pas l’amour d’une mère disparaître en un jour alors que telle une flamme il brûle et résiste à tous les vents, sans faille, jour après jour pendant des années. Il en faut plus pour assécher un tel torrent. Parce que c’en était un. Vous penserez alors que le fils a dû faire quelque chose de terrible. Mais non, pas du tout : il a simplement été lui-même. C’est injuste alors, rétorquerez-vous. Mais oui, mon bon monsieur, c’est parfaitement injuste. Et c’est ainsi.
Mais reprenons depuis le début.
Mon fils est issu d’un viol. Il n’y est pour rien et c’est pourquoi je ne le lui ai jamais dit. Il sait que son père a disparu après sa conception et qu’il ne s’est jamais manifesté. Il doit se douter que c’est un salaud, mais c’est un sujet qu’on n’aborde pas.
Quant à mon viol je ne vous en parlerai pas. Je l’ai suffisamment fait devant les flics, les avocats, les juges, les psys. De toutes façons on n’a jamais retrouvé le type. Et le mal était fait. Et encore, je ne pensais pas une seconde que je pouvais être enceinte ; ça je ne l’ai su qu’après, bien après. Ce n’est pas de la bêtise, mais mes règles avaient toujours été irrégulières, et deux ou trois cycles sautaient facilement pour un rien : un examen raté, une dispute avec mes parents ou avec une amie, va savoir. Jamais compris le rapport entre mes ovaires cachés au fin fond de mon ventre et ce genre d’événement, mais bon, c’est comme ça. Quoiqu’il en soit, si des cycles disparaissaient pour une contrariété, alors un viol, vous imaginez.
Ça paraît idiot, a posteriori, de ne pas avoir fait le lien, mais franchement, ça m’aurait paru aberrant : « too much », comme on dit. Et à vingt ans on pense qu’il y a des limites à tout. Oui, même après un viol. Maintenant tout est beaucoup plus organisé, on vous fait toutes sortes de prélèvements et d’examens, et on s’assure que vous ne serez pas enceinte, mais à l’époque, pensez-vous.
Du coup, quand j’ai réalisé ce que le retard signifiait, il était vraiment trop tard. Je n’ai même pas pu envisager un avortement. C’est peut-être mieux après tout. Malgré les sentiments forcément mêlés que cette grossesse m’inspirait, j’ai décidé que j’aimerais cet enfant. Il était de moi, il était innocent, et il ne connaîtrait fort heureusement jamais son père. Je me suis promise de ne jamais lui parler de ça. Et mes parents ont dû me faire la même promesse.
Le viol lui-même je n’en parlerai pas. Tout ce que je peux dire c’est que des dizaines de séances de psys ne valent pas une bonne nuit de sommeil profond et sans cauchemar. Donc pour moi, après toutes ces années, si je crois en quelque chose, ce n’est pas dans le pouvoir de la mémoire mais dans le pouvoir de l’oubli. Merveilleux oubli, bienfaisant oubli. Il a fonctionné une bonne douzaine d’années. Certes, il y avait des rechutes si on peut dire, mais dans l’ensemble je m’en sortais pas mal. Enfin, on s’en sortait pas mal puisqu’on était deux, Mario et moi.
Les deux premières années j’étais complètement débordée, je ne savais pas où donner de la tête. Il faut dire que j’avais de quoi faire, entre les cris, les réveils nocturnes, les tétées puis les biberons puis les repas, les fièvres, les boutons, les bains, les régurgitations, les dents, les fesses irritées. Et j’en passe. Bref, « les mille bobos d’un bébé normal » (dixit ma mère qui en avait eu trois et ne ratait pas une occasion de se mettre en avant, non sans un reproche dans la voix que je trouvais particulièrement agaçant).
Mais Mario m’adorait. Son premier sourire a été pour moi, bien sûr, et mes parents comme mes amies ont dû attendre plusieurs mois avant qu’il ne leur en adresse aussi. Ce qui, j’avoue, m’a fait grand plaisir. Certes mes parents m’aidaient matériellement, et je leur dois une fière chandelle – sans leur aide ça aurait été beaucoup plus difficile avec mon maigre salaire de secrétaire – mais quelle importance pour Mario ? C’était moi avant tout, moi, moi, moi. Il m’adorait. Même mes amies qui avaient eu des enfants trouvaient impressionnant l’attachement qu’il avait pour moi. Il paraît que j’étais pour lui un « être solaire ». C’est beau, non ? C’est le mari de Jeanne qui l’a dit, et ça m’a longtemps trotté dans la tête. J’étais un être solaire pour quelqu’un, une maman aimée, moi aussi, malgré tous mes déboires. Mario ne voyait aucun des défauts que me reprochaient mes parents ; pour lui j’étais la perfection incarnée. Finalement, on peut dire qu’on était dans notre petite bulle : pour lui j’étais parfaite, et il l’était pour moi. Mario était le bébé le plus charmant, le plus vif, le plus drôle, le plus adorable et câlin. Il me souriait, il voulait que j’approuve tout ce qu’il faisait, il cherchait à me plaire – en mangeant toute son assiette, en essayant de ne pas se salir, en jouant pendant que je faisais du repassage – et ça me rendait folle de joie. Alors je le félicitais, je le fêtais et il riait. Ah, quand il riait comme ça je fondais littéralement. Je regrette pour tous les compositeurs et tous les chanteurs du monde, mais je n’ai jamais entendu une chanson aussi délicieuse qu’un rire d’enfant (et surtout de mon Mario).
Oui, il m’observait et il voulait m’imiter pour tout (si je l’avais laissé il aurait pris l’aspirateur à ma place !). Il voulait toujours obtenir mon assentiment : quand il faisait ou disait quelque chose, son premier regard était pour moi, un regard plein d’espoir et un peu anxieux aussi : allais-je l’approuver ?
Si je me fâchais (ce que je faisais rarement), il me suffisait d’avoir l’air mécontent – pas besoin de cris ou de punition – pour qu’il soit terriblement malheureux. Il se mettait à pleurer et il était inconsolable tant que je gardais la même expression. Personne n’aurait pu résister : je cessais de bouder, je lui souriais, et en lui tout le chagrin était effacé comme par magie ; je le prenais dans mes bras et tout était arrangé. Vous voyez, nos « disputes » étaient rares et très brèves : on ne supportait pas d’être fâchés l’un avec l’autre.
Il faut quand même que je le décrive un peu. Il a les mêmes cheveux bruns et bouclés que moi, et, comme moi aussi, les yeux couleur noisette. Vous ne pouvez imaginer mon soulagement quand j’ai vu ses cheveux et ses yeux foncer dès les premières semaines. Oui, il était comme moi, et tout le contraire de mon agresseur – une espèce de facho aux cheveux blonds rasés de près avec des yeux bleu clair d’un éclat métallique.
Je me souviens du moment où il s’est mis à ramper, puis quand il s’est mis debout, puis à marcher en se tenant aux meubles et aux murs. À chaque fois, son premier regard était pour moi : j’ai réussi, disaient des éclairs dans ses yeux, et ils brillaient d’autant plus fort que je l’approuvais. Un jour, il était debout, une main sur la commode. C’était un dimanche midi, au mois de mars. L’air malicieux, sachant qu’il allait accomplir un nouvel exploit que je ne pouvais qu’apprécier, il a lâché le meuble. Il se tient debout tout seul ! Enhardi par ce succès, et après mes applaudissements inconditionnels, il se tourne vers le mur. Il avance lentement un pied, puis l’autre, à la fois confiant (en quoi sommes-nous différents de l’oisillon qui vole pour la première fois ? l’espèce est là, des milliards d’êtres nous soutiennent) et un peu craintif. C’est lentement et maladroitement qu’il lève un pied, plus serein qu’il le repose, constatant, soulagé, un équilibre sinon parfait du moins largement suffisant.
Je croyais qu’il me chercherait du regard après ce premier pas, mais il a continué. Ça m’a fait un coup au cœur. Ce n’est qu’une fois arrivé au contact du mur qu’il s’est tourné vers moi. Réussir à marcher seul jusqu’au mur était son but, sa priorité, et cet accomplissement comptait plus pour lui que mon enthousiasme. J’aurais voulu qu’il partage immédiatement avec moi le succès de son premier pas, mais il a préféré d’abord l’établir avec certitude par plusieurs autres pas, lui, tout seul. C’est normal peut-être, mais je ne passais plus en premier. C’était à peine une blessure, le cours normal des choses, je sais ; mais la brèche a peut-être bien commencé là, après tout, par ces premiers pas, seul, qui m’ignoraient.
Il y a eu la crèche, la maternelle, puis l’école. Au début il avait du mal à me quitter le matin. Moi je suivais les conseils des institutrices : surtout, ne pas se retourner après le baiser d’au-revoir et la porte franchie. Mais comme c’était difficile ! Quand elles m’ont dit qu’il me suivait des yeux, derrière la vitre, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus m’apercevoir, ce n’était plus difficile, c’était juste impossible. C’est physiquement que je sentais son regard planté dans mon dos, comme une brûlure (une brûlure pour lui, une autre pour moi). Alors, avant de disparaître derrière la grille, je désobéissais aux instructions et, me retournant, je lui faisais un dernier coucou. Il l’attendait, et sans qu’on ait eu besoin de se concerter il me faisait en retour un de ses beaux plus sourires, avec un signe de la main.
Il s’est quand même bien adapté à la vie de groupe, et il avait des petits copains qui venaient à la maison ou chez qui il était invité à jouer. Bref, tout se passait plutôt bien. Mes parents étaient rassurés, après toutes les frousses qu’ils ont eues avec moi, et on les comprend.
Il paraît (une collègue qui en souffrait me l’a dit) que les extrasystoles, des battements anormaux du cœur, existent chez nous tous, mais seuls quelques-uns les ressentent. Soit qu’ils en ont trop, soit qu’ils y sont très sensibles. Mon amour pour Mario était troué par moments de quelque chose de ce genre – brusque, bizarre, et qui fait peur. On a l’impression que tout peut s’arrêter. Et c’est ce qui a fini par arriver.
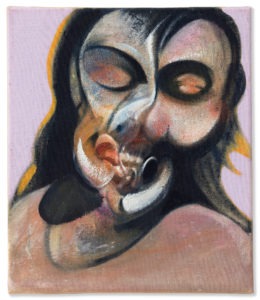
D’abord c’étaient des petites choses, c’était ponctuel mais inhabituel, anormal. Je posais son assiette de céréales sur la table, et en versant le lait je faisais maladroitement tomber quelques gouttes sur sa main. Avant on en aurait ri tous les deux. Or là, sans rien dire il s’essuyait, et me lançait un regard qui me glaçait. Ou il répondait à un reproche – sur le linge sale non ramassé, sur une mauvaise note à l’école – d’un ton de voix soudain rauque et grave, que je ne lui connaissais pas. Il parlait au téléphone avec un ami, et si je passais dans le couloir il claquait la porte de sa chambre et je l’entendais derrière, rire méchamment. Parfois, sans raison aucune, je voyais une lueur froide dans son regard, froide et arrogante. Métallique. Il me semblait à de tels moments ressentir l’air glacial de cet horrible sous-sol, entendre les mots grossiers et moqueurs de cet horrible type. J’étais obligée de quitter la pièce immédiatement.
Puis j’essayais de me raisonner : c’est un ado, ni plus ni moins, tu exagères, tu en rajoutes.
Il s’est mis à sortir le soir avec ses copains en pleine semaine malgré mes récriminations, il travaillait de plus en plus mal à l’école. Les professeurs ont commencé à me convoquer. Je ne pouvais rien leur dire, et lui s’enfermait dans sa chambre et ne voulait pas me parler. Où était passé Mario ? Je ne le reconnaissais plus.
« Crise d’adolescence » : c’était le verdict de mes parents, des profs, de mes amies qui me racontaient sans fin leurs propres déboires. Je les écoutais, recevais leurs conseils, acquiesçais à leurs analyses. Mais au fond de moi, je sentais… comment dire ? Une sorte de peur viscérale. Un lièvre sait. C’est l’instinct, il n’a pas besoin d’explications. Et moi non plus. Je trouvais que ça sentait le roussi.
J’ai essayé d’éviter ces pensées, ces sensations, ces sentiments, de les enfouir. Non pas une ou deux fois – dix, vingt. Quand je le croisais je voyais de plus en plus les ressemblances avec celui qui m’avait violée. Il avait la même lueur maligne dans les yeux, le même sourire oblique, le même menton acéré, rasé de près. La même démarche rapide, pressée, pressante. Comment ne m’en étais-je jamais aperçue ? Ses yeux et ses cheveux étaient seulement dissimulés sous d’autres teintes, d’où ma méprise.
Jamais il ne m’a posé de questions sur son père. C’était un tabou, comme je l’ai déjà dit, on n’en parlait pas. J’avais espéré qu’ainsi cet homme resterait inexistant pour lui. Mais c’est comme si Mario avait réussi à le retrouver dans les recoins de lui-même, malgré tout ce que j’avais pu faire pour l’en empêcher. Il l’a trouvé, repêché, adopté sans une hésitation, sans même le connaître. Et me voici avec mon pire ennemi à la maison. Le doux enfant adoré a tourné casaque. Quand je passe devant la porte de sa chambre, où il s’enferme à clé avec des copains, je les entends glousser et j’entends le mépris et leurs victoires misérables, oui, autant dire que j’entends le sale type se vanter de son viol auprès de ses amis. Et je prie pour que dans cette chambre il n’y ait aucune fille. Mais je suis bête, pour eux un garçon fait aussi bien l’affaire, personne n’est à l’abri.
Tôt ou tard les enfants s’en vont, évidemment. Mais le mien avait trouvé le moyen de prendre la poudre d’escampette bien avant d’avoir mis un pied hors de la maison. Aussi, quand il m’a annoncé vouloir s’engager dans la Légion étrangère je n’ai rien fait pour le retenir. Pour moi il était parti depuis longtemps. Cet enfant que j’avais tant aimé n’était plus le mien. Le père absent avait réussi à s’imposer, je ne sais comment. Je ne voulais plus (je ne pouvais plus) entendre parler de lui. Il m’était devenu non aussi haïssable, mais aussi étranger que son père. On pense que ce sont les enfants qui quittent leurs parents, qui « divorcent » en quelque sorte, pour grandir, mais l’inverse est aussi possible. Je ne l’ai pas revu.

Les feuillets s’arrêtent là, je n’en sais pas plus, désolé. Ce que je sais, c’est que l’achat de la maison a été fait à travers un notaire. C’était une succession, et les descendants voulaient de toute évidence en finir avec cette propriété commune. Ils étaient quatre, dont un beaucoup plus âgé que les autres. Il faut croire que la femme a retrouvé l’amour après sa malheureuse aventure.
A.L.

