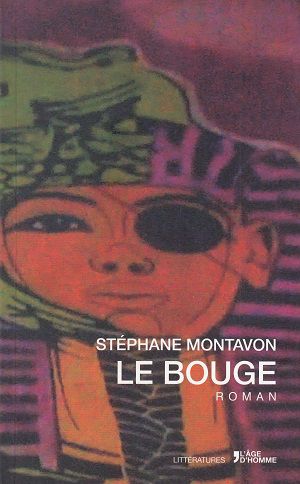Le vortex verbal d’un roman total
À propos du roman Le Bouge, de Stéphane Montavon
par Carole Darricarrère

C’est un récit troubadour, un tympan haut en gammes et fort en goût à l’égal de ces billes de thé vert
mentholées plaquant en bouche d’un jet comme sur un plateau de cuivre son jus circulaire tarabiscoté,
micro en main c’est un film (un movie) une écriture en mouvement, ce son gesticulatoire et son néon à
la renverse qui vous transpose sans transition dans l’épaisseur d’un lieu et de ses personnages où que
vous soyez, confortablement installé, téléporté à la vitesse d’un brin de laine en quelle contrée étrangère
sur les accents filés d’une bande passante, voyageant incognito par le livre vous élargissant vous-même
percuté par le son des langues étrangères, trinquant avec Lang et Dante, le fantôme d’Emily D déconfinée
assise au fond de quel troquet sous quel portrait moustachu de Moubarak, dans quel livre deep down,
dans quel siècle cherchant d’où vient cette lumière sur le mur, cet éclair patchouli pour elle seule y
croisant le fantôme de Flaubert ou bien…

Ayant acheté il y a longtemps, souvenir ficelé à quelque paquet de rides, cheval voyage au gré d’une
main d’enfant, cet instant de lumière, un vert, sa formule plastique fraîchement élue pour son intensité
pérenne, un jouet pauvre en toutes lettres avisant le passant à petits moulinets de roues, cherchant
l’enfant intérieur à la lèvre éblouie qui lui donnera un nom pour toute écurie, égrenant de ruelle en ruelle
sa liberté prodigue,
Tout cela alentour se donne rendez-vous dans l’autofiction autour de la lecture tel un châle sur l’épaule
à l’aulne des heures que l’on dit passer, s’agrège à la narration le destin de parfaits inconnus, une
ribambelle de souvenirs rattachés tels des objets de brocante à de nombreux voyages cardamomes, tel
est le pouvoir majuscule du Bouge faisant « l’détour » par un « hippo fangeux … depuis que le Nil n’en
compte plus » (alias Lang) autant de « mignardises » pour se mettre en selle tout romancier sachant ferrer
son lecteur j’accuse réception,
Ils ont – les personnages – ces chasseurs de sons, cette truculence d’oiseaux migrateurs chiquant la
langue, installant une familiarité dans l’heure « c’t’Ashrouffe », « l’binôme », ces libertés entre guillemets
qui rendent fous nos logiciels, ils sont là, lourds de leurs emmêlements journalistiques de câbles et autres
Nagra, ils nous conduisent place Al Jazeera à la démocratie ou ce qu’il en reste – à défaut quelques
poèmes, un jaune de Naples, quelques coulures d’encre – dans un livre d’action et de mésaventures dont
la teneur politique est portée à bouts de bras par une langue musclée cosmopolite toute d’arabesques
avec un sens du détail qui n’exclut pas la désinvolture, ou comment bouger la phrase, la dégonder de son
corpus, l’arracher à ses ornières, s’approprier la surface du tableau de main de maître, restituer à l’oreille
le son et l’image en plus de l’odeur de la lumière ?
Comment rameuter tous les mots de la conversation dans la langue pour camper une scène, convoquer
des personnages, un évènement, une atmosphère dans un livre d’odeurs transcrites en parfums de
sirops, comme si vous y étiez, lire voyage par procuration,
Lang – le « pilleur de sons » helvète – ayant laissé derrière lui entre autres papiers quelques poèmes,
non pas ces petites madeleines mouillées d’antan et autres langues de chat mais un cahier compost de
baroudeur,
Quelques colères, un registre d’émotions dépassant l’horizon tranquille de la ligne, une aspiration de
celle-ci à bouillonner rênes longues jusque dans le raccourci, se condenser dans l’attitude qui consiste à
cesser de raconter, d’informer, de rester audible, lisible, fidèle à ce que l’autre en nombre attend de vous,
faisant basculer l’actualité dans l’éternité feuille à feuille si tant est que la parole s’envole et que les écrits
restent,
Le récit – il y a somme toute narration – commence en février 2008 pour se poursuivre dans une autre unité
de temps, 2007, 2011 ou 2035 selon différentes focales grand-angle micro macro, Le Bouge, avec ses
allures pittoresques de personnage, entre en scène prétexte à une collection porte-à-porte de chapitres
miniatures exécutés avec maestria,
Ils sont décapants, tous ces mots nouveaux qui ont du peps, font partie désormais du vocabulaire
littéraire et que les auteurs emploient tambour battant sans complexes : mixés à bon escient ils boostent
la langue et parlent de mutations,
Interrogée dans ma lecture par le déplacement d’une tâche de lumière en espaliers sur le crépis en miroir
du déhanchement d’un danseur dans le livre j’admire à l’identique le tour de langue (la mise en mots)
qu’il suscite, propre à vous « émanciper l’oreille », « les musiciens sont là, faces de lunes de cuir, et les
chanteuses oiseaux de paradis » taquinent le djinn de la transe, « le cul ceint d’une jupe de sabots de
chèvres et de coquilles de moules qui maracassent (…) ».
L’observation au service de l’évocation, plastique hautement transmissible, contagion sensuelle, autant
de signes d’appartenance distinctifs d’une culture autre que nôtre tandis que le jour baisse et que la
lumière se confond dans une matité d’ombres grèges soulignant maintenant à peine l’ombre acoustique
de quelque feuillage, nature morte dont se déduit hors cadre la formule tronquée d’un jardin, Le Bouge
est beau de beauté bizarre, « île aux mille vierges », et ses rives et ses rivaux, « un accord avide nappe
le bouge » des subtilités de plume d’une prose foisonnante, contemplatifs lascifs écrasés de chaleur,
serveurs, entraîneuses et courtisans – « prothèses humaines » – offrent le spectacle, Le Bouge s’empare
du chaland par la braguette,
Portraits de rues, portraits de bruits, « Et tout à coup, on est le bruit. », qu’un rectangle de lumière en
force revenu tardif ponctue, dernier brame d’un soleil d’hiver qui s’écorce de lui-même à bonne distance
de la capitale égyptienne,
Trait long pour le plaisir épicurien de la nuance, les hampes généreuses et les talons aiguilles d’amples
descriptions alternent efficacement avec des saltos poétiques fulgurants, comme chien et chat prose et
poésie, leurs postures réflexes respectives face à face pour le meilleur de l’une et l’autre réconciliées,
« L’instant est un bloc fondant. », « l’hydre du trafic est bouffie de testostérone, ses nerfs s’élancent,
serpentent, piètent de rage, rugissent, s’abîment, rougissent le smog (…) Alors très lente sous vous repte
une voie lactée de nids de poule, les toits versent des glougloutées. »
Travaillant en silence à lire tel matin, aucun rai de lumière ne venant raser le mur ni infuser dans le geste de
lire, s’il pleut le blanc pense en noirs de gris, l’esprit aujourd’hui est autrement sollicité, par de minuscules
impacts de moineaux mouillés se disputant le cliché en contrebas dans le jardin, quand « le coeur du coeur
d’la fourmilière, c’est Ataba », dans le livre « ça blaste » en décibels, on se souvient que l’on a des oreilles
pour lire, des oreilles perméables qui participent de la lecture tandis qu’« en couches vrombissantes vous
pénètrent les plus divers vices de l’air » une phrase vous chatouille l’organe le plus susceptible qui soit :
le nez, « l’air à tâtons t’oblige », « Ahah ! là des poissonniers tout à leur cognée sinon quoi. »
Une histoire mais laquelle ? Sorte de celle d’un Tintin en Égypte reconverti dans le Nagra à cahiers
spirales revu et corrigé par quelque Milou de moderne bédé avec forces saynètes et montagne de grains
de sable comme théorie du ruissellement du son dans la langue, boîte noire de luxueuses saturations,
ici le génie de restituer la matière hyperactive d’un environnement sur la page blanche, à boire à lire et à
manger, qui ne s’est jamais assis en silence, fraîchement sorti tout blanc d’un tableau de Hopper haleine
au vent au centre de « l’étoile en prose » du tohu-bohu Technicolor d’une ville moyenne-orientale saura
enfin de quoi il en retourne : Stéphane Montavon écrit comme l’on filme et le livre l’enregistre nous faisant
cahoter merveilleusement de page en page les yeux gavés de khôl peu importe l’intrigue pourvu que le
voyage nous déconfine d’un coup sec et longuement renouant avec la lecture gustative fête et papillotes,
la marque du pharaon en relief sur la joue droite croque un « tel avec une toque de feutre, taxi hélé
évanoui, mosaïques fleuries, saute dans le bus en marche, tel autre soulève sa robe blanche, asphalte
ointe de crachats et pailletée, dévoilant des chaussettes beiges, déchets tourbillonnants sur le sol qu’on
sable pour le curer, fluence ininterrompue sauf à saccader parfois (…) »,
Qu’on se le dise, qu’un couloir de sons traverse l’objet de bout en bout jusqu’à constituer la matière
première du livre, son muscle, sa force, n’est pas la moindre de ses qualités, de quoi ravir d’impénitents
backpackers virus nonobstant… Dans un downtown Cairo before ‘the’ pandémie, une chicha à la lèvre
ignorant encore tout du masque et des mignardises qui y sont associées, je m’abandonne à une lecture
triangulaire passant outre l’oeil par les oreilles et le nez, les contraintes du voyage à découvert en moins,
Janvier, il neige, fâcheuse tendance à mettre des chapeaux de poudreuse et des mitaines sur tous les a.
Chassée par le froid je déplace les essentiels côté chambre, lis au lit, travaille au lit, Proust ronronne sur
son oreiller, soudain moteur, au détour d’un chapitre, au plus fort de la lecture, bataille et bâton, double
page d’adrénaline, des fourmis manifestantes hurlent dans les interlignes, le roman embraye sur une
séquence vidéo ficelée tambour battant, Proust en alerte bondit,
Comment amener le motif politique en poésie, changer de braquet, passer les vitesses, donner du
mordant (du rythme), tout en respectant le modus vivendi arc-en-ciel qui arrondit les angles sans les
priver de leur tranchant, cette attention aux détails développeurs d’harmonie, tout cet arrière-plan qui
lâche du lest et se recompose dans le soft power poétique, le pouvoir versus la puissance, le roman est
au montage comme régie, les articulations bien huilées, le lecteur est ferré, il veut savoir, connaître la fin
de l’histoire, il ne descendra pas du train en marche, il lui est néanmoins loisible de se détendre et de
regarder le paysage par la fenêtre, de savourer en passant le plaisir tangible qu’engendre une phrase
calme bien exécutée, aux bords nets, « À l’horizon la ligne souple d’un haut mur blanc. » (…) « Et vaste
nue, tombe le soir, la voix du muezzin est superflue qui nous émeut mais le scelle. », chaque chapitre
trait court d’un tableau exécuté au vol sur le vif restitue les mille et une nuances de la culture populaire
égyptienne, son kitch et ses traditions,
Tels des séquences d’ARN poétique, les moineaux s’envolent portées de notes en miroir des corbeaux,
le livre n’est plus alors un objet de consommation inerte mais le carrefour de nouvelles inspirations,
Mobilisant toutes les ressources de la langue, écrivant comme qui rappe et repte et rute un reflet acoustique
au croisement de l’autofiction du témoignage historique et de la prose poésie, Le Bouge s’inscrit dans un
projet d’écriture multidisciplinaire et fait le lien entre le son, la vidéo-réalité et le tamis sur actualité qu’offre
un texte de création circonstancié de l’ordre d’un certain regard : que l’on se rassure, « Une révolution ne
fermera pas les bouges », le bouge c’est l’amour de la Vie.
C. D.
Stéphane Montavon, Le Bouge. Editions L’Âge d’Homme, 2020.