Le souffle de la vie
À propos de La Symphonie du loup de Marius Daniel Popescu,
par JLK
Rien, ou presque, n’a été dit jusque-là de précis et de réellement conséquent sur La Symphonie du loup, qui a fait s’extasier les uns quand les autres, l’ayant feuilleté plus ou moins paresseusement, ne faisaient que hausser les épaules.
On a flairé le phénomène, et d’abord douté qu’un chauffeur de bus des Transports lausannois, qui plus est Roumain, débarqué en Suisse en 1990 sans connaissance réelle ne notre langue, puisse boucler un récit de 400 pages, certes un peu hirsute dans sa forme, mais néanmoins abouti et plus substantiel, plus vi-vant et plus vrai que la plupart des écrits actuels, plus encore dans notre pays qu’en francophonie variée.
Les médias, toujours en quête de figures, ont exalté le personnagede Popescu, parfois au détriment du livre. Mais on a vu bien pire dans le milieu supposé faire bon accueil à un nouveau livre sortant à ce point de l’ordinaire : les plus mesquins auront ainsi insinué, comme de Jonathan Littell à propos des Bienveillantes (pensez : un Américain se mêlant d’écrire en français), que certains amis écrivains de Popescu avaient mis la main, pour ne pas dire : avaient écrit ce livre. Il n’y a pas de secret : certains amis écrivains de l’auteur, dont René-Luc Thévoz a été le premier, puis le soussigné, Michel Layaz, Daniel Maggetti, d’autres peut-être, ont en effet relu et parfois corrigé les pages de La symphonie du loup, dont les finitions d’ordre grammatical ou syntaxique ne sont rien, cependant, par rapport à ce que ce livre apporte d’essentiel : à savoir le souffle tout personnel et tout original de ce que Gilles Deleuze appelle «une langue étrangère dans la langue», seule formule préfigurant une écriture réellement nouvelle.
C’est cet immédiatement « étranger », cet immédiatement neuf et vif, cet immédiatement frais et fluvial, cet immédiatement bravache et chaleureux, cet immédiatement tonique et mélancolique qui m’a, pour ma part, immédiatement estomaqué dès ma première lecture des premières pages de La Symphonie évoquant, par la voix du grand-père, le premier tournant de la vie d’un adolescent de qua-torze ans soudain frappé, en pleine partie de pêche, par l’annonce de la mort accidentelle de son père. Scène immédiatement mythique à mes yeux, comme la scène du baiser de Proust.
Et tout aussitôt le parterre littéraire assis de se récrier et de ricaner : ah mais, voilà que ce lourdaud compare cette espèce de Roumain au divin Marcel ! Je ne sais si « cette espèce de Roumain » en aura le temps et la discipline, mais je suis convaincu que Marius Daniel Po-pescu pourrait bien, à travers les années, écrire sa Recherche. Inutile de dire que l’idée ne me viendrait pas, aujourd’hui, de comparer La symphonie du loupà La recherche du temps perdu, ni de prétendre, du tout, que nous tenons déjà là un chef-d’œuvre, comme d’aucuns l’ont aventuré. En revanche, Jean-Claude Lebrun, dans le premier grand article paru en France sur le livre, dans L’Humanité, me semble tout à fait dans le vrai en reconnaissant à Popescu « le souffle des grands ».
D’extraordinaires séquences, dans La Symphonie du loup, relèvent en effet, comme certaines pages des Bienveillantes, de la grande littérature. J’ai déjà évoqué la première. La deuxième est la suite de l’enterrement du père avec, notamment, la déchirante évocation du désarroi titubant du garçon dont les pensées se bousculent en délire (pp.111-118) dans cette litanie récurrente de mots « qui ne devraient pas exister », le dos tourné à la tombe et sans âge : « Les mots n’ont aucune valeur dans la vie et dans la mort. Ils n’appartiennent ni au passé, ni au présent, ni au futur. Ils ne sont ni eau, ni terre, ni fleur, ni vent. Tout ce qui se passe n’a rien en commun avec eux ».
La symphonie du loup est toute faite de mots en apparence, mais les mots d’une autre langue, physique et métaphysique à la fois, des mots-gestes, des mots-soupirs, des mots-caresses, des mots-claques, des mots-désirs, tout un silence en ébullition de mots-musique, tout un tour-billon de sable-mots, tout un déferlement de hautes vagues ourlées de mots-écume traver-sent le livre d’un seul souffle.
Et les grands épisodes se suivent comme autant de ces « blocs d’enfance » dont parle encore Gilles Deleuze, qui relèvent tantôt de l’épopée et tantôt de la chronique intime ou privée: séquences alternées, en contrepoint, des petits bateaux bricolés dans la chambre des enfants, aujourd’hui, et de cette formidable traversée du dépotoir roumain, vingt ans plus tôt, de l’étudiant juché sur le marchepied d’un train lancé à toute allure (pp.100-106) ; blocs d’enfance des mots et des choses qui s’agencent comme au domino dans les douces heures de l’apprentissage, bousculés et augmentés par le récit hallucinant de la mort d’un cheval, dans une usine désaffectée, sous les coups d’ouvriers enragés de n’avoir plus rien à faire et se vengeant sur le bouc émis-saire au carré que représente le pauvre animal d’un Gitan méprisé (p.151-161), avec ces mots nous restant en travers de la gorge : « L’automne, les pommes tombent sur le squelette du cheval et sur ses sabots soudés aux plaques de tôle en acier. Tu as maintenant presque quarante ans, ta mémoire n’arrive plus à dormir, tu rêves souvent du Gi-tan ».
Séquences tour à tour splendides et sordides, telles la merveilleuse évocation du souvenir roumain d’un commerce magique de bouteilles et de ballons (pp.139-148) et la confidence d’une entraîneuse de cabaret évoquant son morne esclavage au narrateur, ici et maintenant ; le triste avortement d’une jeune fille au pays du parti unique, et les mêmes détresses vécues par tant de frères humains, en Roumanie déglinguée ou en Suisse ripolinée.
Séquences de la sexualité ne relevant plus du « petit secret » mais de la vie personnelle et collective, où la recommandation du père au fils de ne pas se masturber (non tant par souci moral que pour mieux aimer la femme et toutes les femmes…) s’enchâsse dans une évocation de la masturbation collective « sauvage » qui préfigure la masturbation « en ligne » des solitudes mondialisées. Séquences de poésie naïve, candide parfois, parfois complaisante aussi dans son désir de donner du galon à tout et n’importe quoi, où les « blocs d’enfance » participent du moins d’une sorte de collage de mots-confettis, alternant avec les scènes socialement significatives d’un observateur acéré du socialisme au quotidien.
La symphonie du loup est un concert de voix à la fois agencé et chaotique, construit et jeté, aux phases tantôt ciselées et tantôt brutes de décoffrage. A un moment donné, le narrateur se voit qualifié d’«artiste brut» pour ses travaux saugrenus de façonnier de chaises en boîtes d’allumettes, mais cette qualification ne convient guère, à vrai dire, à l’art à la fois instinctif, puissant dans son élan et souvent désordonné, velléitaire parfois, mais organiquement tenu par la même perception poétique de l’existence et par le même souffle indompté. Surtout, et c’est ce que je voudrais souligner dans le contexte d’une littérature aphone ou dévertébrée, où le « petit secret » devient la grande affaire de la machine à ne rien dire, ce livre vaut par l’immense rage d’amour qu’il manifeste, où l’égomanie amoureuse de l’écrivain éclate en multiples « je », au-delà de l’étriquement de tous les « moi ».
Contre la grande impuissance à aimer qui affadit et écrase tout de nos jours, ce grand livre d’amour, même inabouti à certains égards, mé-rite d’être aimé et admiré.
JLK
Marius Daniel Popescu. La Symphonie du loup. José Corti, 2008.
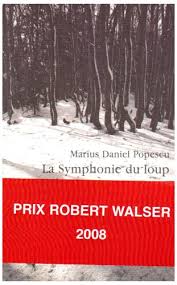
(Archives du Passe-Muraille, No 75, mai 2008)

