Le séducteur de spectres
Découverte de Gesualdo Bufalino,
par Fabio Ciaralli
Co n n a i s s e z – v o u s Gesualdo Bufalino et Le Semeur de peste? Si ce n’est pas le cas, j’aimerais vous faire pénétrer dans l’œuvre de cet auteur merveilleux et vous parler de son premier roman.
Gesualdo Bufalino, Sicilien de la poovince de Raguse – de Comiso précisément – naît en 1920 et meurt, dans la même petite ville, en 1996, au cours d’un terrible accident de voiture. Son père était un forgeron passionné par la littérature, passion qu’il réussit à transmettre à son fils au cours de soirées où ils jouaient avec un vieux dictionnaire et lisaient ensemble les aventures de GuerinMeschino.
Eh oui, le dictionnaire… Le mot fait venir à l’esprit l’écriture extrêmement recherchée, la préciosité des paroles, courbes et volutes utilisées comme des pierres serties dans la phrase. On a parlé également de neurasthénie stylistique, à côté de la rengaine sur le baroque antipathique, peut-être à cause d’un des aphorismes du recueil Il Malmenante (Le Mal pensant): «Relire ce qu’on a écrit cinquante fois par jour, ne serait-ce que pour y changer un mot comme on change une fleur dans un vase». Peut-être un peu d’anxiété, peut-être une insatisfaction chronique, mais quel soin véritablement amoureux l’écrivain consacrait-il à la langue!
Procédons par ordre. En laissant de côté la période scolaire et les petits travaux pendant l’adolescence où il pei-gnait des chars siciliens dans un atelier d’artisans, nous arrivons en 1940: il s’inscrit à la Faculté des Lettres de Catane puis de Palerme, fréquente bien peu les cours et, deux années plus tard, se retrouve sous les drapeaux, en pleine guerre. En septembre1943 il s’enfuit; après avoir été capturé par les Allemands, il réussit à s’enfuir à nouveau et à échapper à la dernière, terrible période de représailles. En 1944, il découvre qu’il est atteint de tuberculose et il est hospitalisé dans un sanatorium: élément essentiel qui va changer radicalement son existence.
Dans la cave de l’institut de Sandiano, dans la province de Reggio Emilia, le médecin-chef, qui cultive les lettres, conserve une très riche bibliothèque. C’est là que le patient Bufalino se plonge dans des lectures et des études approfondies au cours desquelles il lit Proust en français. En 1946 il obtient d’être transféré au sanatorium sicilien de la Conque d’or, entre Palerme et Monreale, «La Rocca», théâtre de ce qui sera son premier, incomparable, roman, Diceria dell’Untore, Le Semeur de peste.
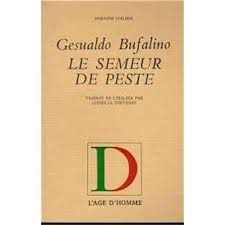
Bufalino sortit de la Rocca l’année suivante, mais ce n’est qu’en 1971, vingt ans après, qu’il réussit à mettre un point final à une version complète du texte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il continua à y travailler et à produire des variantes jusqu’en 1981, année où, presque par hasard, grâce entre autres à la ténacité de l’éditrice Elvira Sellerio, le texte fut imprimé pour la première fois.
Aujourd’hui nous savons que le Fonds des manuscrits de l’Université de Pavie, auquel l’auteur a fait don de toutes les versions de cet ouvrage, en possède bien sept, avec un patrimoine infini de variantes. Toujours dans Le Mal pensant on peut lire: «Variantes: n’en refuser aucune mais se les réciter ensemble en redoublant le texte et l’extase de le dominer. Un texte multiple est plus vrai que la perfection finale.» Et encore: «L’impatience de Dieu de publier le monde ne finit pas de m’étonner. Il faudrait conserver de telles choses dans son tiroir pour toujours.»
Ce n’est qu’après l’immense succès du Semeur de peste (prix Campiello l’année de sa sortie) que Bufalino commen-ça à publier de très nombreux ouvrages, non seulement des récits mais des poèmes, des essais et des mémoires.
Son chef-d’œuvre demeure son premier roman. Vivre en symbiose constante avec la mort qu’on sent perpétuelle-ment respirer dans son cou: c’est le sort des personnages-ombres qui hantent les pages du Semeur de peste. Dans le microcosme triste et fermé d’un sanatorium sicilien, des êtres humains en sursis se rencontrent au cours d’instants légers, suspendus sur l’abîme du rien; par le fait que ces moments sont – peut-être – les derniers, ils acquièrent une saveur exaspérée et se teintent d’or et de feu.
Le rébarbatif Grand Maigre, médecin cultivé, désenchanté et qui s’adonne à l’alcool, maître de la parole mais à son tour victime du jeu de la vie et de la mort, sauve le patient narrateur grâce aux livres; Marta, la mystérieuse et splendide Marta, peut-être juive et donc victime, peut-être maîtresse d’un Allemand et donc traîtresse et bourreau, peut-être les deux, repliée sur sa propre mort imminente, vit une his-toire d’amour avec le narra-teur, «contrebandier de vie»; elle l’aime parce que, comme elle, il est sur le point de mourir; et elle éprouve par instants de la haine à son égard parce qu’il pourrait guérir et vivre, malgré son amour pour elle, en la laissant seule devant le néant. L’espérance, d’habitude compagne docile et heureuse, rend les rapports enchevêtrés, éloigne les amants que déjà séparent les lois sévères du sanatorium, prison avec quelques brèches, avant que n’arrive à les séparer à jamais la mort de la jeune femme. Les signes indélébiles de la souffrance se transforment dans l’œuvre en beauté indicible. La consomption, la désillusion, le calvaire deviennent des motifs de légèreté sur fond de mer et d’orangers siciliens, sur des routes brûlées que les deux amants parcourent à la fin dans le seul espoir de vivre encore un instant de passion, un instant de trêve.
Survivre à son amour et à ses compagnons est tout sauf une victoire: la guérison est vécue comme une désertion et place la vie future du jeune homme sous le signe ineffaçable de la faute.L’écriture de l’ouvrage, fruit ciselé d’un «séducteur de spectres», comme aimait à se définir l’écrivain, est un incessant flamboiement mortifère. Le Semeur de peste,poème narratif qui pousse la recherche stylistique jusqu’au spasme, en alternant une admirable sé-cheresse et «des paroles gras-ses, humides, chaudes dont je me farcis», disait Bufalino, est le chant doux-amer de la tragique euphorie de la mort, «paravent de fumée entre les vivants et les autres».
«On écrit pour se guérir soi-même, pour se laver le cœur», disait encore l’écrivain. Ainsi soit-il. Mais il est vrai également qu’on écrit «pour dialoguer avec un lecteur inconnu». Et j’espère qu’il en sera ainsi afin d’alléger la prochaine journée «qui nous at-tend au tournant avec sa dose infaillible de dérision et de peine»…
F.C
(Le Passe-Muraille, No 77. Avril 2009)


