Le métier de vivre, le métier d’écrire
À propos de Pour mémoire de Jean-Pierre Monnier (1921-1997), avec un entretien de 1992,
par René Zahnd
Il en va de quelques ouvrages comme de certains bistrots: à peine les quitte-t-on qu’on est sûr d’y revenir. Pourquoi ? Parce qu’on s’y plaît, parce qu’on n’en a pas encore épuisé toutes les ressources et les richesses, parce qu’on y goûte une nourriture qui nous convient. En l’occurrence, celle que nous sert Jean-Pierre Monnier dans son dernier livre est à la fois substantielle et très élaborée. En forme de bilan, Pour Mémoire propose une traversée d’un demi-siècle d’écriture et de parcours intellectuel. Il ne s’agit pas de souvenirs ou d’une autobiographie, bien que l’œuvre puise à ces deux fontaines. Plutôt il faudrait parler d’une interrogation du passé. Comme si l’écrivain, âgé aujourd’hui de 70 ans, cherchait à comprendre au plus près le déroulement de son existence, essayant d’en dégager le ou les sens. Après six romans, deux essais et un récit, voici donc le livre qui vient nouer la gerbe. Il évoque des personnages, des lectures, des climats, mêlant le «métier de vivre et le métier d’écrire». Il dit quelques convictions et des doutes, nous interrogeant en retour. Jean-Pierre Monnier s’y montre au sommet de son art. C’est beau et passionnant à la fois.
— Vous avez toujours été attentif à l’écriture, à la musique que les mots pouvaient dégager.
— Oui, pour moi, c’est très important. Quand ma femme a vu pour la première fois un de mes manuscrits, elle a été effrayée, parce que ce sont effectivement des pages illisibles. Ou quasiment. Je me suis posé pas mal de questions à ce propos. Le travail sur la langue, de tel sorte que soient rendus une musique, comme vous dites, un rythme, une cadence si possible en accord avec ce qui est dit: c’est ça que j’ai cherché constamment, mais non sans peine.
»Il est arrivé aussi que je me reproche de n’avoir pas osé une écriture plus personnelle et plus désarticulée. Je me dis: «Tu aurais pu te créer une langue, une langue à toi, qui n’aurait peut-être pas été tout à fait conforme aux règles de la grammaire et de la syntaxe.» Mais au fond, il me semble que la langue française, telle qu’on la parle et telle qu’on l’écrit, est une langue qui devrait suffire à dire ce qu’on a à dire. Même si c’est difficile. Même si c’est long. Même s’il faut recommencer et raturer sans cesse. Quand on revient à la beauté de la phrase de Nerval ou à la beauté de la phrase de Baudelaire dans les textes en prose, ou encore à Racine, com-ment ne pas aimer cette langue ? C’est impossible.
— Cette recherche d’une vibration qui se dégage des mots, c’est aussi l’endroit où le roman rejoint la poésie.
— Tout à fait. Et c’est pourquoi je me suis souvent demandé si j’étais romancier. Kundera estime que Flaubert a écrit les premiers romans «comme poèmes». Et c’est vrai. Il y a des pages de Madame Bovary qui sont des poèmes en prose. Julien Gracq aussi, c’est de la poésie en prose. De ce point de vue, je ne me prends pas pour un romancier.
— Crisinel, Roud, et surtout Ramuz sont ceux qui vous ont montré qu’il était possible d’écrire en Suisse romande, avec une langue qui n’était pas forcément celle de Paris. Ce type de débat aurait-il encore un sens aujourd’hui ?
— Non, et précisément parce que ces écrivains ont fait le chemin. Il y a finalement une sorte de climat littéraire, qu’ils ont créé sans le savoir, malgré eux, une sorte de voie qu’ils ont ouverte, dans laquelle se sont engagés des auteurs de mon âge, puis dans laquelle, à notre suite, se sont engagés d’autres écrivains. Evidemment, je ne dirais pas que l’habitude a été prise, mais je dirais que le travail a été fait. C’est pour ça aussi que mon époque a été une époque extraordinaire. On sortait d’une littérature qui chantait les beautés de l’alpe et du lac Léman ! On sortait d’une littérature épouvantable, souvent moraliste et sectaire. Je me souviens. Quand j’avais douze ou treize ans, les livres que j’empruntais à la bibliothèque de l’école étaient de Virgile Rossel, de T. Combe, d’Eugène Rambert !
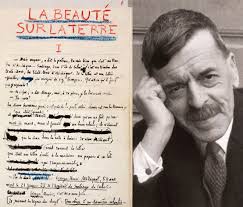
Et tout à coup Ramuz arrive, et les autres à sa suite. Comment voulez-vous rester fermé à ces espèces de révélations après vous être ennuyé avec des romans moraux ou de la poésie alpestre. Ces écrivains, Ramuz, Crisinel, Roud, et d’autres, quand on sort de l’adolescence, qu’on prétend écrire et qu’on est jeune étudiant, ont eu une importance vraiment considérable.
— Finalement, ce qui vous intéresse, c’est l’écrivain ancré dans un coin de pays, mais dont le propos s’étend au-delà. Le fameux mouvement «du particulier à l’universel».
— Je crois que c’est essentiel: ne pas rester à l’ombre de son clocher. Les écrivains sont de quelque part. Ils font quelque chose de leur lieu, mais quelque chose qui, par toute espèce de voies un peu mystérieuses, rejoint l’homme, où qu’il soit.
— Pour quelles raisons avez-vous écrit «Pour Mémoire» ?
— Il me semblait que c’était important, pour moi en tout cas, de rappeler ce que j’avais essayé de faire, dans une évolution qui va de mes premières pages jusqu’à celles qui ont paru il y a six ans maintenant, donc jusqu’à Ces vols qui n’ ont pas fui. Il y avait surtout le besoin de me souvenir et de rafraîchir ma mémoire, en me forçant de voir et peut-être de mieux comprendre ce qui s’était passé pour moi depuis le moment où j’ai commencé à écrire.
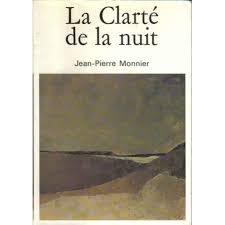

»Il y a des pages qui sont plus particulièrement consacrées à mon travail d’écriture et aux différents livres que j’ai publiés, et il y a d’autres pages qui rappellent certains événements, certains climats aussi de Suisse romande depuis la fin de la guerre. II m’a semblé que les choses avaient beaucoup changé. Il existe bien une continuité, d’une génération à l’autre, une continuité profonde, mais ce qui me frappe aujourd’hui, dans la jeune littérature, c’est qu’on ne se paie plus de mots: on a pris ses distances par rapport à une rhétorique qui existait encore dans les années cinquante. La littérature d’aujourd’hui, en Suisse romande et ail-leurs, me paraît plus objective. Elle est moins engagée subjectivement que celle que nous avons connue et d’ailleurs aussi pratiquée tout au début de nos exercices littéraires. Comme on ne se paie plus de mots, aujourd’hui, on ne croit plus tellement que la vraie vie est absente ou que nous ne sommes pas au monde — ce sont des mots de Rimbaud. Il n’y a plus cet engagement politique, au sens large, ou cet engagement métaphysique.
»A la fin de la guerre, en 45, nous avons véritablement cru que c’était la dernière, et nous avons véritablement cru que le monde allait être fraternel et s’ouvrir à tous les autres. Or, on est tombé dans la guerre froide. La France, pays des droits de l’homme, a été en guerre de 39 à 62. On a vécu tout cela douloureusement, après cette période exaltante, pour nous étudiants et soldats aux frontières, qui avait été celle de la Résistance et celle de la littérature de la Résistance, de la poésie de la Résistance. On avait le sentiment que tout allait nous sourire et qu’on pouvait à nouveau parler sans rire et sans faire rire de la justice et de la liberté. Et puis que s’est-il passé ? Il y a eu la crise de Suez, Budapest, la guerre d’Algérie… Et de nouveau, on était engagé sans être engagé, c’est-à-dire qu’on ne participait pas, étant neutre. Mais ça ne signifie pas qu’on n’était pas profondément alerté par ces événements. Cela m’a beaucoup plus préoccupé qu’un engagement politique en Suisse même. Il m’a toujours semblé que nos problèmes étaient un peu dérisoires par rapport à ce qui se passait dans le monde. J’irai même jusqu’à dire que la question jurassienne, d’une certaine façon, m’a paru dérisoire. Quand les enfants mouraient de faim, quand les camps de la mort étaient encore ouverts, quand on déterrait les cadavres, la sujétion du Jura sous la patte de l’ours de Berne ne me paraissait pas du même ordre. »Ayant écrit Pour Mémoire, j’ai été frappé de constater que j’avais toujours vécu en retrait de l’engagement parce que je n’y croyais pas assez, parce que je ne croyais pas assez à la cause qu’il aurait fallu défendre. Et peut-être aussi par crainte du sectarisme. »Malraux a dit que la secte était une manière de briser sa solitude. On est tous solitaires. Je peux me considérer comme un solitaire. Mais il faut que la solitude soit assumée pour que ce soit une vraie solitude. Il ne doit pas s’agir d’une solitude plaintive, et qui a précisé-ment besoin d’un recours: la secte, ou le parti, le parti-pris.
— Votre propos suggère qu’en d’autres circonstances, dans un autre contexte, vous auriez très bien pu vous engager ?
— Ah oui, certainement. Quand la guerre s’est terminée, j’avais 23 ou 24 ans, on a vécu de frustrations. On aurait voulu s’engager à la suite de la Résistance, mais on n’est pas allé jusque là, et on n’y avait peut-être pas droit. La France de l’époque n’était pas l’Espagne de la guerre d’Espagne avec ses brigades internationales. On a vécu par procuration. Il y a eu, pour notre génération, à la fin de la guerre, des moments douloureux de mauvaise conscience. La Suisse a eu mauvaise conscience. Et la Suisse romande plus que la Suisse allemande, parce que la Suisse romande est de culture française. Ce que défendaient les Résistants, c’était précisément cette culture et cette langue qui sont les nôtres. Et nous, on ne résistait pas les armes à la main, on résistait idéalement en quelque sorte. On ne s’est pas sali les mains.
— La question de l’engagement et du non engagement traverse tout votre livre.
— Sans doute, oui. Et il m’est arrivé assez souvent de me reprocher à moi-même de ne pas agir assez. Mais j’ai fini par me persuader que la tâche de l’écrivain n’était pas celle-là, et que l’écrivain agissait avec ses mots, avec sa sensibilité et éventuellement avec sa pensée. Et puis il y avait d’autres artisans de l’Histoire, à ce moment-là, mieux faits que moi, mieux disposés aussi pour une action directe.
— Selon vous, l’écrivain aurait cependant une tâche de résistance ?
— Evidemment, toutes les fois que certaines valeurs auxquelles il croit sont bafouées, il ne peut que résister. Mais il ne faut pas cher-cher des occasions de résister pour résister, et c’est arrivé assez sou-vent, me semble-t-il, ces dernières années. On a eu affaire à des gens qui s’engageaient pour s’engager, comme s’ils avaient peur d’être seuls, pour revenir à Malraux, ou comme s’ils éprouvaient à tout prix le besoin d’agir. Il me semble qu’on a souvent affaire à des activistes plutôt que des actifs. Quand on voit tout ce qui s’est passé, on remarque des attitudes qui font sourire, parce qu’elles ont été emportées par le flux de l’Histoire, et parce que ces gens-là n’ont peut-être pas cru ou pu croire suffisamment à des valeurs non-historiques. Camus, dans la préface de l’oeuvre de Martin du Gard à la Pléiade, dit que Martin du Gard s’est trouvé coincé entre l’Histoire et Dieu. Ça m’a paru très éclairant, et j’ai repris cette formule à propos de Ramuz. Je ne dirais pas que Martin du Gard a choisi l’Histoire parce qu’il était Français et pour toutes les raisons qui étaient les siennes. Mais à côté, il est évident que Ramuz n’a pas choisi l’Histoire. On ne peut pas dire non plus qu’il a choisi Dieu. Mais il s’est tout de même tourné vers le roman mythique. Il y a un symbolisme religieux chez Ramuz et un besoin religieux, au sens premier, c’est-à-dire un besoin d’être relié.
»Il me semble qu’on retrouve là assez profondément ce que nous sommes. On peut le regretter ou non, mais c’est comme ça. Il y a longtemps que notre pays ne participe plus à l’Histoire. Cette situation crée toutes sortes de malaises pour celui qui voit l’Histoire se faire autour de lui et qui n’y participe pas. Il y a là un problème qui a été posé très précisément à l’époque que j’ai essayé d’évoquer.
— A partir du problème de l’engagement, on peut glisser vers un autre thème, qui est celui du rapport de l’écriture et de la vie.
— Ça, bien sûr. Il me semble que c’est ce qui motive profondément le travail de l’écrivain. L’exercice de la littérature, et le fait d’être fasciné par tout ce qui est littérature, aide à vivre et permet de trou-ver quelque chose qui ressemble à une sorte d’équilibre. Les derniers mots de mon livre sont: «Peut-être ai-je fini par m’accepter tel que je suis.» Je le crois. Et c’est une chose qui ne va pas de soi.
— On pourrait donc dire que l’écriture et la littérature sont les instruments d’une réconciliation.
— Sans doute. Cette réconciliation peut intervenir à toute espèce de moments dans la vie. Mais en général, c’est plutôt vers la fin, après avoir écrit quelques livres. Après s’être cherché dans plusieurs directions, et après y avoir été porté assez naturellement, on en arrive peut-être à cette réconciliation dont vous parlez. Elle n’intervient pas, me semble-t-il, quand on est très jeune. Tout ça ne signifie pas que je n’écrirai plus de livres. Mais je ne crois pas que j’aurai encore la longue patience de me donner les moyens d’écrire un roman.
Propos recueillis par René Zahnd
Jean-Pierre Monnier, Pour Mémoire, Bernard Campiche éditeur, 1992.
(Le Passe-Muraille, No 1, Avril 1992)


