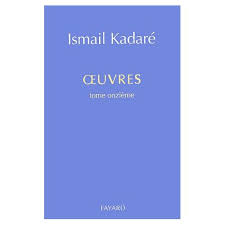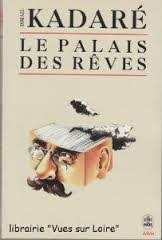Le labyrinthe du roman total
Parcours esquissé du dédale de l’oeuvre d’Ismaïl Kadaré,
par JLK
L’image du Labyrinthe s’impose comme une évidence à la lecture de Kadaré, dont l’oeuvre est explicitement conçue comme un roman total. Le dédale de celui-ci constitue, sur la Terre et dans le Temps, tout un réseau de passages de pierre ou de passerelles de verre par lesquels on circule comme dans un grand rêve éveillé, de la Grèce antique au Kosovo d’aujourd’hui, des souterrains du palais où s’entassent les dossiers des rêves répertoriés d’un empire totalitaire à la cabine pressurisée du poisson volant dans lequel un artiste humilié passe du pays des aigles aux Champs-Elysées, d’un empire et d’un siècle à l’autre, des morts aux vifs et retour.
Une Albanie mythique, et plus que réelle en sa douleur sourde, demeure le centre obscur de cet univers à la fois organique et minéral, dont la coloration des jours qui s’y écoulent est le plus souvent celle de la mélancolie automnale. La même lumière sombre et douce, de carnage et de désert, de champs de ruines sous la neige, baigne la poésie de Kadaré et la première page du Général de l’armée morte par où s’ouvrait le grand labyrinthe il y a une vingtaine d’années, et tant de scènes ensuite de ce théâtre tragique et grotesque dont les héros rejouent les Atrides et Macbeth entre Pékin et Tirana; où les visions de l’enfer totalitaire, entre Kéops et le Kremlin, réactualisent celle de Dante; où le rhapsode semble conjurer l’érosion du temps et le nivellement de la culture de masse («Où sont en allées les ballades, / l’épopée, la mémoire des gens ? / A quoi bon chercher leurs traces ? / Autant vouloir trouver la tanière du vent») en revivifiant les mythes de l’Antiquité et les légendes populaires des Balkans.

Dans la passionnante vue en perspective cavalière de cette fin de siècle que constitue Le Dédale (Fayard, 1994), l’anthropologue Georges Balandier souligne la pauvreté et le caractère volatil, illusoire des «mythes opportunistes» dont nous abreuvent les médias. Et de relever a contrario, à propos du Labyrinthe, que le mythe parle encore: «Au moment où une nouvelle génération d’historiens renoue avec le narratif, retrouve la qualité du récit en tant que facteur de compréhension et de connaissance plus profonde, on peut tenter d’entreprendre l’exploration de l’actuel en prenant pour référence inspiratrice une grande narration héritée du passé fondateur». Or on ne voit guère d’auteur contemporain, si ce n’est peut-être Dürrenmatt, qui ressaisisse la matière mythique et légendaire avec autant de pénétration mais aussi de naturel, de puissance visionnaire et de limpidité dans le conte qu’Ismaïl Kadaré.
Ainsi Le cortège s’est figé dans la glace, s’inspirant de la légende balkanique des jeunes amants défiant la haine ancestrale qui oppose leurs familles, actualise-t-il le drame d’un Roméo albanais et d’une Juliette serbe au Kosovo, en 1981, dans une atmosphère qui relève à la fois du poème intemporel et du reportage, voire du manifeste politique. De même Le Concert, évoquant notamment la liquidation de Lin Piao par Mao, ressuscite-t-il la figure de Macbeth (et de sa Lady en la terrifiante Jiang Qing), tandis que Le Grand Hiver, brossant à fresque le schisme entre Albanais et Russes, entremêle et superpose thèmes mythiques et légendaires dans une polyphonie tragique et romantique à la fois.
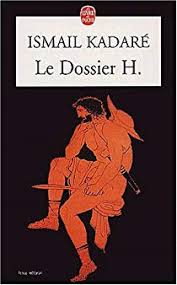
Une source légendaire irriguant déjà Qui a ramené Doruntine ? ressurgit en outre dans L’Ombre (Fayard 1994), dernier roman paru de Kadaré, commencé à Tirana en 1984-1986 en version semi-codée, déposé à l’époque dans un safe parisien avec ordre à l’éditeur de le publier en cas d’«accident» survenu à l’écrivain, puis repris et achevé par celui-ci à Paris, en 1994.
Apparemment aux antipodes des majestueuses chroniques romanesques de Kadaré (telles Le Pont aux trois Arches ou Le Palais des rêves), L’Ombre ne fait à vrai dire que relancer, dans la tonalité contemporaine, le tragique et le grotesque partout présents dans l’oeuvre du grand écrivain. Cette confession d’un cinéaste raté qui joue l’émissaire culturel entre l’Albanie ceinturée de barbelés (sur les grèves de laquelle gisent les corps mitraillés des jeune gens sans laissez-passer) et Paris où il goûte à une liberté plus difficile à vivre que ne se le figurent ses camarades restés au pays (les pauvres sont réduits à se masturber en fantasmant sur les Occidentales hyperlibérées), cette chronique un peu minable d’un flirt problématique investit à vrai dire les pseudomythes de la téléculture saturée d’érotisme pour mieux figurer les malentendus de la relation (ou de la non-relation) entre l’Est et l’Ouest. Cela pourrait être lourdement démonstratif, et d’aucuns ont été choqués par la rupture de ton, déjà perceptible cependant dans l’admirable Clair de lune. Or loin de donner dans la complaisance scabreuse, Kadaré «retourne» au contraire l’apparente trivialité de son matériau. Une fois de plus, ainsi, la basse continue du grand thème sous-jacent (le jeune homme échappé du royaume des morts qui s’en vient accomplir sa mission, comme dans la légende de Doruntine), le motif inverse de la transgression de Gilgamesh, ou encore le thème de la femme incarnant telle «figure de l’impossible», nourrissent une méditation à la fois «éternelle» et combien poignante d’actualité, qui s’achève sur quel espoir (?) de réconciliation…
JLK