Le dernier voyage de Gilles Lapouge
Notre ami Alain Dugrand, compère des étonnants voyageurs, nous invite à honorer la mémoire de l’un d’eux…
Le 6 août 2020, l’écrivain Gilles Lapouge a rejoint la sépulture des siens à Digne, en Provence. Sa plume élégante, stendhalienne, amoureuse demeure pour toujours. Son âme libertaire volète auprès de ses admirations, Jean Giono, son voisin de Manosque, son cher Nicolas Bouvier et Maurice Nadeau, ce magicien. Les lecteurs brésiliens sont aussi tristes que nous le sommes, puisque, soixante ans durant, cet arpenteur d’un monde sans frontières a tenu une chronique quotidienne pour le journal O Estado de Sao Paulo. En 1991, pour la revue Gulliver, Gilles Lapouge écrivait des souvenirs d’enfance : les soldats de plomb, les guerres de position qu’il menait au fond du jardin familial, à Digne…
Soldats de plomb
par Gilles Lapouge (1923-2020)
J’aimais beaucoup la guerre, surtout quand les boîtes étaient rouges. Les soldats étaient de toutes les couleurs. Les officiers, en attendant que le conflit éclate, révisaient leurs leçons de Saint-Cyr. Ils s’exerçaient aux postures héroïques, de manière à ne pas les rater le jour où ils bondiraient hors de leurs tranchées, sabre au clair. Immobiles, sur leurs chevaux pétrifiés, ils semblaient saisis, en plein galop, par une crampe incompréhensible. Ils avaient l’air dynamique et mécontent.
Le temps n’était pas encore en route et j’étais le maître du temps, j’étais le temps : c’est à mon commandement que ces soldats allaient quitter leurs boîtes, secouer leur léthargie, courir comme des fous, lâcher leur coup, égorger de pauvres bougres, mourir peut-être.
Je ne jetais pas tout de suite mes guerriers dans la bataille, moins pour compléter leur instruction qui était excellente que pour jouir de leurs élégances. Je profitais de ce délai pour produire un peu de pitié : se doutaient-ils, mes petits bonshommes, que j’allais lancer la grande roue du temps, leur offrir la vie et la mort ensemble ? A mon caprice, ils aimeraient des lavandières, ils diraient des obscénités, ils feraient des jours de tôle, ils perdraient des membres et des têtes, leurs entrailles couleraient, leurs fiancées pleureraient.
Je pensais à Dieu. Comme lui, j’avais le cœur en débandade au moment d’insuffler la vie dans mes figurines. Pauvre Dieu ! Il n’était point coupable. Certes, on peut lui reprocher d’avoir accepté ce métier-là, mais qui ne commet point de bourdes, et puis le titre est flatteur, mais une fois installé dans sa fonction, comment se dérober ?
J’étais bien placé pour connaître l’infini de sa solitude, sa tristesse et qu’il était inconsolé. Devant mes boîtes rouges, je comprenais ses tourments. Nous autres, dieux, on nous trouve cruels ou légers, insensibles, frivoles, on nous appelle « dieu des mouches », mais ceux qui, comme moi, ont créé le Temps, même une seule fois, savent bien que les dieux ne sont pas méchants, ce sont des besogneux. Ils font ce qu’ils peuvent. Ils sont ligotés à leur fonction de Dieu, ils sont coincés.
En cet instant où ils lancent le Temps (en cet instant énigmatique car, enfin, comment repérer un instant dans une éternité ? Comment Dieu s’est-il débrouillé pour le découvrir, cet instant camouflé dans le méli-mélo inerte de l’éternité, ce trou infime par lequel va se précipiter le temps ?), oui, à cette seconde où les dieux poussent du doigt le balancier de l’horloge, l’horreur commence : toutes ces créatures qu’ils ont forgées et peintes avec tant de talent, pendant les six jours de le Genèse, et qui sont si chatoyantes et si propres aussi longtemps que le temps somnole, les voilà mangées des vers, décharnées, cadavériques, et s’ils pouvaient suspendre leur geste, les dieux, faire l’économie de la Création, bloquer les engrenages de l’horloge, bien sûr ils le feraient, je les connais, je ne parle pas à la légère, nous en débattons souvent, mais chacun de nous est rivé à son établi et si vous êtes Dieu, ce serait une jolie lâcheté et même une faute professionnelle grave que de renâcler au moment ultime et de ne pas créer la création. A quoi eussent servi les regrets ? Il eût fallu penser plus tôt à ces choses-là. Puisque j’avais accepté mes boîtes de soldats, j’étais condamné à monter un conflit. Je pouvais bien raconter que j’avais compassion, quelle hypocrisie ! Je n’étais pas là pour pleurnicher. J’avais un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre ! La guerre !
Je découvrais que les dieux ont des chouchous, que la vision de l’injustice est le plaisir de Dieu seul. Mes préférés servaient dans les troupes auxiliaires. Je les avais tout de suite appréciés, ils étaient nuls, donc inoffensifs : ils ne sortaient pas de Saint-Cyr, ils ne portaient même pas de fusils (visitant la trappe de Thamié, en Savoie, vers la même époque, 1936 peut-être, j’avais éprouvé des tendresses pour les frères convers, nuls eux aussi, et qui passaient leur vie à vider les fosses à purin pendant que les moines, les vrais soldats de Dieu, dont la vie, certes, n’étaient pas plus rigolote, avaient la récompense des habits rouges et dorés, des chants grégoriens, du faste des offices et de connaître le latin. Je me consolais en pensant que sur la route du Paradis ils filaient comme des fusées, les petites frères convers, ils remontaient le peloton et ils laissaient sur place les superbes abbés empêtrés dans leur mitre et leur gloire, de sorte que ma pitié changea soudain de camp, je la recyclai et j’en vins même à ignorer ces frères convers qui étaient des rusés, qui faisaient semblant d’être très bêtes, mais qui étaient malins comme des singes car ils avaient fait le bon choix : opprimés, crasseux et humiliés durant leur vie terrestre, c’est vrai, mais ensuite, dans le Ciel, la bamboula éternelle, au lieu que les abbés, bêtes comme leurs pieds, avaient fait un choix désastreux : choyés sur la terre et magnifiques mais aucune garantie pour l’éternité !)
Mes troupes auxiliaires étaient composées de braves types, des palefreniers, des cuisiniers, des intendants, des manutentionnaires, des spécialistes de l’épluchage de pommes de terre, des vaguemestres, des chevaux tirant des carrioles de munitions. Leurs uniformes étaient lugubres, pas un plumet et pas un brandebourg, des capotes grises, des molletières et des culottes taillées dans de mauvais tissus. A jamais hébétés, ils vaquaient tranquillement à leurs occupations et j’aimais surtout les plus humbles, ces pioupious préposés à la lessive qui étendaient éternellement des chemises et des pantalons sur de minuscules cordes à linge. J’organisais leur bivouac avec amour. J’en aimais la paix et la douceur, mais je ne me faisais pas d’illusion : une fois la guerre déclarée, ils étaient aussi exposés que les tirailleurs sénégalais et les obus les auraient vite écrabouillés.
Ces auxiliaires, qui étaient fabriqués, je me demande bien pourquoi, en Belgique, avaient une autre étrangeté : ils étaient plats, de simples silhouettes, comme si le grand état-major des soldats de plomb avait voulu marquer son mépris et n’avait engagé pour ces besognes misérables que des hommes d’une maigreur extrême, un peu de peau et un peu d’os. Face aux costauds qui servaient dans les troupes du front, hussards et dragons, chasseurs, cosaques ou tirailleurs, les auxiliaires exhibaient des constitutions physiques lamentables, des poitrines minuscules, des jambes de gerboise, des bras étiques, la première empoignade les anéantirait. Et comment allaient-ils s’y prendre pour mourir d’une manière un peu digne, c’est-à-dire atroce ? Ils périraient sans vraie douleur et si vite qu’ils n’auraient même pas le temps de hurler, encore moins celui de prononcer un dernier adieu (du reste, ils étaient probablement sans culture générale et ils ne sauraient que dire !) Possédaient-ils même des viscères et du sang, dans des corps aussi plats ? Ils allaient crever au premier souffle, de bombe, sans bruit ni trompette, sans même saigner, comme une rosée dans un soleil.
Le climat jouait un grand rôle dans mes actions militaires. Toute mon enfance, j’avais entendu des récits de la bataille de Verdun et je m’étais spécialisé dans la guerre de tranchées pluvieuses. Dans notre jardin de Digne, je creusais des boyaux compliqués, presque inextricables, le long desquels je disposais mes règlements de turcos et de Boers, mes grognards d’empire, mes Sénégalais et mes Annamites. Mes sapeurs construisaient des fortins et des casemates de paille ou de gravier, soutenus de quelques brindilles que je chipais dans le bûcher.
Au contraire de la tradition militaire, je ne lançais guère d’offensives pendant les mois d’été : c’est que les numéros de L’Illustrationprivilégiaient, je ne sais pourquoi, les photographies des moments de pluie et de boue. Aussi, je ne faisais la guerre qu’à partir de l’automne, souvent très tôt le matin pour bénéficier de la brume, ou bien que le ciel était à la pluie. Les tranchées étaient pleines d’eau. Mes troupes grelottaient. Je perdis plusieurs vaguemestres (qui sont des hommes effacés mais très courageux et tellement utiles car, enfin, si mes soldats avaient la force de tenir le coup, n’était-ce pas grâce aux lettres qu’ils recevaient de l’arrière ?).
Parfois, je faisais donner l’artillerie. Trempé comme une soupe, je bombardais les positions avec des cailloux qui soulevaient des geysers de boue et faisaient voler en éclats des corps désarticulés. La merveille était qu’une tranchée s’effondre. En quelques instants je perdais une section tout entière, les zouaves se noyaient à cause de leurs grandes culottes écarlates, les canons s’enlisaient, des prolonges d’artillerie naufrageaient, une casemate était emportée par une trombe d’eau. Dans le vent et la grêle, des compagnies d’infirmiers – dont je tiens à saluer le dévouement – se précipitaient avec leurs brancards. Elles dégageaient les blessés, entassaient les mourants dans des fosses communes, conduisaient les grands mutilés à l’arrière.
Là, j’avais quelques contentements car des infirmières voilées de blanc venaient les réconforter, les caresser de leurs jolies mains, de leurs seins, leur chuchoter des mots bleus, troublantes, elles étaient belles, on aurait dit un tas de mamans. Nous réchauffions les malades dans de petites laines, nous lavions tant bien que mal les plaies mais, bien entendu, dans la violence des intempéries, nous déplorions de nombreux disparus, des blessés, des mutilés, des ensevelis. Mes régiments étaient décimés. Je faisais monter de l’arrière des troupes fraîches, c’est-à-dire sèches et bariolées de frais. Parfois, nous arrivions à recomposer une tête coupée, par le moyen d’une allumette, mais combien de bras avaient disparu dans la tourmente, combien de pieds introuvables ?
Dès que la neige tombait, généralement vers janvier, je changeais d’époque. J’abandonnais les collines dévastées de l’Argonne pour sauter d’un siècle en arrière et ouvrir la campane de Russie. Plus question de tranchées, la Grande Armée n’aimait pas les tranchées et la neige recouvrait tout le jardin. Les boyaux, les casemates étaient invisibles. Le paysage torturé du Chemin des dames cédait la place aux grandes plaines vagues, lisses, blanches, illimitées, et sournoises de l’Ukraine ou de la Biélorussie. Le général Hiver avait pris les choses en main. Les chevaux mouraient de froid, les soldats congelés se faisaient des abris dans les viscères des chevaux. Je ramassais des pieds gelés, des bras gangrenés. Au printemps, quelques rescapés regagnaient leurs villages. Ils avaient d’affreuses blessures. Ils racontaient leurs souvenirs dans les veillées. Les femmes aimaient ces féroces infirmes, retour des pays froids.
Quelques années plus tard, la guerre de 1939 éclata. Toute la France regarda le ciel, dans la crainte de la Luftwaffe. Un vent de panique souffla sur cette ville de Digne, si éloignée du front cependant, et qui s’était, depuis la préhistoire, si bien gardée de l’Histoire. Les services de la Défense passive nous invitèrent à creuser des tranchées dans les jardins en prévision des bombardements.
Comme j’étais assez bon en jardinage et que j’avais planté une foule de poiriers dans le carré du fond, mes parents me confièrent la tâche d’ouvrir une tranchée en forme de croix (il paraît que c’était plus sûr, mais j’y voyais un inquiétant symbole) sur l’emplacement de mes anciennes batailles. Ce jour-là, je découvris, sous le fer de ma pioche, un bon contingent de soldats morts ou ensevelis dans les échauffourées de mon enfance. Dans un sens, j’étais heureux de les exhumer, de les délivrer de leur fosse commune, mais ils étaient dans un état regrettable, les années, les pluies et les neiges, les sécheresses des étés, tout cela les avait réduits à rien : le visage dévoré de rouille, leurs peintures écaillées, manchots ou unijambistes, aveugles ou paralytiques, j’en fis des charniers, je confectionnai des ossuaires.
Cette nécessité me permit de compléter ma formation de Dieu : trois ans auparavant, avec mes soldats de plomb, j’avais été le Dieu qui met en route le Temps, la vie et le chagrin. A présent, j’étais le Dieu qui met un terme à l’aventure et qui organise le Jugement dernier. Et comme une petite fanfare de soldats musiciens et plats étaient encore en état de marche, je les engageai à souffler dans leurs infimes trompettes. En trois années à peine, j’avais fait tout le parcours : en 1936, j’avais donné le départ à la Création, en 1939, je la déclarais close, j’étais un Dieu accéléré.
Dans les premiers jours de la guerre de 1939, nous avons connu une alerte aérienne, une seule en vérité, car la ville de Digne dut admettre, avec un peu de dépit et presque de la mauvaise humeur, que les troupes de l’Allemagne ne s’intéressaient pas beaucoup à elle. Peut-être même, sur les cartes de l’état-major allemand, les Basses-Alpes ne figuraient point. Je me souviens de cette unique alerte. Les sirènes hurlaient encore et déjà toute la famille s’était amoncelée dans ma tranchée neuve en forme de croix.
Tandis que nous guettions, sans grand espoir, le vrombissement des avions et le fracas des bombes, j’ai soudain vu apparaître devant moi, à quelques centimètres de mes yeux, collé dans la paroi de terre, un peu comme une fève dans un gâteau des rois, un ultime soldat de mes guerres d’enfance.
Il était mutilé, méconnaissable. Les trois années souterraines l’avaient défiguré, il me regardait de ses yeux morts, d’un air intrigué, et toute ma science militaire, qui n’était pas mince, échoua à déterminer s’il avait appartenu, du temps de son service actif, aux tirailleurs, aux cuirassiers, aux Osmanlis ou aux Heiduques. J’aurais bien aimé restituer le corps aux siens, c’était la moindre des choses, mais impossible de l’identifier, et quel embrouillamini si je me trompais de famille, quelles longues démarches administratives en perspective ! Je rendis le pauvre homme à sa boue.
G.L.

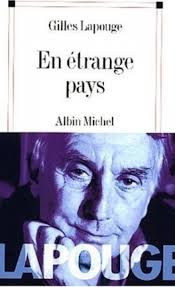



Émouvant récit. Merci Alain!