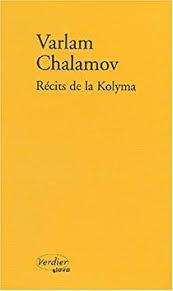Le bâton dans la neige de Chalamov
À propos de Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov,
par Françoise Delorme
Varlam Chalamov est né en 1907 à Vologda en Russie. La révolution de 1917 bouleverse la vie de ce fils d’un prêtre progressiste et d’une mère amoureuse de musique. Il s’installe à Moscou où il entre à la Faculté de droit et participe activement à la vie littéraire et révolutionnaire. Après une première arrestation en 1929, il passe de nombreuses années en prison et dans les camps. Envoyé en 1937 dans les mines aurifères de la Kolyma, il ne revient définitivement à Moscou qu’en 1953, à la mort de Staline.
«Il me faut un monde où on est partout chez soi. » L’homme qui écrit ces mots a passé 20 ans dans un univers inhabitable. Et le poète ajoute alors: «Je suis un homme du Nord Chaque jour je me cherche un gîte ». Chalamov a perdu toutes ces années. Il l’a toujours affirmé pour couper court à la fascination que son expérience de la Kolyma exerçait sur certains interlocuteurs. Pourtant, c’était sa vie; ce «matériau» inhumain lui a donné tant de fil à retordre pour devenir des poèmes, des proses et ce colossal ouvrage de 1 500 pages que sont les Récits de la Kolyma.
La force d’exister, de renaître ne l’a pas abandonné. Sans regret d’un passé pré-révolutionnaire, son amour des mots, sa puissance créatrice et la soif de comprendre le poussent à écrire dès qu’il retrouve l’usage de ses mains et de son cerveau, soutenu par Pasternak avec qui il correspond. Avant, il a retrouvé les livres des autres écrivains qu’il dévore nuit et jour quelles que soient les conditions.
D’après lui, des ruptures violentes sont sensibles dans l’expérience de chacun au xxe siècle, dues aux bouleversements politiques et scientifiques ; il s’inquiète du déchirement de la matière elle-même. Et ces récits rendent compte d’un émiette-ment douloureux, d’écartèlements mortifères. L’expérience des camps serait l’« image nocturne » de la condition humaine contemporaine ordinaire
Un narrateur se démultiplie sous de nombreux noms. Héros provisoire, il désigne ses failles intérieures comme le nombre infini d’hommes disparus dans la tourmente. La volonté de déployer un grand nombre de récits se double d’une organisation de l’ensemble auquel le lecteur français n’avait jamais eu accès. Pour moi, c’est un des mérites de la parution de ce livre. Chalamov avait eu heureusement la joie de le savoir édité comme il le désirait un an avant sa mort (à New York en 1981). Il se désola tant de voir ces textes paraître isolément, sans respect pour son immense travail de structuration, essentiel.
Et moi qui avais lu, admirative, beaucoup de ces récits d’une manière décousue, je vois apparaître aujourd’hui la force des relations que Chalamov a établies entre les textes. Il y applique les règles qui régissent dans son oeuvre le cours d’un récit comme la forme d’un poème : une charpente puissante et rigoureuse, un « laconisme » parfois brusque, une simplicité déconcertante. Une construction en hologramme reconduit les mêmes caractéristiques à tous les niveaux d’échelle, bousculée cependant par de nombreux « détails insolites » qui fracturent un ordre strict. Une polysémie d’une densité charnelle assure à chaque texte le plus large épanouissement et sur-tout une grande force d’expression : «je cherche le vif de la vie. »
Chalamov ne croyait plus au roman, il s’en est expliqué souvent. Une infinie fragmentation, ramifiée à nouveau, laisse pourtant circuler en elle une cohérence quasi organique, un intense mouvement générateur de la pensée et de la sensibilité. Le sens magistral d’une telle composition interroge plutôt qu’elle ne détruit la conception romanesque. La métaphore du fleuve du temps trouve là un de ses déploiements les plus mystérieux. En se renouvelant, elle ranime la part créatrice des questions et nourrit la pensée humaine.
A ce fil discontinu se tresse le fil immémorial de « la poésie de la nature ». L’animal traqué occupe la part terrible du livre, que ce soit le détenu toujours menacé, le chat qui sera mangé, les oiseaux silencieux, les chevaux plus fragiles que les hommes, la vermine. Le végétal, lui, signifie le désir de renaître, la renaissance elle-même. Un chapitre entier s’intitule La résurrection du mélèze et renvoie à une période un peu moins brutale de sa vie de prisonnier puis de relégué. Dans le récit du même nom, la femme d’Ossip Mandelstam reçoit une branche de mélèze envoyée par son mari, mort en camp dans d’atroces conditions. Arrivée sèche à Moscou, mise dans un vase, elle bourgeonne. Ce récit lyrique se termine ironiquement par l’évocation d’une réalité sordide : les détenus de la même baraque auraient réussi à faire passer pour vivant Mandelstam pendant deux jours, ce qui leur aurait permis de recevoir la ration de pain du poète. Le pin nain développe le thème de l’attente, parfois trompée : un feu allumé à côté de lui le réveille. Les flammes éteintes, il se replie sous la neige jusqu’au vrai printemps.
[…] La terre sous le signe de l’hiver Tandis que la glace luit et rayonne, l’arbre rajeuni et devenu vert de dessous la neige se lèverai […]
Chalamov a placé au centre de cet édifice qui est aussi un mémorial le chapitre Essais sur le monde du crime qui irrigue tous les récits de sa vigueur critique. Le premier de ces essais a pour titre A propos d’une faute de la littérature. Sévère à l’égard de nombreux écrivains, il dénonce la bêtise qui consiste à louer les criminels, à en faire des hommes libres, corrompant ainsi la notion de liberté. Même à Dostoïevski, il reproche de s’être détourné du problème des « truands », problème qui n’a pas fini d’empoisonner la vie des sociétés. Il analyse cette réalité, ces causes et ces effets humains et politiques. Une telle erreur d’appréciation a confondu le mal avec le bien. Nombre des errances collectives peuvent être attribuées à cet aveuglement. L’emprisonnement de masse dont il a été victime, prisonniers de droit commun et politiques mélangés, en serait aussi le résultat.
Le monde des truands est structuré par une indifférence absolue à l’égard de ce qui n’est pas eux («les hommes», c’est ainsi qu’ils se dénomment eux-mêmes !). Elle est sans faille et protégée par une rigidité tout aussi absolue des codes du groupe. Elle rejoint celle constitutive de tout organisme vivant acculé à sa survie, ce dont il fait l’expérience intenable. Cette indifférence ne peut être contrée que par une ténacité morale et une attention critique. J’entends l’écho multiple des interrogations sur le racisme, les génocides, la dangereuse idéologie de la différence.
Ces essais sont traversés par la violence inouïe des récits et par la mise en parallèle des actes des truands et des tentations dont la vie du détenu (mais toute vie) est parsemée: celle de se soumettre, celle de soumettre ou celle de se démettre. Ils offrent une réflexion complexe sur le pouvoir, sur la capacité de résister, un jugement ferme, sans angélisme et sans condamnation.
C’est sans doute l’originalité de ce livre que de nouer et dénouer la prose, la poésie et l’analyse critique en les fondant subtilement les unes dans les autres ou en les distinguant résolument. Ce mouvement crée dans l’esprit du lecteur un engagement de tout soi-même dans l’appréhension des récits ainsi qu’une lucidité qui s’accroît au fur et à mesure.

Ce livre procure une étonnante joie alors même qu’il dénonce une inacceptabilité de l’homme à lui-même, la joie d’une quête, celle d’une vérité impossible et sans origine, mais fidèle et vivace. Elle renaît en se formant sans cesse telle la branche de mélèze. Elle nous guide. Fragile, comme le bâton dans la neige, elle signale le chemin:
Je suis le petit jalon de la vie Un bâton planté dans la neige
Et, par les coups de scalpel si précis qu’il donne dans la pensée contemporaine, Chalamov se désigne comme un grand écrivain, pour long-temps parmi nous:
Pour se dépêcher de mourir Il suffit d’avoir le motif Mais je ne veux pas devenir L’objet des médecins légistes
C’est que j’aime toujours à l’aube Plus pure qu’une aquarelle, Le reflet laiton de la lune Et le trille des alouettes.
E D.
Varlam Chalamov. Récits de la Kolyma. Traduit du russe par Sophie Benech, Catherine Fournier et Luba Jurgenson. Verdier, 2003, 1 500 pages. Les poèmes sont extraits des Cahiers de la Kolyma (Ed. Maurice Nadeau, 1991) et de Les années 20 (Ed. Verdier, 1997). J’ai constaté l’extrême difficulté de citer des extraits des Récits de la Kolyma. Comme si chaque mot était à l’origine de tout le livre!
(Le Passe-Muraille, No 60, Avril 2004)