La vraie littérature vaut mieux que tous les prix même mérités…

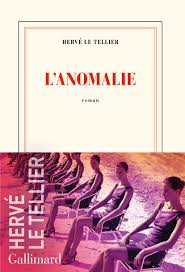

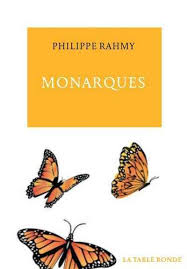
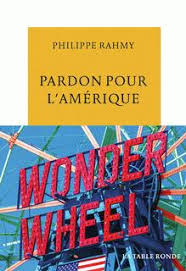
Entre un prix Goncourt reporté et un Grand Prix Ramuz attribué à titre posthume à Philippe Rahmy, le recul ironique s’impose plus que jamais à celles et ceux qui attendent de la littérature plus que des salamalecs convenus – sans jeter pour autant le bébé Qualité avec l’eau du bain mondain…
par JLK

Faut-il aujourd’hui se défénestrer pour lancer son nouveau roman, comme le suggère Hervé le Tellier dans son dernier roman, L’Anomalie, nominé pour les plus grands prix parisiens de cet automne ? Et faudra-t-il demain, tant qu’à réviser le passé, multiplier les prix littéraires posthumes pour exorciser les injustes « oublis » récents ou passés ?
Telles sont, entre autres, les questions qui se posent ces jours à propos des prix littéraires aussi courus par les uns que dénigrés par d’autres, quand ce n’est pas par les mêmes.
Ainsi d’un Paul Léautaud, esprit libre s’il en fut, qui frétilla en ses jeunes années quand son (délicieux) Petit ami frisa le Goncourt, et qui vitupéra plus tard l’institution des prix littéraires en affirmant qu’elle ne valait pas mieux, avec ses médailles, que celle du Mérite agricole.
De la même façon, mais avec plus d’exemples souvent hilarants, un Thomas Bernhard, titulaire de divers prix mais «oublié» du Nobel comme tant d’autres d’égal mérite (un Borges, un Joyce, un Nabokov, etc.), aligne dans Mes prix littéraires (Gallimard, 1998) les bonnes raisons personnelles que les auteurs ont d’apprécier les prix, leur offrant une possibilité soudaine de se payer un scooter ou une Rolls, autant que les bémols liés au caractère souvent arbitraire ou même bouffon de leur attribution. Dans notre proche entourage, nous aurons d’ailleurs vu à quel point un prix Goncourt peut valoir le meilleur et le pire à un auteur bien ou mal jugé en fonction de ce seul hochet.
Les prix incitent à lire : bon point…
Dans les années 70 du siècle passé où le prix Goncourt fut attribué à Jacques Chessex pour L’Ogre que, pour ma part, à 26 ans et avec toutes mes dents, j’ai osé déclarer «fait pour le Goncourt» dans la Tribune de Lausanne, à la fureur de l’intéressé (devenu mon ami plus tard, puis de nouveau mon détracteur furibond), le prix en question était régulièrement critiqué sous prétexte qu’un club d’éditeurs le «trustaient» par l’entremise de leurs jurés affiliés (on parlait alors de la cuisine interne des Galligrasseuil), mais un examen rétrospectif « objectif » permet de reconnaître que de très bons romans figurent au palmarès du Goncourt, depuis son origine, autant qu’à celui du Nobel de littérature, même si Céline ou Bernanos n’ont pas eu droit à celui-là ni Philiph Roth ou Milan Kundera à celui-ci.
Autant dire qu’une appréciation très relativiste du phénomène Goncourt, typiquement parisien en son centralisme mondain et commercial, s’impose plus que jamais avec les nuances requises liées à la large diffusion d’éventuels chefs-d’œuvre, à commencer par À l’ombre des jeunes filles en fleurs d’un certain Proust (Marcel), en décembre 1919.
Quant au Goncourt de cette étrange année 2020, en cette semaine même où il devait être attribué (reporté sine die par solidarité avec les librairies interdites de vente, comme le sera le prix Interallié), il en reste donc au niveau des supputations mais l’un des romans favoris me semble bel et bien mériter l’attention du grand public même s’il reste un peu (!) inférieur au chef-d’œuvre proustien…
D’une façon un peu différente, même si le Grand Prix Ramuz, qui a couronné naguère les œuvres majeures de Philippe Jaccottet, Alice Rivaz ou Georges Haldas, eût été objectivement plus « mérité » par un Etienne Barilier – auteur de plus de cinquante ouvrages et d’un roman récent (Dans Karthoum assiégée) figurant sans doute parmi les meilleures fictions en langue française de ces dernières années, son attribution posthume à Philippe Rahmy contribuera elle aussi à la meilleure illustration «officielle» et publique d’une œuvre de qualité quoique de moindre envergure en apparence – ce qui se discute.
Bavardage mondain s’ensuit avec ou sans virus, après l’éviction d’Emmanuel Carrère dont le (très bavard) Yoga « cartonne » sans être consacré, et le Médicis bel et bien attribué à Chloé Delaume qui papote elle aussi en toute bien-pensance parisienne, etc.
Et la littérature là-dedans ? Elle n’a pas de prix pour qui achoppe au détail et au plaisir…
Le pétulant professeur Meizoz, Jérôme de son prénom et parfois même écrivain (d’ailleurs excellent ici et là), s’inquiète ces jours de ce que la littérature soit de plus en plus formatée en fonction de critères commerciaux (belle découverte !) et s’américanise en somme à outrance.
Ce n’est pas d’hier que les universitaires enfoncent des portes ouvertes, et je m’en voudrais de défendre le règne de la triviale Quantité (eh !), mais ce qu’on se dit à la lecture de L’Anomalie d’Hervé Le Tellier c’est qu’un bon écrivain peut faire feu de tout bois en touchant à tous les genres, et pourquoi pas en s’inspirant des présumés stéréotypes de la littérature dite populaire ?
Après tout, Crime et châtiment de Dostoïevski relève de la littérature policière, et l’on trouve chez un Simenon, ou dans la science fiction d’un Olaf Stapledon ou d’une Doris Lessing, dans les contre-utopies d’un George Orwell ou d’une Margrit Atwood, autant de génie inventif et d’attraits esthétiques que chez maints auteur adulés par les « purs littéraires ». Raymond Queneau ne pensait pas autrement, ni Georges Perec après Marcel Aymé: à savoir que la fantaisie du romancier excède souvent les règles académiques et ne se salit pas les mains en prenant le métro avec Zazie, etc.
Un jeu virtuose et plus encore
Or Hervé Le Tellier s’apparente à ceux-là, dont le dernier roman relève du jeu littéraire virtuose mais sans se borner à la prouesse mécanico-ludique: en nous plongeant dans la substance vive de notre époque globalisée et de nos chairs solitaires, de nos feuilletons sentimentaux et des Grandes Questions sempiternelles que se pose le bonobo humain sur sa branche en prenant les dernières nouvelles de la théorie des cordes via son smartphone.
L’Anomalie, à l’instar des variations narquoises sur les aléas du monde numérique dans la série anglaise Black Mirror (cité dans la foulée), ravirait sans doute certain jeune cycliste prénommé Albert, (comme me le fait supposer le savoureux essai d’Etienne Klein intitulé Le pays qu’habitait Albert Einstein, paru chez Actes Sud en 2016) si quelque saut quantique lui permettait de rebondir en changeant de braquet temporel, des prairies d’Argovie de 1895 sur le tarmac d’une base militaire américaine en 2021 (l’année du roman), et le physicien « hérétique » Freeman Dyson, disparu en février dernier et dont je lisais ces jours La vie dans l’univers (Gallimard, 2009) serait conforté pour sa part dans l’estime qu’il porte aux (bons) écrivains de science fiction et à la littérature de tous les temps vouée à la recherche de vérités qui vont de pair, sans se mélanger les antennes, avec celles des sciences dites dures.
Conjectures rationnelles et sentiments vertigineux
Le thème du double est au cœur de L’Anomalie qui vous propose, si vous êtes pilote de ligne mais cancéreux en fin de vie au mois de mars 2012, de vous retrouver vivant à votre propre chevet en juin de la même année, comme deux amants séparés en mars se retrouvent en juin dans la mélancolie du vieillissement, au bord du vertige.
Malin et demi, Hervé Le Tellier pousse cependant plus loin, en oulipien de tendre empathie, le jeu conjectural des variations sur les thèmes du dédoublement spéculaire, du simultanéisme omniprésent dans notre nouvelle perception de la réalité, ou de l’ironique aperçu des réponses d’un bataillon de leaders spirituels réunis pour évaluer l’énigme posée par l’anomalie. De la physique chahutée, l’on passe naturellement aux confins de la métaphysique.
S’il nous la joue à l’ironie, pastichant les genres de la sit com ou des séries politico-policières, entre autres feuilletons sentimentaux, ses personnages n’en sont pas moins subtilement étoffés de l’intérieur, dialogues et détails souvent cocasses à l’appui, et comme une très singulière poésie en émane, où le tragique le dispute au comique. Goncourt virtuel mérité !
Les monarques du petit prince
Quant à Philippe Rahmy, en véritable héros de la « vie réelle », il a sublimé la terrible anomalie (maladie des os de verre) qui aura marqué son chemin de croix sur terre en se dédoublant, lui aussi, par la littérature, sans se payer de mots.
Deux premiers recueils de haut vol poétique (Mouvement par la fin, un portrait de la douleur, et Demeure le corps, chant d’exécration), un récit de voyage en Chine d’une pénétrante lucidité (Béton armé), et un roman sondant les tenants du terrorisme actuel en Angleterre (Allegra) ont marqué l’extension progressive de sa lutte contre le mal, jusqu’à la sublime rêverie réaliste à travers le temps et le chaos affolé de Monarques (La Table ronde, 2017) où les papillons californiens, symboles d’une harmonie mystérieuse, figuraient la quête d’un éden «capable d’accueillir leur migration».
Un an après la mort subite qui l’a frappé au cœur, le 1er octobre 2017, Philippe Rahmy nous est revenu à titre posthume ( !) dans l’espèce de chronique-reportage-confession-poème que constituait Pardon pour l’Amérique (La Table Ronde, 2018) récit flamboyant d’une enquête exploratoire à l’envers du décor de la téléréalité selon Donald Trump, avec les paumés qui ont élu le Président-Ubu, les laissés-pour-compte et tous ceux que l’écrivain en chaise roulante aura rencontrés entre parloirs de prisons et plantations, motels et routes au bout de nulle part.
Était-ce un ange aux ailes brisées ou un cinglé, une espèce de saint à roulettes ou un athlète cognant avec des mots la vie qui l’aura cassé plus souvent qu’à son tour ? De quelle terrifiante fragilité lui est venue cette force ? Comment, de la douleur éprouvée dans ses os de verre, a-t-il tiré cette énergie de fer ?
Et puis sacré filou: pourquoi ne pas attendre ce Grand Prix Ramuz au lieu de te carapater si tôt ?
Autant de questions qui font écho à celles que (se) posent peu ou prou les personnages de L’Anomalie; et l’on pourrait conclure qu’Hervé Le Tellier aurait pu intégrer un Philippe Rahmy et son double dans son roman, même si la vie a en réserve plus de folle imagination et d’imprévisibles surprises dans son sac à malices, avec ou sans prix en bonus…
Hervé Le Tellier, L’Anomalie, Gallimard 2020, 336p.
Philippe Rahmy, Béton, Allegra, Monarques et Pardon pour l’Amérique, à La Table Ronde.

Bonjour,
J’ai adoré,
La partie basse de la littérature proteste bien haut.
La partie haute de la littérature a besoin de vous pour accéder à sa haute et juste place!
Bon dimanche
Vince Fasciani