La vie prise dans la glace
À la veille du centenaire de Jünger, en 1995, nuances et détails,
par Thomas Hürlimann

Le 29 mars prochain Ernst Jünger aura cent ans. Alors tonneront les canons de l’anniversaire et les Allemands se mobiliseront. Soit ils se placeront, à gauche marche !, devant leurs salles de rédaction pour jeter une fois encore l’oeuvre de Jünger au feu, soit ils formeront avec Papa Kohl cette chaîne humaine à petites menottes qui s’étend de Verdun à Bitburg et qui se sent si bien au-dessus des cadavres, des cimetières et des champs de bataille. Nous sommes originaires de Neutralie. Jünger, ou Strauss, Benn, Heidegger, nous ne devons ni les jeter au feu, ni leur jeter des fleurs, et nous avons par conséquent le loisir de lire leurs livres et de considérer leur pensée.

A l’âge de 23 ans, Ernst Jünger est revenu de la guerre mondiale avec quatorze blessures, le «Pour le mérite»’ et une profonde découverte. Durant cette guerre, il le savait, avait débuté la mobilisation totale, une campagne de destruction de l’humanité contre elle-même. Pour l’auteur, une aubaine: il avait trouvé son sujet dans ses jeunes années, lui avait survécu, l’avait éprouvé et l’avait examiné à fond — il l’avait identifié: le véritable ennemi n’était plus l’adversaire, mais la technique, une puissante machine qui survole avec des avions les armées se faisant face, campées dans leurs tranchées, qui les submerge avec des chars d’assaut, qui les enfume avec des gaz et des nuages toxiques. C’était le début d’une ère nouvelle, l’ère de la fin, et son phénotype était le travailleur, ainsi que l’appelle Jünger, le technicien. A la différence du soldat, qui lance sa vie dans la bataille, le travailleur de Jünger n’est pas un guerrier, mais un anéantisseur. De manière pseudo-métaphysique, il est assis sur des hommes et des choses et agit en sorte qu’au-dessous de lui apparaisse un monde nouveau.
Cette «destruction systématique», écrit le jeune Jünger, est «funestement liée à la pensée économique de notre époque», aussi n’est-il pas étonnant que cet homme de 35 ans, quoique lu par Hitler, flatté par les nazis, soit parvenu à entendre derrière le murmure mythique et le fracas racial une tout autre mélodie, la vraie: à nouveau sifflait la commande de la machine à détruire, à nouveau l’humanité entrait en guerre contre elle-même.
Ernst Jünger se méfia d’emblée du national-socialisme, simplement parce que celui-ci était un mouvement, une mobilisation technique. Il ne manifesta aucune résistance, certes non, Jünger entra comme capitaine dans sa deuxième guerre. Mais à la différence de Benn qui, au moins en l’an 1933, opposait positivement «l’irrationnel» d’un peuple à «puissance créatrice» au «rationnel de la technique et de la démocratie», et à la différence de Heidegger, qui vit dans le mouvement des «Wandervogel» un élan vers l’esprit universel, Jünger ne se fit aucune illusion sur le caractère primaire et technique du nouveau Reich. Le capitalisme laissa armer et la bourgeoisie participa joyeusement. Hitler, genre chauffeur à moustaches, avait pris les commandes de la machine à détruire et la conduisit un puissant bout en direction du précipice. Sa fin fut à l’avenant. A l’approche des tanks russes, le chauffeur accompagné de sa femme, d’une secrétaire, se laissa asperger d’essence et partit en torche — comme s’il ne s’était agi que d’un accident de voiture. La machine exterminatrice, pourtant — entretemps chacun l’a appris — ne se laissa plus freiner, plus jamais, nulle part: ce qui est combustible est brûlé, l’eau est contaminée, la terre rendue stérile, et ce n’est qu’à zéro, dans l’asphyxie générale, que la mobilisation générale sera terminée, mission accomplie, monde détruit.

Voilà pour les thèmes de Jünger. Qu’en a-t-il fait en tant qu’auteur ? Fut-il capable d’apporter le «sinistre» mouvement dans la langue ? Déroba-t-il, comme Céline, l’appui aux phrases…, ses points en dégringolent-ils…, sa machine de mots fait-elle du bruit, fait-elle peur…, éprouvons-nous (à la lecture) leur (notre) vitesse, voire le crash ? En bref: la «guerre civile mondiale» se déroule-t-elle dans la prose d’Ernest Jünger? Jünger, il faut le savoir, est un entomologue amateur, il collectionne les bestioles et les insectes. Dans l’écriture, il en va de même. Ce qu’il a pensé ou vu, il le classe dans des vitrines, sous verre, il récolte, pose, fixe, expose, et naturellement, comme tout collectionneur, se soucie d’une certaine solidité, d’un bel ordre défunt, nature morte. Oui, précisément cet auteur, qui l’un des premiers a reconnu et compris l’accélération croissante, le bruit et la fureur de la Grande Machine, n’en transmet rien dans le style — le fleuve verbal de Jünger est pris par la glace, il est gelé, il est paralysé.
Alors que la littérature appelle le courant, une singulière disparité entre contenu et forme, entre la force des affirmation et l’honnêteté de l’expression naît dans les romans d’Ernst Jünger, qui, penseur, connaît tant de la vitesse et de la rasance. Ainsi établit-il ses prudents personnages de préférence sur des îles éloignées dans le temps, sur des écueils de marbre, à Héliopolis ou Eumeswil, où, dans un futur à l’accoutrement démodé, ils ne travaillent véritablement ni ne souffrent, mais donnent d’eux-mêmes, réunis en de vertueux cercles d’hommes effleurés par l’homosexualité, des idées intelligentes et/ou anarchistes. Comme, par-dessus le marché, ça se joue en partie au troisième millénaire, la machine est devenue ferraille, les tempêtes de feu sont passées, mais quand bien même, la langue de ces romans n’engendre aucun monde, ne reconstitue aucune réalité.
Dans son article sur André Gide, Ernst Jünger demande: «Que connaitra-t-on de cette oeuvre dans cent ans ?» Sa réponse: «On peut se quereller sur le sujet j’aime croire que plus tard aussi le grand Journal ne sera pas inutile aux esprits qui, rétrospectivement, fixeront leur attention sur les structure les plus subtiles de notre temps.»

Pour l’oeuvre de Jünger, la même chose pourrait valoir. Ses journaux intimes sont plus riches et plus importants que les romans. D’ailleurs, Orages d’acier — j’emprunte ceci au livre de Heimo Schwilks, Ernst Jünger, Leben und Werk in Bildern und Texten, paru chez Klett-Cotta — résulte des quatorze carnets de notes que le chef d’un groupe de choc, quatorze fois blessé, trimballa dans son porte-cartes. En 1929 parut Le Coeur aventureux, en 1949 fut publié Strahlungen et jusqu’à aujourd’hui, le très âgé et sage poète continue à noter ses jours et ses nuits sous le beau titre Siebzig verweht.
Alors se pose naturellement la question pourquoi réussit dans le journal ce qui reste plus problématique dans les romans. Jünger, ce fut dit, marcha à la première guerre mondiale comme un soldat adolescent et romantique, où il se trouva dépassé par la technique moderne à un point tel que cela dut lui couper la parole. Jamais et nulle part, il ne laisse agir dans ses phrases l’accélération subie, elles sont engourdies: glaçons dans le fleuve de glace. Dans le fleuve de glace ? Un livre grandiose de Helmut Lethen —Verhaltenslehre des Kalte — Lebensversuche zwischen den Kriegen, paru en 1994 au éditions Suhrkamp — démontre que justement même Jünger, le critique de la technique, pratique une nouvelle technique de la sauvegarde de son style: la congélation et la photographie. Cela signifie que, en même temps et parallèlement à l’accélération, se développe d’une certaine manière son contraire, soit la fixation, la conjuration de la vitesse sur la pellicule photo, de l’éphémère dans le compartiment à glace, et il n’est donc pas étonnant que Ernst Jünger, l’entomologue, préfère cette immobilité au dynamisme de la technique.
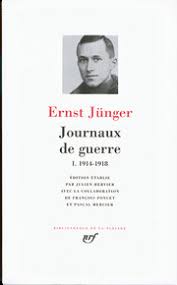
La technique de congélation et de photographie ne convient qu’exceptionnellement au roman — celui-ci aimerait couler et tourbillonner et frémir et murmurer. Dans le journal la méthode de Jünger fonctionne pourtant parfaitement. Son propre coeur est congelé et photographié de tous les côtés, ce qui en effet, comme le suggère le titre de son livre le plus fou, est une «Aventure». Jünger se tient au milieu de la vie, que ce soit jeune, vieux, très vieux, et dirige son objectif sur des livres, sur des phrases, sur des philosophes, sur des fleurs, sur Goebbels, sur des bestioles, sur les officiers allemands à Paris et sur un soldat mourant au front du Caucase. Ici une branche coupée, ici un déserteur fusillé; là un accident de voitures dans une ville extrême-orientale à la chaleur suffocante et là l’anniversaire de la mort du fils qui avait voulu suivre de manière tragique la carrière militaire de son père. Et toujours de nouveau son thème, sa connaissance de l’approche de la Grande Machine — une fois elle vient en escadron de bombardiers, une fois en courant de circulation, une fois idéologique, une fois camouflée, et déjà Ernst Jünger, l’éternel jeune soldat de choc, saute hors de la tranchée, sort l’appareil de photo et tente de mitrailler ce qui s’accroît en tonnant, puissant, fumée, explosion — tente de le mitrailler. Bref (comme lui, le mitrailleur, aime à dire): Jünger est tout sauf un conteur. Il s’en tient aux faits, même sous l’emprise de la drogue. Sa plume embroche et fixe, ses pensées sont claires, son thème est présent, les gaspillages ont de la méthode, et malgré tout il émane de ces aubes quelque chose de magique — photographies des mille et une nuits.


Oui, en cela aussi — pas seulement en tant que guerrier et chasseur de bestioles, pas seulement en tant qu’anarchiste et ami de chancelier, pas seulement en tant que porteur de décorations et d’années — cet Ernst Jünger dénigré par tant de bourgeois pantouflards est un phénomène: il n’a jamais écrit de grand livre, de chef-d’oeuvre, et malgré tout nous aimons croire que son journal «ne sera pas inutile aux esprits qui, rétrospectivement, fixeront leur attention sur les structures les plus subtiles de notre temps.»
Th. H.
(traduction: René Zahnd)
Notes du traducteur:


