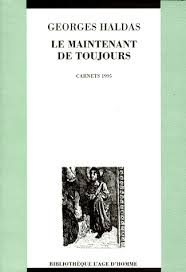La Source et le feu
À propos des carnets de L’État de poésie de Georges Haldas,
par JLK
C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, dont le neuvième volume vient de paraître sous un titre reproduisant l’expression de Maître Eckart: Le Maintenant de toujours. Dédié à l’ami Jean Vuilleumier comme l’était le premier titre de la série, Les Minutes heureuses, paru il y a vingt ans de ça et qu’introduisait une longue et très éclairante méditation sur la nature de ces «notes jour à jour d’un permanent voyage», cette nouvelle tranche englobe l’année 1995, et marque donc un rapprochement très net entre le temps de l’écriture et celui de la publication, mimant pour ainsi dire le rétrécissement du temps de vie imparti à l’octogénaire. Or loin d’accuser le moindre étriquement, Le Maintenant de Toujours saisit au contraire par une sorte d’expansion lumineuse et de fraîcheur lustrale que l’omniprésence de la référence à la Source (image de l’origine, de la Pure présence ou de Dieu tout simplement), ou la mention fréquente de telle petite fontaine de village à laquelle le scribe va s’abreuver, font découler de l’eau visible et invisible.
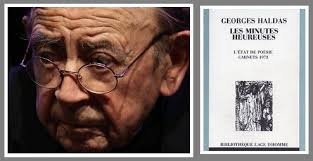
Lire les carnets de L’État de Poésie nous paraît une expérience sans égale, en tout cas à notre connaissance, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre. Nul «journal», sauf peut-être celui d’Amiel, ne nous plonge dans un tel état d’immersion, mais Amiel ne nous implique pas du tout de la même façon que les carnets d’Haldas. Nous pouvons aimer Amiel, l’admirer ou en être excédé, trouver admirable sa langue, sublimes ses évocations de paysages ou de moments du jour, prodigieuses ses analyses de caractères ou ses plongées en lui-même, passionnantes ses vues sur l’Histoire ou les œuvres de maints génies, émouvante et même bouleversante la modulation de sa destinée, mais jamais Amiel ne nous implique, jamais Amiel ne nous travaille, jamais Amiel ne nous met littéralement au travail sur nous-même (l’expression paraît bateau, mais c’est exactement de cela qu’il s’agit pourtant), jamais Amiel ne nous porte à la présence, et même à «l’hyper-présence», pour citer Haldas, avec l’intensité et l’ardeur qu’entretient la lecture de L’État de Poésie.
C’est que nous touchons, avec ces carnets, à une expérience-limite de la littérature. Cent et mille fois, Haldas a répété qu’il ne s’agissait pas d’un journal intime, précisant ici, une fois de plus, qu’ils figurent l’«atelier intérieur» d’un «scribe voué à l’essentiel». Or là encore on pourrait se tromper. Après tout, un Paul Nizon lui aussi nous plonge en état d’immersion, et tient ses carnets d’atelier. Mais rien à voir ! Et rien non plus avec le Journal littéraire de Léautaud ni avec les Journaliers de Jouhandeau. Et ce n’est pas parce que la préoccupation religieuse, voire mystique, est de plus en plus présente dans les notes quotidiennes d’Haldas, que celui-ci pourrait être apparenté aux journaux de Du Bos ou de Claudel, de Bloy ou de Calaferte. Pour la tentative de saisir à tout moment l’indicible, de capter le souffle même de la présence, de rendre une sorte de parole immédiate, nous pourrions évoquer les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, et pourtant L’État de Poésie est encore autre chose. Qu’est-ce alors ?
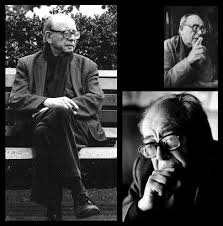
Disons que c’est un exercice de présence continue, un travail constant d’absorption et de combustion. «Dans L’État de Poésie, il ne s’agit nullement de fournir des informations, explique le scribe pour la cent millième fois, mais d’apporter une nouvelle manière de voir, de sentir et de dire ce que l’on voit et sent». À maintes reprises, Haldas se démarque du penseur («Dès que la souffrance entre en jeu, les théories s’effacent») ou du maître spirituel («Le pire qui puisse nous arriver, c’est de donner dans l’élévation spirituelle»), comme il n’en finit pas de fustiger les littérateurs et leurs vanités, sans oublier le diablotin qui gigote en lui («On ne dénonce, en fait, chez autrui que ce qu’on porte secrètement en soi-même»), les pions qui parasitent ce qu’il y a de vivant dans la littérature et même la «haute foutaise» d’écrire, jamais content de ce qu’il fait lui-même (et l’on sent bien que ce n’est pas une coquetterie, même si la critique peut le vexer lui aussi), mais non du tout par dépit esthétique (il est du genre à écrire mal pour mieux écrire vrai), bien plutôt par conscience de ne rendre qu’une infime partie de ce qu’il ressent ou pressent.
Et pourtant ! Et pourtant quel extraordinaire filtre de vie que L’État de Poésie. Ainsi, pour ne citer qu’un jour, ces quelques notes du 15 août 1995: «Le sentiment parfois d’être un tronc vieillissant et creux mais grondant d’abeilles. Dont quelques-unes seules parviennent à s’échapper» – «Ces passages d’un train dont la rumeur, dans la campagne, le soir, lentement décroît – Et c’est chaque fois un peu ma vie, avec l’enfance, qui se déchire». – «Il y a une douceur des choses qui par moments confine à la torture». – «L’effrayante pesanteur – et horreur – du biologique. Il ne fallait pas moins que l’invraisemblable Résurrection pour le contrer et attester l’existence de ce royaume en nous qui ne relève pas du biologique». – Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible encore aux autres qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».

Cependant, mais cela seul le lecteur peut le dire, ce «minable» nous désaltère et nous réchauffe comme aucun écrivain vivant. Lui qui dit n’avoir «rien écrit qui vaille», doit bien se douter au fond que ce qu’il écrit nous est plus nécessaire qu’à peu près tout ce qui s’écrit aujourd’hui. Il suffit qu’il note tel matin, pour marquer sa position par rapport au détachement mystique, et redire son amour de la vie: «L’émotion devant une cour abandonnée, un vieux vélo contre un mur. Ainsi le bruit d’une fontaine, un ciel de novembre, la voix d’un être cher disant simplement: «Quelle heure est-il» (mais surtout l’intonation de cette voix»). Et toujours, et encore, ces «minutes heureuses», à l’opposé de l’exaltation convenue, qui nous surprennent aux moments les plus inattendus, et diffusent leur douce lumière d’éternité, comme à cette aube où, après un séjour en Grèce, le scribe attend le bus qui l’emmènera à l’aéroport – et la lumière de Céphalonie lui restitue alors «un monde», comme on dit. Ou ces thèmes de plus en plus présent du «corps intime» et de l’eau vive, évidemment liés à ses méditations évangéliques. Et cette consumation de tout instant: «Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».
JLK
Georges Haldas, Le Maintenant de Toujours, Carnets 1995. L’Age d’Homme, 190 p. Viennent de paraître, en outre, deux recueils de poésie: Poèmes de jeunesse et Venu pour dire.
(Le Passe-Muraille, No 32, Octobre 1997)