La sève et le cri
À propos des « retrouvements » d’Anne-Lise Grobéty,
par Jean-Pierre Monnier
Native de La Chaux-de-Fonds où elle venait de passer son bachot, Anne-Lise Grobéty s’est imposée dès son premier récit. Elle s’était donné trois semaines pour l’ écrire. Elle avait dix-neuf ans, l’ âge des «tout ou rien», et personne ou presque ne savait rien d’elle quand elle a obtenu le Prix Georges-Nicole (premier du nom, c’était en 1969) et que son livre a d’emblée trouvé ses lecteurs chez les jeunes gens et les jeunes filles de son âge.


Dès la première lecture que j’en ai faite, Pour mourir en février m’ est apparu comme un de ces beaux objets, parfaitement sphériques, dont tous les éléments participent à la réussite de l’ensemble. Une rencontre, une rupture, et c’est au moment de la rupture que toute l’histoire se met en place et trouve sa plénitude.
Ce récit comme je les aime est de ceux où le message implicite, autrement dit la part du lecteur, est plus riche que le substrat de la narration, la part obligée de l’auteur.
Une rencontre, une rupture… Mais encore fallait-il les rendre attachantes au-delà de leur banalité et retenir le lecteur par des qualités d’ écriture assez évidentes pour être aussitôt reconnues. Tout n’est pas dans la manière, dans le style, mais quand leur nouveauté, plutôt que de dérouter, semble aller de soi et qu’elle parvient à rendre tout naturellement les impulsions du récit, créant à mesure le mouvement de l’histoire, c’ est quand nous sommes en bonne compagnie, celle d’un écrivain et non d’un raconteur ou d’un feuilletoniste.
En outre, et c’ est aussi pour moi ce qui d’emblée a fait le prix de ce livre, la juste distance où la narratrice a su se maintenir entre le sourire amusé et la tentation du tragique donne à son ironie une dimension proprement romanesque. Il ne s’ agissait pas, pour la narratrice, de «s’ éblouir» (ce grand mot), mais plus sagement, de tirer de sa déconvenue de quoi mûrir et se dépasser. «Il faudra que je pleure», dit-elle en guise de conclusion. Or personne, l’ ayant bien lue, ne saurait croire qu’elle mouillera son histoire de ses larmes. Elle en usera, tout au contraire, pour grandir encore.
Dans Zéro positif, qui a paru cinq ans plus tard, l’auteur aborde plus longuement, et parfois plus complaisamment, certaines des questions qui furent liées à l’ émancipation de la femme, non même pas asservie à des tâches subalternes, mais fatiguée d’ une sujétion qui la privait d’ être elle-même. Il est vrai que ce roman avait heureusement de quoi surprendre par d’ autres aspects: la maîtrise du monologue intérieur, par exemple, et le pouvoir suggestif qui était dans la hardiesse des images.
Pour Anne-Lise Grobéty, le temps était venu du mariage, puis des maternités, et elle allait siéger pendant deux législatures sur les bancs socialistes du Grand Conseil neuchâtelois.
Ces années-là ont été celles des engagements, et certes, ils ne l’ont pas chassée de sa table à écrire, mais elle n’y a été ramenée que par intervalles, et comme à la sauvette. En 1984, elle faisait paraître La Fiancée d’ hiver , un recueil de nouvelles, et, deux ans plus tard, ces Contes-Gouttes, des histoires brèves qui se laissent lire comme des morceaux de très bonne venue, à la fois cocasses et prestes, habilement troussés.
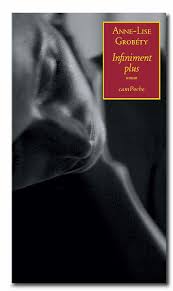
Pourtant, c’était là des exercices, mais ils allaient donner suite à un livre de plus longue haleine. Infiniment plus est un roman de la pleine maturité, une œuvre de grand retentissement qui, cette fois très explicitement, relate l’ histoire d’ une nouaison, étant entendu que ce terme doit être compris métaphoriquement. Comme l’ ont été les héroïnes de Pour mourir en février et de Zéro positif, il s’agit encore d’une jeune femme en attente d’ elle- même.
Evidemment, rien dans ce roman (comme dans les autres) n’est vrai. Anne-Lise Grobéty est un auteur de fictions. Néanmoins, tout ce qu’elle dit de la poursuite fièvreuse de son personnage sur les pas de deux gymnasiens dans les rues de La Chaux-de-Fonds, tout cela est plus vrai que le vrai. D’ailleurs, et ici encore, le mouvement qui conduit l’héroïne, une jeune femme, de rue en rue et qui traduit son désir jaloux d’un bonheur qui n’est pas le sien, ce mouvement irraisonné (et à peine raisonnable) obéit aux pulsations rythmiques des phrases, au choc des mots et à l’ accumulation des images. C’est comme si tout, dans ce roman, était porté par un élan verbal qui ajoute sa propre signification à toutes celles qui sont suggérées par le comportement et les allées et venues des personnages.
Et puis, ce qui me paraît aussi important, c’est que la libération à laquelle parvient finalement l’ héroïne est porteuse, cette fois encore, d’une promesse, une ouverture, comme si déjà l’ épanouissement de la fleur en son fruit était assuré. C’ est pour moi tout le sens de ce roman quand j’en oublie l’anecdote et les péripéties, et ce sens rejoint celui qui a guidé la romancière quand elle a écrit son premier récit comme sous le coup d’une brusque illumination. Pour mourir en février , c’est en effet moins l’histoire de deux femmes dont l’aînée est peut-être une lesbienne (mais peu importe !) que l’ histoire, chez la cadette, d’une mort à soi-même et d’une résurrection – un «retrouvement», disait Ramuz.
Or ce retrouvement, qui constitue le motif des romans d’ Anne- Lise Grobéty (retrouver mars après février, mais aussi retrouver son identité après une longue errance dans les rues d’une ville), ce retour à soi-même par quoi s’achèvent les nouaisons réussies des personnages («Et les fruits passeront la promesse des fleurs»), c’est finalement tout ce qu’elle a voulu dire.
Pourtant, même si la thématique de la romancière répond d’une profonde unité, ce qui pour moi est une preuve d’authenticité, elle a dit à chaque fois autre chose, dans une autre tonalité, sous une autre lumière et avec d’autres mots, d’autres figures.
J.-P. M.

Musiques de « l’endouleur »
Il ne faut pas perdre un mot du dernier livre d’Anne-Lise Grobéty, dont chaque pièce miniaturisée s’ inscrit dans une manière de constellation. Le noyau de chacun de ces petits astres est un pré-nom, qui tire son orient d’une heure du jour ou de telle couleur saisonnière, de telle année particulière. Ce fut en janvier que Niva passa du printemps de sa jeunesse à l’ hiver d’ une première désillusion; une après-midi de neige candide que Paulia, dans sa luge d’enfant, enregistra pour jamais la dernière colère de ses parents en rupture; au vert d’avril que Liviane troubla son pasteur en lui avouant sa ferveur toute spirituelle; un lundi fatal que Sélène fut rejointe par le malheur sur le «versant du sourire»; en l’an 43 que la Polonaise Anka suivit de sa fenêtre les ombres des damnés voués aux fosses communes; à la pleine lune que tel frère et ses deux sœurs jouèrent au paradis sur terre; en été que Jacée des pâturages languit d’être aimée; la nuit que Nilla souffrit du ronflement de son amant plus incongru que le «camouflet d’ un gros pet»; en fin de soirée que Dulcie compatit avec telle autre mal-aimée lui faisant penser que la vie est surtout faite d’être qui aiment des êtres qui ne les aiment pas», ou encore à la tombée du jour que Myrthe, pour se délivrer du poids de sa pauvre existence, en écrasa une autre…
Cela tient à presque rien, comme autant de figures de givre sur une vitre. Autant dire que l’essentiel d’un tel livre ressortit à son écriture. Mais quelle musique claire et sonnante, songeuse, ombrée, pensive, se dégage de tous ces mots, pour l’exorcisme de «l’endouleur».
JLK

