À la rencontre de Nancy Huston
La Sainte Famille
(Récit inédit)

Noël 1959.
Ja. La chaleur, cette maisonnée, et l’immense table en chêne dressée pour le repas du soir, un grand repas, un repas de famille, et la petite dame douce et boulotte aux cheveux gris attachés en chignon, qui s’affaire en ce moment à rajuster les couverts en vrai argent, est désormais ton Oma, c’est-à-dire grand-mère, et le gentil vieillard aux cheveux blancs coupés en brosse et aux yeux bleu ciel, qui joue en ce moment des chants de Noël au piano, est désormais ton Opa, c’est-à-dire grand-père, et cette jolie brune jeune et svelte est désormais ta Mutti, c’est-à-dire mère, alors que la fillette blonde à qui tu continues de parler en anglais est toujours ta soeur, pas ta Schwester — et regarde, regarde toutes les bonnes choses qu’on est en train d’étaler sur la table, les tranches noires de Pumpernickel, la pâte lisse et brune du Leberwurst — et chante, chante les chants de Noël dans cette langue nouvelle et étrange, oui on mange de la langue aussi, sens les formes croustillantes de ces nouvelles consonnes sur tes lèvres et sous tes dents, ces nouvelles voyelles dans ta gorge, dankeschön, bitteschön, du bist sehr schön, tu es très mignonne dans ta nouvelle jupe, et bien sûr que tu retrouveras ton père et ton frère un jour, ne t’inquiète pas, voici la crèche, la Nativité, voici l’enfant né de Marie, et ça c’est Joseph, l’époux de Marie mais non le père de l’enfant, non, le père de l’enfant est au paradis, on ne peut pas le voir, c’est un miracle, voilà pourquoi des notes joyeuses et assourdissantes giclent de l’orgue à la cathédrale et Kling, Glöckchen, klingdingeling, les cloches résonnent, l’enfant est né, voilà pourquoi les rois mages se mettent à genoux dans la paille et les tantes et les oncles et les cousins s’assemblent autour de la table en chêne, soir après soir, les bergers poussent un cri de frayeur devant l’étoile qui brille si fort, là-haut dans le ciel, c’est le village de Bethléem, le village d’Immerath, la cour de l’auberge, la cour de l’école, Hier Kinderlein kommt !, ils viennent, les enfants, ils zigue-zaguent dans la neige en s’interpellant de façon incompréhensible, le boeuf et l’âne près de la crèche, l’enfant emmailloté dans ses langes, et oh ce moment magique, juste avant le repas, où Oma allume les bougies, le silence tombe, les têtes se penchent, et Opa prononce le bénédicité de sa voix si grave et chaleureuse, Nun danket heile Gott, maintenant c’est l’heure de manger — essen, pas fressen, il ne faut pas confondre les mots, quand tu les confonds les adultes explosent de rire, essen veut dire manger et fressen veut dire bouffer, se goinfrer comme un animal — goûte ça, c’est une nouvelle sorte de fromage, Käse, et voici le pain, Brot, il ne faut pas tout mélanger, fröhlich, heureux, fürchterlich, horrifiant, ceci est ta Muni mais ce n’est pas ta mère, ne confonds pas, ta mère est invisible, elle n’est pas allée au paradis mais une force sacrée et impénétrable l’a subitement déplacée de sorte que tu ne peux plus la voir, la sentir, la toucher, la goûter, les chocolats, Chokolade, sont extraordinairement doux, et toi aussi tu dois apprendre à être douce maintenant, Notre-Seigneur Jésus-Christ est né et il faut que toi aussi tu renaisses, plus douce cette fois, veux-tu aller faire des courses avec Opa, les confiseries s’appellent Bonbons, veux-tu entrer dans le magasin acheter des Bonbons, le sac en cellophane froissé et craquetant noué d’un joli ruban doré, comme la jolie étoile dorée tout en haut du Tannenbaum, viens nous aider à décorer l’arbre qui brille et qui scintille, des boules argentées, rouges et bleues, époustouflantes et boustifailles, non non, pas boustifailles, pas fressen, seulement essen, et ces nouvelles sucreries en forme de fruits, goûte-les, non tu ne dois pas les recracher, même si leur apparence est trompeuse, elles ne sont pas parfumées à la banane, à la fraise, à l’orange, elles ont toutes le même goût, Marzipan, pâte d’amande, elles sont wunderbar, merveilleuses, et tes tantes et oncles et cousins sont wunderbar eux aussi, si bons pour toi et ta soeur, pauvres petites, regarde les nains dans la vitrine du grand magasin, ce sont des cordonniers, ils tapotent avec des marteaux sur les semelles des chaussures, ils se grattent la tête et roulent des yeux mais ils ne sont pas vivants, alors que toi si, si si, tu es vivante, et regarde main-tenant cet autre cadeau, un petit ours, tu peux le remonter et il fera tinter ses cymbales, les cymbales tintent, les cloches résonnent, Jésus est né, le petit ours déplace son poids d’un pied sur l’autre, les nains en bois tapotent et dodelinent de la tête, le bébé en bois emmailloté dans ses langes ne bouge pas du tout mais il est vivant, il nous a même donné à tous la vie éternelle, voici encore un cadeau, apporté par un voisin au beau milieu de l’après-midi, une longue boite rectangulaire au couvercle en cellophane, qu’est-ce ? non, ce n’est pas pour toi, c’est pour ta non-grand-mère, Oma, la voici qui arrive en courant, le visage rouge d’excitation, elle s’essuie les mains rouges sur son tablier et soulève le couvercle, tout le monde s’assemble pour regarder, qu’est-ce ? Oh c’est un manchon de fourrure, comme c’est beau, comme c’est nouveau, non, encore faux, c’est un animal à fourrure, un vrai chaton vivant, encore faux, te disent-ils en explosant de rire, c’est un Haase, un lapin, voilà qui est vraiment spécial, Oma te laissera sûrement jouer avec son Haase, faux encore, il n’est pas vivant, les doigts rouges d’Oma ont saisi ses pattes arrière et il pendouille maintenant la tête en bas, les orbites noires et vides, elle tend le bras pour s’emparer du couteau et ce soir tu le mangeras en ragoût, essen, pas fressen, pas comme une bête sauvage, wunderbar, les verres en cristal tinteront, les lumières sur l’arbre scintilleront, et tous tes nouveaux parents chanteront encore un autre cantique joué au piano par Opa, jour après jour, les douze jours de Noël, wunderbar, car le miracle s’est pro-duit, l’enfant est née.
(Extrait d’un recueil inédit)

Une œuvre incarnée
L’oeuvre de Nancy Huston, comptant douze romans et dix essais, se déploie au fil d’une écriture constamment irriguée par la vie. Des Variations Goldberg – son premier roman -, aux textes choisis (1981-2003) d’Ames et corps, le passage de l’immersion romanesque à la réflexion claire et nette n’a cessé de se faire en fonction d’une démarche alternée et tenue ensemble par un regard et un ton uniques. Il y a du médium chez Nancy Huston, dont l’empathie affective se double d’une aptitude rare à capter et restituer les multiples voix de ses personnages, comme l’illustre notamment l’admirable Dolce Agonia et sa cène profane réunissant, un soir de Thanksgiving, une douzaine de passagers du paquebot Terre.


Née à Calgary, avec des racines américaines dont témoigne Cantique des plaines, alors que son exil l’a amenée à une réappropriation magistrale de la langue française, la romancière-essayiste aura marqué la dernière saison littéraire avec Professeurs de désespoir, essai polémique visant les «néantistes» et toute une littérature adulée de nos jours, de Cioran à Houellebecq ou d’Argot à Jelinek, décriant la filiation et la complexité de la vie au bénéfice d’une certaine pose artiste…
JLK
Échos d’une (vraie) rencontre

Notre première intention était de publier ici un entretien avec Nancy Huston, avec la double visée d’un éclairage plus précis sur la genèse de Professeurs de désespoir et une approche de l’écrivaine en personne. Deux premières rencontres, à l’automne 2004, dans un bistrot de la Contrescarpe et, quelques semaines plus tard, en son appartement du Ve arrondissement, avec un petit café préalable en présence de Tzvetan Todorov, son compagnon légitime, puis dans une soupente affleurant les toits de Paris et idéalement appropriée au travail d’un écrivain, sans être pourtant la véritable thébaïde de la romancière, qui a besoin de plus de distance par rapport à « la maison » et loue quelque part un studio rien qu’à elle — deux rencontres donc nous ont déjà fourni une matière substantielle augmentée de courriers divers, alors que nous poursuivions la lecture exhaustive d’une oeuvre tardivement découverte, à la parution, en 2001, de Dolce Agonia.
C’est ainsi : on passe parfois à côté d’une oeuvre déjà connue et même célébrée, comme on tourne longtemps autour de tel ou tel chef-d’œuvre sans y entrer, et tout à coup crac dans le sac je tombe sur l’écrivain que j’attendais. Ou plus précisément : que je devais rencontrer à ce tournant de mon parcours — ce qui s’appelle une vraie rencontre.
Mais comment raconter aujourd’hui celle-ci pour aller au-delà de l’honnête entretien tel que nous l’aurons publié, après notre première entrevue, dans le quotidien lausannois 24 Heures en date du 30 octobre 2004 ?
C’est ce petit défi que je voudrais relever ici, dépouillant le « nous » impersonnel, pour dire un peu mieux ce qu’a représenté cette vraie rencontre d’un écrivain et de son oeuvre, aussi importants désormais pour moi, parmi les vivants, qu’un Coetzee, un Naipaul, un Amos Oz, un Philip Roth ou un William Trevor.
Lorsque j’écris « et de son oeuvre», j’inclus aussitôt le rire de Nancy, le canari de la cuisine dont la longue table suggère force conversations amicales, sa crève et la tisane de notre premier rendez-vous (une heure calée genre «pro»), et le sourire sagement ironique de Tzvetan, notre première parlote sur nos enfants respectifs et les avantages et désavantages comparés de la vie en campagne ou en ville…
Sur quoi nous reprenons un peu de distance pour couper court à des familiarités prématurées et détailler notre seconde conversation.
Parle-t-on plus librement lorsqu’on commence de se tutoyer ? Je me le suis demandé en réécoutant l’enregistrement de notre deuxième conversation, tout en me rappelant mes petites observations latérales : la belle mansarde à solives aussi bien tenue que l’appart, les photos-images-objets fétiches, l’armoire aux archives super-organisées dont elle a tiré le texte inédit aussitôt dupliqué nickel, la question polie de la fumeuse à l’ex-tabagique et son plaisir à te voir savourer son scotch…
Tout ce que Nancy Huston m’a dit de son malheur d’enfant dans une enfance heureuse, de l’abandon de sa mère et de son horreur d’être elle-même, de la famille recomposée et de sa folle fringale de lire, de ses premiers écrits (poèmes, journal intime) et de ce texte que démolit un con de pion (la bonne épreuve tueuse qui aide plus qu’on croit…), ce qu’elle m’a raconté aussi du frère complice puis du jeune prof-mentor-amant qui lui apprit tant de choses avant d’autres, tout cela je le savais plus ou moins déjà, l’ayant lu dans le récent recueil de Ames et corps et même avant, au fil des propos recueillis dans le dossier préparé par Alain-Gérard Daudon sous le titre de Ce que dit Nancy et qu’on retrouve en cliquant sur initales.org, de même qu’à l’adresse internautique de périphéries. net se retrouve une très substantielle présentation de Mona Chollet crânement intitulée : «Je suis donc je pense : la révolution copernicienne de Nancy Huston.
Malgré ce déjà-su, cette «vraie rencontre» s’est bel et bien étoffée cette après-midi même si je constate à l’instant, resongeant à toutes les lectures que j’aurai faites entretemps, et particulièrement de Prodige, Histoire d’Ornaya et L’Empreinte de l’ange, que je n’aurai fait que «vérifier» physiquement, si j’ose dire, la densité réelle d’une présence et d’une aura.
Cette présence et cette aura sont celles d’un profond amour que je sens autant dans les livres que dans la personne de Nancy Huston, même ne la connaissant qu’à peine. Mais je précise aussitôt: que cet amour, comme celui de Thérèse d’Avila frottant les parquets de l’appart du Seigneur, s’évalue d’abord et pour l’essentiel, à l’écart de toute convention sentimentale, par les nuances et détails de la vie ici-bas, la puissance d’incarnation de ses romans et la résistance de sa pensée à l’inacceptable.
Nancy ne se paie pas de mots. Lorsqu’elle te raconte comment Tzvetan lui a fait découvrir, en pratiquant lui-même la chose avec son propre enfant, la beauté de la prise en charge d’un môme et des travaux ménagers, ou lorsqu’elle vous évoque ce qui, fondamentalement, détermine à ses yeux le recours à la fiction (la fiction qui ne peut s’en tenir à un «discours du bonheur », la fiction qui seule tend à réduire l’écart entre ce qui se peut dire et l’indicible ou l’impensable, la fiction qui tantôt s’organise en architecture concertée style Variations Goldberg et tantôt te tombe du ciel comme L’Empreinte de l’ange), ce que dit Nancy fait écho à ce qu’écrit Huston, et c’est ça la vraie rencontre aussi qui commence et recommence, ici et demain.
JLK
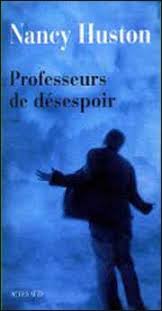
À propos de Professeurs de désespoir
Le désespoir est-il la plus belle conquête de la littérature contemporaine ? Une oeuvre est-elle fondée en vérité et en universalité à proportion de son nihilisme ? Et à quoi tient l’adulation dont bénéficient, dans la postérité d’un Schopenhauer, ces auteurs certes éminents mais non moins « néantistes » que représentent un Cioran ou un Beckett, un Thomas Bernhard ou un Milan Kundera, et ces épigones plus récemment glorifiés en les personnes de Michel Houellebecq ou Christine Angot ? Enfin y avait-il de quoi pavoiser à l’annonce, en automne dernier, de l’attribution du Prix Nobel de littérature à l’Autrichienne Elfriede Jelinek, incarnant précisément l’esprit de ressenti-ment le plus corrosif?
De telles questions sont posées et discutées, dans le der-nier essai de Nancy Huston, d’une manière très directe que d’aucune trouveront carrée, voire irrecevable en leur naïveté présumée (la réaction de macho teigneux d’un Michel Polac ne s’est pas fait attendre), étant entendu pour beaucoup qu’un silence pieux s’impose plutôt devant telle atteinte à la bienséance littérairement correcte. Comment donc, une bonne femme, et de surcroît native de la prairie canadienne, oser chicaner de tels génies et si stylés stylistes ! ? Ainsi ces Pro-fesseurs de désespoir auront-ils été plus ou moins ignorés, mais surtout pas discutés, par l’intelligentsia parisienne, alors même que l’ouvrage rencontrait, auprès du public, un accueil beaucoup plus favorable. Or la remarque vaut pour d’autres livres de Nancy Huston : très appréciés de nombreux lecteurs et de libraires, mais souvent snobés ou sous-évalués par la critique littéraire établie.
La littérature prise au mot
En matière, précisément, de critique littéraire, Nancy Huston a pourtant le premier mérite, dans Professeurs de désespoir, de renouer avec une grande tradition de la discussion liant les oeuvres à la condition humaine, l’éthique à l’esthétique, tout en « vivant » elle-même l’exercice avec le tempérament, la fougue, la malice, l’invention propres à l’écrivain. Dès, ainsi, qu’elle introduit son thème en se rappelant ses premiers agacements éprouvés à l’approche d’un Thomas Bernhard, puis son exploration systématique de l’oeuvre et sa meilleure compréhension de ce qui l’a rebutée au premier contact, aurons-nous éprouvé cette même impression qu’à la lecture des essais d’un John Cowper Powys : que la littérature est ici réellement prise au sérieux, que les mots comptent, que les positions de ces mes-sieurs-dames restent à discuter autant qu’il est légitime de savourer leur «petite musique ». Mais assez d’engouements saisonniers et de vénérations convenues : retour à ce que disent réellement les écrivains.
Pour le lecteur ne connaissant pas Nancy Huston, notons dans la foulée que celle-ci n’est pas du genre à «positives », les yeux sur le petit coin de ciel bleu cher aux amateurs de littérature rassurante. Dans L’Empreinte de l’ange, l’un des plus beaux de ses romans, dont l’intense rayonnement amoureux est traversé par le bruit et la fureur de la guerre passée et d’une autre en train d’ensanglanter l’Algérie, l’amant hongrois de la protagoniste allemande, après lui avoir désigné l’emplacement du visage où l’ange marque son signe d’oubli, qui permettra au nouveau-né de supporter son séjour terrestre, ajoute ceci de bien explicite : «Sinon, qui veut naître ? Qui accepte d’entrer dans cette merde ? Ha ! Personne! On a besoin de l’ange!».
C’est dire que ce que Nancy Huston affronte et com-bat dans Professeurs de désespoir n’est pas le pessimisme nourri d’expérience mais la réduction de la vie à « que de la merde » et l’oubli de tout ce qui fait le prix de la vie, la négation des nuances et des détails.
Nancy Huston ne s’en lais-se pas conter. C’est un trait fréquent chez ceux qui ont souffert étant enfant. On ne la leur fera plus. Thomas Bernhard l’a certes d’abord fascinée, comme nous tous, puis l’imprécateur l’a énervée et fatiguée, non sans lui offrir, à son corps défendant, un personnage d’accompagnement présent tout au long de Professeurs de désespoir, en la figure de Déesse Suzy
Mais qui diable est cette Déesse Suzy? Elle émane d’une boutade de Thomas Bernhard, au cours d’un entretien de l’écrivain avec la journaliste Krista Fleischmann, où l’écrivain, après diverses tirades d’une misogynie carabinée, daubait sur l’impossibilité d’adorer une divinité femelle: « Dieu est un monsieur, c’est un être masculin, n’est-ce pas. On ne dit pas (il rit) Déesse Suzy à l’église. Elle n’existe pas. Du reste, qui l’adorerait ? (Il rit) Quand elle serait enceinte tous les ans ce serait pénible, n’est-ce pas. Ce n’est pas possible. N’est possible qu’une figure qui soit plutôt statique et qui reste là en permanence, même si elle est assez insipide, mais qui ne soit pas sans arrêt en mouvement, une fois grosse ou l’autre mince. »
De quoi se désopiler ?
Tout le monde est censé rire. Tous les mecs en tout cas « qui en ont» sont supposés rire comme aux boutades de Baudelaire sur les femmes et les Belges. Rien aussi bien de plus drôle que Schopenhauer qui débine les femmes et les barbus avant de s’exclamer que «le seul est de ne pas naître », rien de plus irrésistible que les femmes de Beckett qui « accouchent à cheval sur une tombe», ou que Cioran qui affirme que «vivre véritablement, c’est refuser les autres », que Jelinek qui martèle qu’a aucune vie artistique sérieuse ne peut être compatible pour une femme avec des enfants », que Michel Houellebecq qui nous serine que nous sommes des « suicidés vivants», vraiment rien de plus désopilant, surtout quand l’amer Michel conclut de son air de furet déprimé : « Soyez abjects, vous serez vrais. »
Littérature que tout cela? C’est ce qu’on objectera dans les salons, mais encore ? Cela ne cache-t-il pas autre chose ? Pour-quoi nos fauteurs de désespoir professent-ils le même élitisme solitaire et le même dégoût de la procréation, le même mépris pour la vie terrestre et la même adulation de l’Art ? Enfin à quoi tient pour eux l’oubli, le déni ou le mépris de l’enfance ?
A ces questions, Nancy Huston répond sur la base d’une série d’oeuvres significatives, en distinguant à la fois les générations des écrivains adultes pendant la Deuxième Guerre mondiale (Beckett et Cioran), ceux qui furent enfants ou adolescents pendant la même période (Imre Kertesz, Thomas Bernhard et Milan Kundera) et ceux qui sont nés après 1945 (Elfriede Jelinek, Sarah Kane, Michel Houellebecq, Christine Angot et Linda Lê). Enfin, elle inclut les contre-exemples de Jean Améry et de Charlotte Delbo, rescapés des camps dont les oeuvres résistent pourtant à toute conclusion nihiliste.
Discussion ouverte
Pour autant, Nancy Huston ne se borne pas à distribuer bons et mauvais points. Peut-être pourrait-on lui reprocher ici et là (notamment pour ce qui concerne un Imre Kertesz, mais aussi par rapport aux récits d’enfance de Thomas Bernhard ) de faire trop court ou de simplifier pour mieux prouver? Cela étant, sa lecture de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas nous révèle bel et bien l’ombre pressentie, chez Kertesz, d’un rejet absolu de la filiation qui fige son oeuvre dans le plomb de la tristesse. De la même façon, l’accent porté sur le matraquage solipsiste de Bernhard, qu’elle rapproche de l’hystérie des discours hitlériens, ou ses observations sur le révisionnisme autobiographique de Cioran et sur l’horreur manifestée par Kundera pour les enfants, méritent à tout le moins la discussion.
Toutes les questions sont permises, et tout se discute : voilà ce que nous rappelle Nancy Huston dans cet essai autant que dans ses romans. Il est bien peu d’écrivains, par les temps qui courent, qui prennent ainsi la littérature au mot pour en évaluer le sérieux et les conséquences. Puisse le lecteur s’engager, à son tour, dans cette réflexion sur pièces aux visées essentiellement vivifiantes. La moindre nuance, le moindre détail suffisent à distinguer ce qu’on pourrait dire le parti du Rien et le parti du Lien, entre lesquels chacun de nous balan-ce à tout moment. Or, plus qu’une position, c’est une dis-position inscrite dans le temps de chacun que Nancy Huston illustre dans Professeurs de désespoir autant que dans la pensée incarnée de ses romans.
JLK
Nancy Huston. Professeurs de désespoir. Actes Sud, 2004.

Les dits de Nancy Huston
Perception de la mort
«Je suis frappée par la façon différente, chez les hommes et les femmes, de percevoir la mort et d’exprimer la peur de celle-ci. J’en suis venue à me demander si les hommes n’avaient pas plus peur de mourir que les femmes. »
Sur le nihilisme
«J’ai été nihiliste en mes jeunes années. Je sais très bien ce que c’est d’être une jeune fille anorexique, fragile, solitaire et brillante qui erre dans une grande ville avec des envies de suicide. Comme j’ai moi-même été abandonnée pax ma mère, je ne savais pas vraiment ce que c’était d’être mère. J’ai dû l’apprendre comme une langue étrangère. Etrangement, ce sont des morts, aussi, qui m’ont aidée à sortir de cette pensée nihiliste. D’après celle-ci — puisqu’on est « seul » —la mort est une fin absolue. Or, en perdant des gens très proches, et même si je les regrette beaucoup, j’ai fait cette expérience qu’ils continuaient de vivre en moi et de nourrir mon amour des vivants.»
Sur l’engendrement
« Si la maternité m’a sauvée, ce n’est pas parce que les enfants sont mignons mais parce que j’ai compris que le postulat du nihilisme ne tient pas debout. « Je suis seul » est une phrase dépourvue de sens. Pour pouvoir dire « je… suis… seul « , il faut avoir appris le langage et c’est avec d’autres qu’on le fait.»
La création, hommes et femmes
« Je crois que les hommes sont plus angoissés, plus seuls, dans la chaîne du vivant. Le fait de mettre au monde inscrit les femmes de façon évidente dans la filiation. L’oeuvre d’art est en revanche la trace qui signera le passage de l’homme. A cet égard, quoique très attachée à l’art, à la musique et à la connaissance, je m’efforce de relativiser cette survalorisation de l’oeuvre d’art qui aboutit à mépriser les gens doués pour la vie.»
Roman-photo privé et fiction
«Je crois que le roman n’a pas pour fonction de révéler au public la vie privée de l’auteur, mais de transporter les gens et de repousser les murs de leur moi, de les agrandir en leur faisant découvrir le point de vue des autres, ce qui relève de l’éthique et de l’amour.»
(Propos recueillis par JLK)
(Le Passe-Muraille, No 63, Janvier 2005)



