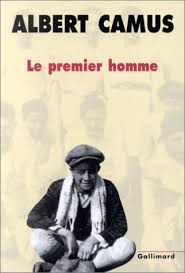La pauvreté et la lumière
Quand Jean-Pierre Monnier (1921-1997) partageait son émotion après avoir lu Le premier homme d’Albert Camus…

Outre le dernier Semprun, le dernier Kundera et quelques livres d’écrivains romands, Le Premier homme d’Albert Camus aura été pour moi l’événement littéraire de l’année passée. Comme tout le monde, j’avais appris qu’un manuscrit en travail avait été retrouvé dans la voiture où l’écrivain est mort brutalement dans les premiers jours de 1960. Il a fallu attendre trente-cinq ans et puis, tout à coup, grâce à la fille de Camus, ces pages inachevées ont fait l’objet d’un livre où se retrouvent toutes les passions d’un homme qui a vécu au plus près de ses exigences.
Tel qu’il est sous la forme qui nous est proposée, ce Premier homme s’offre à la lecture comme un brouillon, un premier jet. Cependant, à plus d’un endroit, la maîtrise de l’écrivain nous vaut des pages narratives d’une grande justesse de ton, celles du début par exemple, qui retracent le passage d’une carriole sur une route caillouteuse. «C’était une nuit de l’automne 1913. Les voyageurs étaient partis deux heures auparavant de la gare de Bône où ils étaient arrivés d’Alger après une nuit et un jour de voyage… Ils avaient trouvé à la gare la voiture et l’Arabe qui les attendait pour les mener dans le domaine situé près d’un petit village, à une vingtaine de kilomètres dans l’intérieur des terres, et dont l’homme devait prendre la gérance». L’homme, «le premier homme» est le père de Camus: il a une trentaine d’années, et la mère, sa compagne qui est à peine plus âgée, ne demande qu’à s’arrêter et à trouver le gîte où elle accouchera.
Tout est premier en cette soirée d’automne. Un jeune couple d’émigrants s’installe dans l’inconnu, l’homme est Alsacien, la femme Espagnole, un enfant va naître, et c’est à sa naissance que nous assistons dans les pages suivantes, à une veillée d’une grande simplicité, chargée de sens et d’émotion.
Quarante ans plus tard, nous sommes en Bretagne, au cimetière de Saint-Brieuc où un homme encore jeune demande à voir le «carré des morts de 1914.» Il obéit au voeu de sa mère qui est restée en Algérie et qui ne connaît pas la France, mais qui voudrait que son fils ait reconnu l’endroit où le père est enterré. Ici encore, cette quête du fils est sobrement dite: «J’ai besoin de quelqu’un qui me montre la voie et me donne blâme et louange, non selon le pouvoir, mais selon l’autorité, j’ai besoin de mon père». Toutefois, ce moment du cimetière ne lui apporte qu’angoisse et pitié, et comme le vieil ami qu’il rencontre peu après, il pourrait s’en tenir à ses mots: «Il y a en moi un vide affreux, une indifférence qui me fait mal».
Suivent l’évocation de la mère qu’il a retrouvée chez elle, en Algérie, et le récit de quelques souvenirs grâce auxquels se recompose la figure du père disparu en septembre 1914, à la bataille de la Marne. Le fils interroge, la mère se borne à des réponses laconiques, des «petites phrases simples». Elle se souvient difficilement, par à-coups, et quand, laissant le passé, ils sont ramenés au présent par un temps de silence, des familles d’Arabes endimanchés passent dans la rue, des paras, des ambulances au loin… On a quitté la Marne, mais, en Algérie, c’est encore la guerre, et pour la mère, qui n’a jamais bien com-pris ce qui lui arrivait, «la vie tout entière était faite d’un malheur contre lequel on ne pouvait rien et qu’on pouvait seulement endurer».
Tout autres sont les pages (les plus nombreuses) qui constituent le corps du livre. Elles nous ramènent aux «sources fraîches d’une enfance misérable et heureuse», celle du fils, et ce qui frappe tout au long, c’est la netteté de la mémoire, l’acuité du regard, la qualité de l’expression, mais c’est aussi, propre à Camus, cette faculté de faire vivre la moindre sensation, le moindre objet, la moindre présence.
On apprend à connaître la grand-mère, l’oncle tonnelier, l’instituteur de la classe du certificat d’études grâce auquel se sont ouvertes les portes du lycée, les différents patrons pour lesquels a travaillé l’enfant durant ses vacances… tout un petit monde livré au soleil, à la mer, aux odeurs de paille, de crottin et de poussière qui ont fait le lieu où s’est éveillée la sensibilité de Camus, car c’est bien de lui qu’il s’agit. Orphelin de guerre, il est le fils du «premier homme», et, comme son père, il est destiné à trouver seul «sa morale et sa vérité». L’ambiguïté fondamentale, qui est la marque de l’écrivain dans toute son oeuvre (l’exil et le royaume, l’envers et l’endroit, la pauvreté et la lumière) c’est là un don qui lui a été fait par les siens dès les débuts de la colonisation française, vers 1850, «les Mahonnais du Sahel, les Alsaciens des Hauts Plateaux, avec cette île immense entre le sable et la mer,… cela c’est à dire l’anonymat, au niveau du sang, du courage, du travail, de l’instinct, à la fois cruel et compatissant.»
Ce don, pour lui aussi «cruel et compatissant», tel est le seul héritage dont Camus ait pu se prévaloir. Or il l’a reçu sans la moindre amertume, la moindre plainte, comme quelque chose qui allait de soi, et s’il a su en tirer le meilleur parti, c’est peut-être surtout à sa mère qu’il l’a dû, à cet exemple qu’elle lui a donné sans le savoir, cette dignité qui était la sienne dans les gestes les plus quotidiens, la misère, l’exil et l’abandon.
L’être au monde qu’il a le plus aimé (ce qu’il dit dans les Feuillets annexés au manuscrit du Premier homme) sa mère, qui n’avait pas appris à lire et qui faisait des ménages pour subvenir aux besoins des siens, elle a été pour lui la chair vivante du drame algérien, et contre ce drame, il aurait pu se dresser et prendre position. Mais, quand elle est vécue jour après jour, bornée par les nécessités les plus immédiates, la vérité est obscure, incertaine, insaisissable, et quand elle est faite de résignation à toutes les souffrances, elle ignore tout de ses droits. Camus le savait mieux que personne, et que «rien ne vaut contre la vie humble, ignorante et obstinée» —ce qu’a dit Claudel qu’il cite en exergue. Il avait mieux à faire, et ce qui compte aujourd’hui, ce n’est pas qu’on ait pu lui reprocher son désengagement, mais, pour qui sait lire, c’est l’émotion qu’il a mise à rappeler son enfance, à la fois difficile et radieuse, tout ce que les silences de sa mère lui ont fait deviner et les quelques restes de vie qu’il a recueillis en divers endroits sur le passé de son père.
Ce manuscrit du Premier homme ne change en rien l’image que Camus nous a donnée de lui-même par le moyen de son oeuvre. Pourtant, il éclaire d’un jour plus net certains de ses attachements, certaines de ses options, et surtout il nous rend plus proche l’humble condition du milieu qui a été le sien, mais largement compensée par les bienfaits qu’il a tirés de la beauté du monde sous la lumière solaire.
J.-P. M.
Albert Camus, Le Premier homme, Gallimard, 1994.