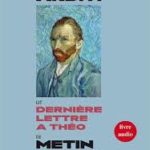Hubert Nyssen l’hidalgo
Rencontre et portrait d’un éditeur,
par Metin Arditi

Cela arrive. Rarement, mais cela arrive. On se trouve soudain face à un tableau, ou une sculpture, ou à lire un texte, ou à écouter une pièce de musique, dont on ne sait rien. On n’a aucune connaissance de l’artiste qui a produit l’oeuvre. On n’est ni historien de l’art, ni critique littéraire, ni musicologue.
Et pourtant, voilà que d’un coup on a la certitude de ressentir au plus profond de soi ce que l’artiste a voulu partager. On arrive même à en parler. A mettre des mots sur des sentiments dont on ne soupçonnait pas même l’existence. On est étonné, un peu déboussolé, un peu idiot, de pouvoir s’en entretenir aussi librement. Les paroles montent d’elles-mêmes à la bouche. On l’a compris, saisi, dévoilé comme par miracle, ce tableau, cette sculpture, ce texte, ou cette musique.
Il arrive — tout aussi rarement — que le même phénomène se produise lorsque notre chemin croise celui d’un être dont, immédiatement, on sait qu’on va l’aimer. On l’a à peine salué que déjà on le comprend. Ses talents nous éblouissent. Ses faiblesses déclenchent en nous un supplément d’affection. On les a situées à leur juste place. Sans elles, l’être ne serait pas aussi vrai, aussi humain, aussi prêt à être aimé. Très vite, tout de suite, on a eu accès à l’essentiel. On en est certain. Le dévoilement est total. Une apocalypse nous éblouit et nous secoue.
Ce sentiment m’a traversé lors de ma rencontre avec Hubert Nyssen. C’était comme si je l’avais connu depuis toujours, cet homme de quatre-vingts ans. Tout en lui m’a immédiatement paru simple, clair. «Je ne vous dis pas que je le lirai demain, mais je le lirai », m’a-t-il dit en prenant mon texte. Mots prononcés avec nudité. Pas l’ombre d’un artifice. Je savais qu’il le lirait.
Les mots, les pensées, les gestes, tout est à sa place. La générosité est sans réserve. Mais on la sent comme le fruit d’une lucidité. Elle surprend sous le regard aigu. Alors on en vient à se demander si elle ne s’est pas trompée d’adresse.

L’homme aime le panache. On a beau essayer, on se refuse à y voir une trace de vanité. On la devine, bien sûr, mais elle nous plaît bien, cette vanité-là. Elle a sa place. C’est le panache de Cyrano. Une règle de vie : mon panache, ma vérité.

D’où venait-il, ce Cyrano ? De Bergerac, en Dordogne. On se rapproche des ducs d’Aquitaine. Là, on sent que ça brûle. On y est presque. Le Belge a quitté les brumes du nord pour Arles. Fouette cocher. Plutôt près d’Arles. Le lieu a pour nom « Le Paradou». Mais Paradou, pour l’amour du ciel, ne vient pas de « paradis ». Manquerait plus que ça. Paradou vient de « moulin ». Au Moyen-Age, le village s’appelait Saint-Martin de Castillon.
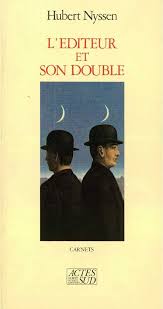
Là, c’est sûr, il y a des indices : les moulins, le château. On note. L’homme a écrit sur sa double fonction (il est écrivain et éditeur). Cela s’intitule L’Accastillage du texte. On les voit, les textes d’écrivains, avancer lentement sur la mer, fiers et parés comme une duègne d’Espagne. Un peu gauches de tant d’importance accordée, mais accastillés comme il le faut. Accastillage. Marrant, ce mot. Il viendrait de « castillo », château, en espagnol, qu’on n’en serait pas plus étonné. On note. On reprend. Le panache. Les moulins. Les châteaux. L’Espagne. Bon sang, mais c’est bien sûr: notre homme est un hidalgo.
M. A.
Metin Arditi a publié Dernière lettre à Théo chez Actes Sud, en 2005.