Gustave Roud au naturel…
L’entretien d’un jeune et candide journaliste de la Radio romande, en 1948, avec le poète bon enfant…
Réalisé quelques mois après la mort de Ramuz, cet entretien entre Gustave Roud et Alexandre Metaxas se déroule à Carrouge, dans la maison du poète. Le jeune journaliste de la Radio, intimidé sans doute, mettra du temps à «trouver ses marques», raison pour laquelle nous n’avons pas jugé utile de reproduire les premières minutes de cet entretien. Empreintes d’une extrême courtoisie, teintée d’ironie il est vrai, elles sont consacrées à la découverte, par un pur citadin, de l’intérieur «campagnard» de Gustave Roud, de ses objets familiers et de son fameux poêle-cheminée où l’on pouvait s’asseoir bien au chaud, et qui, cette fois encore, servit de cadre à la conversation. (J.-M. P.)
[…]
– Monsieur Roud, puisque nous sommes dans cette… enfin ça n’est pas une ferme c’est une belle maison…
– Ah non, c’est une ferme, qui est bâtie comme toutes les maisons de la région. Il y a un modèle architectural qui est très identique. La même distribution des pièces, les appartements au midi et la grange ensuite, et puis les écuries au nord.
– Vous avez beaucoup de terres tout autour ?
– Mhh… c’est un petit domaine.
– Vous êtes ici seulement depuis… une dizaine d’années je crois ?
– Oh non, nous sommes venus beaucoup plus tôt, il y a exactement quarante ans.
– Mais vous n’êtes pas originaire de Carrouge ?
– Non, je suis né près de Saint-Légier dans une grande ferme foraine en bordure de la Veveyse.
– Vous n’y avez pas vécu longtemps ?
– Non, une dizaine d’années. Mais j’en garde un souvenir très vivant parce que ces grandes fer-mes constituent un monde… en somme fermé, enfin qui a sa vie propre…indépendante.
– Donc vous êtes ici depuis votre toute première jeunesse ? Vous avez fait vos études à Lausanne ?
– Oui. J’avais fait une année de collège à Vevey et puis ensuite j’ai poursuivi mes études à Lausanne.
– Vous montiez et descendiez chaque fois ?
– Chaque fois, oui, c’était charmant.
– Le grand parcours ?
– Nous étions une équipe de collégiens et de petites écolières. Mais il s’agissait de se lever très tôt. L’été, je me souviens, nous devions monter… mon train partait de Mézières et il fallait être là-bas avant six heures. C’était un très beau moment d’ailleurs…
– Oui, mais en hiver ?
– En hiver, c’était un peu moins drôle…
– Et les heures étaient les mêmes ?
– Non. Il y avait un décalage d’une heure quand même…mais alors ces matins d’été où je montais à Mézières… c’est un de mes très beaux souvenirs d’écolier, peut-être plus beau que ce qui suivait dans la journée, je ne sais pas, quoique je n’aie pas du tout un mauvais souvenir du Collège…
– Vous étiez bon élève ?
– Je pense, oui…C’est un aveu qu’on n’ose guère faire parce que ça postule une suite moins brillante en général…
– Ça n’a pas été le cas pour vous… Monsieur Roud, parlons un peu de votre vie estudiantine, vous avez fait une licence en Lettres ?
– Oui, une licence en Lettres classiques, ancienne…
– Vous enseignâtes fort peu de temps ?
– Trois mois.
– Et vous aviez déjà commencé à écrire ?
– Oui, de très bonne heure. J’ai commis mes péchés d’extrême jeunesse, d’ailleurs comme tout le monde. J’ai eu cette chance d’être encouragé très tôt au moment où paraissaient les Cahiers vaudois qui avaient été fondés en 1914. En 15 les directeurs avaient songé à faire un cahier de jeunes et là-dedans, très gentiment, on avait publié mes premiers essais.

– Et après, à part les Cahiers vaudois, que d’ailleurs vous avez dirigés ?
– Non !
– Ah non ?
– Non, c’est plus tard, avec Ramuz on s’est occupés d’un autre journal.
– Mais nous n’allons quand même pas sauter si loin. Après les Cahiers vaudois, vous avez écrit quelques tablettes ?
– Oui j’ai composé et écrit assez irrégulièrement mais sans rien publier.
– Quand avez-vous commencé à publier ?
– Eh bien ma première plaquette date de 27, c’est-à-dire il y a précisément vingt ans. Elle a paru juste comme maintenant, à la fin de l’année, à compte d’auteur bien entendu, comme tout débutant le fait en général.
– Et ensuite ?
– Ensuite, deux ans plus tard, l’éditeur Mermod et C. F. Ramuz et moi-même, nous nous sommes occupés d’un petit journal fondé par Mermod et dirigé par Ramuz. Ce journal s’appelait Aujourd’hui, paraissait une fois par semaine, et il a vécu deux ans sous sa forme de journal puis une troisième a-née sous la forme d’une livraison mensuelle dont chacune était consacrée à une œuvre particulière. Ramuz, par exemple, y a publié un roman qui s’appelait Adam et Eve, et Louis Bromfield a publié aussi, enfin, plusieurs auteurs, mais ce n’était déjà plus le journal.
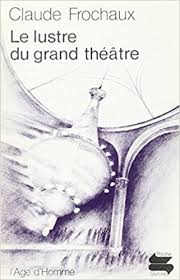
(Henry-Louis Mermod et C.F. Ramuz)
– Ce n’était plus le journal…
– Non… en somme… une suite d’œuvres.

(Ramuz, 2e depuis la gauche, Mermod, 4e et Gustave Roud, 5e)
– Si vous nous parliez justement puisque nous en sommes à Aujourd’hui, si vous nous parliez aujourd’hui de Ramuz.
– Eh bien je le fais très volontiers parce qu’Aujourd’hui marque le début de mes rapports, de mes échanges avec Ramuz et j’en garde un souvenir extraordinairement vivant. Nous nous voyions au bureau d’Aujourd’hui qui était donc chez notre éditeur Mermod, nous nous voyions tous les lundis pour établir chaque numéro. Et Ramuz arrivait avec une maquette toute prête où il avait soigneusement collé les épreuves. Quelquefois il y avait des blancs qu’il s’agissait de garnir… Enfin il y avait tout un travail de mise en pages qui était passionnant à suivre et dont Ramuz s’acquittait à merveille, avec des hésitations, mais qui étaient plutôt des hésitations de politesse que réelles. Et, ce qu’il y avait de particulièrement émouvant et de réconfortant, c’était le climat que Ramuz créait autour de lui. Il avait ce don qu’on retrouve d’ailleurs dans toute son œuvre de… comment dirais-je ? ce don d’appréhender le concret, de toujours rester en contact avec les choses, les objets, les êtres, et c’est un don qui devenait contagieux. Quand on l’avait vu une heure ou deux on se sentait beaucoup plus près, n’est-ce pas, de la terre, des arbres, ou des êtres et… Moi, je dois dire que c’est un enrichissement qui s’est prolongé… jusqu’à l’année dernière où nous avons perdu Ramuz. A chacune de nos entrevues j’ai eu ce même sentiment, non pas seulement d’un accueil amical mais d’un enrichissement…
– Et vous aviez toujours joie à aller le trouver…
– Oui, presque chaque année, il y avait une sorte de visite rituelle que je faisais à la fin de l’hiver. C’est le moment où, chez nous, c’était encore l’hiver; il y avait tout ce haut pays qui va de Carrouge jusqu’à Chexbres, et alors quand on arrivait au sommet de Chexbres, tout d’un coup c’était le printemps qui commençait et il n’y avait qu’à se laisser dévaler jusqu’à Pully. Et j’étais sorti peut-être de cinquante centimètres de neige pour arriver dans les primevères du jardin de la Muette.

– Et vous faisiez tout ça à pied ?
– Toujours à pied, oui, c’était un très beau parcours.
– Vous partiez vers quelle heure de chez vous ?
– Assez tôt le matin.
– Et ça vous prenait…
– …trois à quatre heures environ.
– Puisque nous parlons de primevères et de neige, enfin des saisons, il faudrait monsieur Roud que vous nous parliez… non pas tant de votre œuvre que du climat de votre œuvre, qui est issue je crois en grande partie de cet amour de la nature que vous avez ?
– Oui, j’ai le sentiment que ce que j’ai fait est assez étroitement lié au déroulement des saisons, et, je peux dire, l’essentiel de mes préoccupations a été de suivre et de sentir ce déroulement des saisons qui est en somme toujours le même et qui n’est jamais le même. Il y a un mot de Ramuz que j’ai fait mien et dont je trouve qu’il va très loin; il dit: «La nature ne se répète jamais, c’est nous qui nous répétons.» Il me semble qu’on ne peut pas mieux définir, plus profondément enfin, ce qui devrait être le don du poète, c’est-à-dire de ne jamais revoir, mais de toujours découvrir.
– Ce qui fait que vous n’êtes jamais lassé, au grand jamais…
– Il faudrait ! si… tout le monde a ses retombées, bien entendu.
– La nature, c’est très bien, mais l’œuvre elle-même ne se base pas seulement sur elle. Vous, ne parlons pas d’influences, mais vous avez eu des contacts, des contacts après coup bien entendu, avec, je crois, certains poètes comme Novalis ou comme Hölderlin ?
– Oui, des contacts… disons des rencontres, des rencontres véritables, c’est-à-dire des choses qui ne sont pas machinées mais qui se font par une sorte de miracle.
– Novalis…
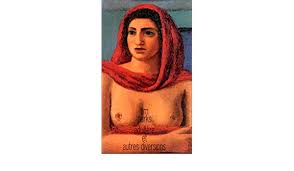
– Oui, Novalis… je suis un homme de très peu de lectures et je n’ai pas été à lui directement; c’est en lisant une petite étude qu’un critique de la Nouvelle Revue Française avait écrite sur ma première plaquette, où il faisait un rapprochement du contenu de cette plaquette avec certains pas-sages de Novalis, c’est en lisant cette critique que j’ai eu l’idée d’y aller voir et j’ai pu le découvrir. Ça a été une des rencontres, je puis dire essentielles. Mais vous voyez qu’elle a été amenée indirectement… tout comme celle que j’ai eue avec Hölderlin, que j’ai appris à connaître par deux ou trois versions que Pierre Jean Jouve avait publiées à la Nouvelle Revue Française autour de 1929 ou 30.
– Mais si on pouvait établir un ordre chronologique, vous avez d’abord découvert Hölderlin…
– D’abord Novalis.
– Je n’aime pas employer le mot influence, mais enfin le grand coup a tout de même été Mallarmé ?
– Oui, mais alors beaucoup plus tôt. Au moment de mon adolescence. C’est le moment des très grandes découvertes aussi. Il y a eu Mallarmé mais en même temps il y avait Eschyle, en même temps il y avait Claudel, enfin…
– Justement, vous aviez beaucoup plus de mérite – des jeunes de maintenant peuvent vous dire, comme on a pu vous le dire, qu’ils «découvrent» eux aussi Mallarmé – mais il me semble que vous aviez beaucoup plus de mérite à découvrir Mallarmé aux moments héroïques ?

– Je ne sais pas si c’est précisément un mérite, mais c’est une chose qu’on oublie très facilement, ces questions d’époque, ces questions d’atmosphère… Les jeunes d’aujourd’hui qui admirent Mallarmé le font… enfin c’est une admiration qui leur semble toute naturelle parce qu’elle est partagée par une quantité de personnes. Mais si je remonte à trente ans en arrière au moment où je l’ai découvert, c’était tout différent. Et Claudel la même chose, et Rim…
– Bien plus Claudel !
– Bien plus, et alors si on en parlait on vous regardait le plus souvent avec de gros yeux, enfin une mine étonnée: «C’est un être singulier, n’est-ce pas, où est-ce qu’il va pêcher ses admirations»… Mais ce sont des choses qui s’oublient, naturellement.
– Nous avons parlé de nature, nous avons parlé de Novalis, nous avons parlé de Mallarmé, si nous parlions de votre façon d’écrire, sinon de votre style, de votre œuvre en elle-même.
– Eh bien, je pense qu’il n’y a pas grand-chose à en dire… tout ce que je puis dire moi-même c’est que c’est une œuvre qui est faite de petits morceaux, c’est une poétique bien involontaire qui est celle, on pourrait dire de l’illumination, c’est une écriture fragmentaire… On est touché ou non par la grâce et… on parle ou on se tait, mais… c’est en somme tout ce que je puis en dire…
– Vous parlez de poésie, mais au fond ce n’est pas tant de la poésie, ou plutôt c’est de la poésie mais sous une forme prosaïque…
– Vous entendez comme écriture ? Oui, j’ai écrit très peu de poèmes en vers, le plus souvent j’ai composé des suites de morceaux en prose…


– Au fond, c’est une espèce de confidence ?
– Oui, par exemple ce dernier recueil que j’ai publié qui s’appelle Air de la Solitude… c’est une suite de morceaux assez courts, enfin d’une page ou deux, qui n’a d’unité que peut-être par le climat qui s’en dégage et par le ton. Mais disons, si vous le voulez bien, que c’est une suite de morceaux à la façon d’une suite musicale.
– C’est ça… Pour terminer, je vous demanderai monsieur Roud de me situer si possible la place de la littérature romande actuelle, ou s’il est une littérature romande ?
– C’est une question… un peu brutale… surtout assez complexe à élucider et à fixer, mais je vous dirais mon sentiment tout net qui est celui-ci: il me semble qu’il y a à l’heure actuelle une grande richesse dans tout ce qui est écriture romande, soit en prose, soit en poésie et non seulement une richesse visible et palpable, mais il y a aussi des promesses qui sont pleines d’intérêt. Pour ma part je connais de jeunes poètes dont on peut prédire presque à coup sûr qu’ils accompliront une œuvre, enfin d’après les quelques essais qu’il m’a été donné de lire. Il me semble que c’est quelque chose de très encourageant.

– Estimez-vous que cette littérature romande est absolument autonome, ou entre-t-elle malgré tout dans le cadre de la littérature française tout court ?
– Je crois qu’elle ne peut pas être autonome puisque nous parlons une langue qui est le français, qui n’est pas la nôtre mais qui est celle d’un plus grand espace de terrain, mais je pense qu’elle a tout de même, cette littérature romande, ses caractéristiques à elle.
– Qu’il n’y a quand même pas trop d’influences ? je ne dirais pas étrangères, mais d’influences, mettons, de snobisme ou d’école…
– Je ne crois pas. D’ailleurs je pense qu’il ne faut redouter en aucune façon les influences… je ne vois pourquoi un Valéry, par exemple, qui a exercé la sienne certainement en Suisse romande, pourquoi il faudrait s’en affliger ? Ou un Claudel, peut-être, sur tel ou tel romancier pour les romanciers suisses romands.
– Au fond il y a donc toutes raisons de considérer la littérature romande comme une littérature particulière, mais qui existe dans le cadre de la littérature française…
– Mais bien entendu. Je crois que nous aurions au contraire grand tort de vouloir diminuer cette parenté et cet enrichissement…
– Il y a échange…
– Il y a échange.
– Et interdépendance…
– Oui.
Propos recueillis par Alexandre Metaxas
© Radio Suisse romande, février 1948.
(Le Passe-Muraille, No 30, Avril 1997)




