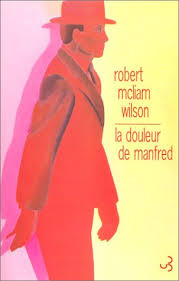Fin de partie londonienne
À propos de La douleur de Manfred, de Robert McLiam Wilson,
par Anne Turrettini
Il est des auteurs qui cherchent à provoquer chez le lecteur un sentiment de sympathie, d’autres qui, au contraire, aiment à entretenir une certaine distance entre le texte et son destinataire. Robert McLiam Wilson fait sans contes-te partie de cette seconde catégorie et, par sa singularité, son nouveau roman, La Douleur de Manfred, ne manque pas de créer un certain malaise.
Manfred est un vieil homme. Il habite dans un petit appartement, à Londres. Et il se meurt. A petit feu, avec jubilation. Son quotidien, rythmé par les humeurs de la douleur logée au bas de son ventre, est fait de peu de chose. D’une promenade, d’un repas au café Mary’s, de solitude, de culpabilité. Il croise parfois ses voisins, l’affable Garth, un grand Noir, infirmier, et Webb, un ivrogne aux relents racistes, qui fréquente assidûment les prostituées.
Toute la vie de Manfred est emplie de son amour pour Emma, sa femme, dont il est séparé depuis vingt ans : « Sans Emma, la vie de Manfred se satura d’Emma. Il brûla sans espoir de retour. Le monde se fatigua et Manfred passa le bref laps de ces vingt années en observateur, raffinant le témoignage non enregistré de son grand, de son immense amour» (p. 243). Tl lui téléphone une fois par semaine et la rencontre une fois par mois, toujours sur le même banc, à Hyde Park.
En alternant avec beaucoup de maîtrise et de finesse le présent et le passé, McLiam Wilson raconte la vie de Manfred : une enfance marquée par un père qui avait peur de la nuit et qui tomba malade lorsqu’il apprit quel était le sort que le régime nazi réservait aux Juifs, le senti-ment d’être différent des autres en raison de sa judaïté, la Seconde Guerre mondiale avec ses champs de morts et la violence des militaires envers les femmes, son retour à la vie civile puis sa rencontre et son mariage avec Emma, une jeune Tchèque, rescapée des camps de la mort, la naissance de leur fils Martin et leur vie florissante jusqu’à ce qu’il prenne l’habitude de la frapper «(…) parce qu’elle avait vécu avant lui et sans lui (…), à cause du mal que lui-même n’avait pas fait (…) », parce que « il avait tenté de faire sortir quelque chose d’elle en l’écrasant» (p. 228).
L’étrangeté qui se dégage de ce roman tient au mélange de tons — le tragique côtoie en effet le burlesque, créant parfois un sentiment de démesure qui est, paradoxalement, parfaitement maîtrisé — et au formidable portrait de Manfred, personnage complexe dans lequel se mêlent la fragilité, l’égoïsme, la jalousie et la méchanceté.
L’écriture de McLiam Wilson tend à créer un climat inconfortable: les phrases brèves ou lapidaires, les répétitions, les mots qui semblent parfois comme suspendus laissent entendre que les personnages n’échapperont ni à leur destin, ni à l’Histoire.
Il y a dans La Douleur de Manfred une petite musique beckettienne, faite de beauté et de noirceur.
A. T.
Robert McLiam Wilson. La Douleur de Manfred. Traduit de l’anglais par Brice Matthieussent. Christian Bourgois, 2003, 262 pages.
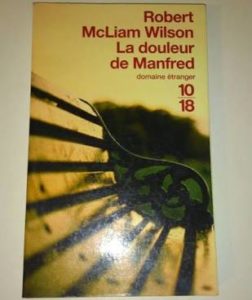
(Le Passe-Muraille, No 58, Octobre 2003)