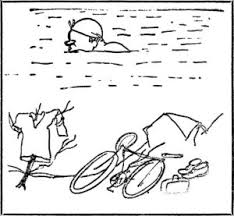Ferveur de l’Oise
FERVEUR DE L’OISE
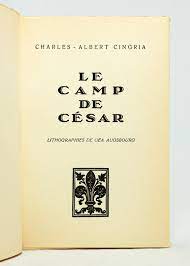
À propos du Camp de César de
Charles-Albert Cingria

par Fabrice Pataut

Il faut goûter, encore et toujours, la prose délicieusement précise de Cingria, sans concession et toujours incisive, mais sans lourdeur ni chicane. Décidée, elle avance d’un pas de marcheur impénitent. L’allure en est elle-même chevronnée. Dans ce Camp de César, les conjonctions et les virgules manquent pour mieux aller au but, qu’on soit en compagnie d’« un simple très beau chat roux », d’un garçon « qui procède à hauts fulminants pas », ou d’une baronne « aux gros vibrants cils noirs ». L’impatience n’est jamais loin : « Merci oui ou merci non ? », « C’est la vie ! », etc.
Cingria, observateur pressé mais obéissant devant le détail, se fait un fabuleux raconteur de paysages, du genre de ceux qui explicitent à la manière de la géométrie descriptive, par coupes, élévations et profils. Chemin faisant, il nous détrompe. Je le dis tout net : Le camp de César est un livre merveilleux d’affabulation et de simplicité. Je le dis comme on parle de simplicité biblique et d’affabulation enfantine, et donc au sens de la pureté et de la fidélité, de l’absence naturelle de dissimulation.

Nous sommes sans atermoiement dans la campagne de l’Oise, peuplée de bonnes gens bienveillantes, voire hospitalières, qui composent à l’aveuglette avec des petits voleurs dont pas un seul ne deviendrait un escarpe, pas même par nécessité. Dans l’Oise toute pleine des odeurs et des matières soyeuses des marais et des roseaux, arrive l’auteur. Sa bourligne est d’ailleurs d’un genre local sans prétention. On ne sait trop pourquoi il bourlingue là plutôt qu’ailleurs. Il y a des chemins peuplés d’oies et des villages avec de belles boucheries. Pour contourner les bêtes et aller chercher sa viande, il y a aussi force bicyclettes : celles qu’on retape au minium pour la revente illégale, et celle du commissaire qui arbore par opposition une « pédale argentée ». C’est que les objets quotidiens et fonctionnels avouent parfois une couleur utile (le minium), et à d’autres moments un reflet impérieux (l’argent), comme on avoue un crime. Ou alors suggèrent-ils un décor de carton-pâte ; témoin ce vin acheté au village « qui a des étiquettes de minarets de mosquées de boîtes de dattes ». Notez que Cingria évite le mot « bouteille » et offre au vin libéré de son contenant un pauvre bout de papier qui l’habille pour la fête par emboîtements successifs, de manière qu’on procède à reculons de la boîte de dattes vers la mosquée jusqu’à son seul minaret — tout ça dans une épicerie de province où l’on connaît l’Afrique du Nord par Pépé le Moko (Cingria ne le dit pas). Une sorte de noblesse lui est par là-même conférée, au vin en réclame, un blason que mériteraient tout autant les « solennités de plâtras » et les « fanfares d’esplanades » du narrateur, à propos desquelles il se fait fortement silencieux.

Parfois aussi, la sensation ou l’émotion suffisent à évoquer un lieu, et c’est alors le nom qui compte plus encore que le lieu lui-même. Par exemple : il fait souvent froid dans l’Oise où Cingria croise des bandes de copains, des jeunes filles bien, une garce sicilienne, des tenancières sympathiques, une ancienne fréquentation de Napoléon III, des Communistes. Il fait froid. Il pleut. Les vêtements sont mouillés, les pieds, les épaules, la tête. Alors on s’abrite au café. Et là, mon Dieu, quoi prendre ? « Un double rhum dans un verre à Bordeaux. C’est très Chantilly cette impression-là, très Belgique ». Et voilà un triple voyage, grâce à un verre qui tient lieu de voiture, de train, peut-être même d’aéroplane vu la vitesse du déplacement. Mais c’est surtout des noms qu’on a envie. On les a dans la bouche. On voudrait les dire de nombreuses fois encore plutôt qu’aller aux endroits susnommés, et rester au chaud à les mâchouiller.
Le voyage se termine à Paris. Cingria nous en offre non pas un portrait, comme pourrait faire un naturaliste, mais un aperçu à la faveur de l’arrivée en train, avec force incidences, citant au passage Max Jacob : « la conversation vit de parenthèses ». C’est purement autodescriptif, en quelque sorte par acoquinement admiratif avec le grand Max (« le plus éblouissant esprit de notre époque ») puisque Le camp de César est un monologue entièrement composé d’apartés et de digressions.

Après quoi Cingria range sa bicyclette et finit par nous déposer à Paris où « l’air […] est gras » et le « ciel nerveux, finement iodé — oui, finement, comme les huîtres ». Il le fait avec toute sa discrétion, ayant soin de noter au passage la lenteur des arrivées par voie ferrée et le désir si impérieux d’être revenu chez soi. Les impressions d’arrivée « sont les plus aptes à définir ce que nous cherchons ». Par parité, les impressions de départ (l’accélération progressive, le paysage qui s’éloigne par la vitre du compartiment, le temps qui s’allonge) définiraient plutôt ce que nous évitons.
La petite dame russe russe qui serre la clé de son appartement de la rue Campagne Première dès la forêt de Fontainebleau ne s’y trompe pas. Enfin « hors de l’octroi », s’étant acquittée d’une foule imaginaire de contributions indirectes, elle se prosterne sur la chaussée parisienne et baise son pavé, retrouve au restaurant du coin son dessert de fraises des bois, venues de pays répondant tous au nom de quelque-chose-en-France : Bonneuil-en-France, Mareuil-en-France, etc., à l’infini ou presque. Loin de ses anciennes terres où l’on fouettait au temps du tzar, la clé « toute brûlante » rangée dans le tiroir, ravie de ces fraises posées sur d’ « amples feuilles velues sentant le clocher », la dame slave se retrouve. C’est là une fin remarquable, cinématographique par l’effet de zoom sur lesdites feuilles, proustienne dans son évocation concomitante du velouté des cultures potagères et des clochers de campagne par le truchement d’une effluve abstraite sans nom ni matière.
Pour tout savoir de ce court chef-d’œuvre très discret, lisez sans attendre Le camp de César.
Charles-Albert Cingria, Le camp de César. Lithographies de Géa Augsbourg. Postface de Robert Télin Au lys rouge, Lausanne, 1945. Imprimé à Vevey par Jayet et Diebold.