Faut-il crucifier Amélie Nothomb ?

Le dernier roman d’Amélie Nothomb, Soif, mérite mieux qu’un prix Goncourt : une lecture attentive…
par JLK
Sous ses airs de fée-sorcière belge à la Harry Potter gérant son image à chapeaux de cirque avec une malice de sale gamine, la fine mouche, nièce du savant « bibliste» Paul Nothomb, a poussé le bouchon jusqu’à parler au nom du rabbi Iéshouah, le Jésus de nos catéchismes et superstar de cinéma.
Mais pour dire quoi ? Lire Soif est la seule réponse à cette question, avec ou sans caution de cette institution littéraire défaillante qu’on appelle le Prix Goncourt.
D’aucuns ont pris la romancière-à-succès de très haut, avec une condescendance toute parisienne qui ne pèse guère à côté de ce qui est vraiment développé dans ce monologue éminemment culotté, parfois pimenté d’ironie ou roulant des formules semblant « téléphonées » mais recoupant finalement, dans un langage tout simple à la fausse apparence « simplette », les méditations (sur l’incarnation, les miracles, le plaisir, l’amour charnel, la soif d’absolu, le scandaleux sacrifice, le chantage au salut, etc) de certains commentateurs les plus pénétrants des paradoxes du christianisme, de Nietzsche à Simone Weil ou Vassili Rozanov dans La face sombre du Christ…
Bref, avant de dégommer ce livre sur la base de on-dits médiatiques ou mondains, prenez et lisez…

Cela pourrait commencer par un jeu où chacune et chacun dirait ce que le nom de Jésus évoque pour elle ou lui, et ce serait un premier défilé des Christs.
Il y aurait d’abord, je parle pour moi et mes frère et sœurs, le Jésus de nos enfances, le tout bon gars en robe bleu ciel à longs cheveux et barbe sympa qui nous la jouait tout en douceur en murmurant «laissez venir à moi les petits filous», et ce serait le même dont nos mères et grand-mères nous enjoindraient d’écouter la petite voix ; et ensuite ce serait plutôt le grand frangin confident de l’école du dimanche, puis le Seigneur des sermons protestants et du catéchisme insistant sur l’enseignement moral de ses paraboles, ou le Jésus des miracles et de la présence réelle invoqué par les curés de nos petits camarades catholiques, qui verraient dans le vin de messe son sang et dans l’hostie sa chair à ne pas mordre.
Mais il va de soi que ces images eussent été tout autres, ou bonnement inexistantes, selon que l’on eût vu le jour en Nouvelle-Guinée entouré de parents en pagnes, ou dans quelque clinique pédiatrique pour nouveau-nés malformés, au titre des «bavures» de la Création.
En outre, 2019 ans après le transit terrestre du présumé Dieu incarné, les avatars de sa représentation, plus que mille Bouddhas plus ou moins dodus, se seraient multipliés de façon exponentielle et parfois contradictoire, jusqu’au Jésus d’Amélie qui en contient d’ailleurs plusieurs, entre le très cool, le plutôt soft et le plus radicalement hard.
Un inventaire à dérouter l’anticlérical Prévert…
Avant d’évoquer l’inventaire des innombrables interprétations et représentations de la vie et des œuvres du présumé fils de Dieu né d’une vierge avec l’accord tacite d’un certain Joseph, menuisier au bon cœur – enfant surdoué devenu le rabbi Iéshoua, Messie annoncé, Roi des Juifs, chef de projet des évangélistes américains ou tête de turc des mécréants de tout poil, je cite illico ce propos du Jésus d’Amélie Nothomb, scandalisé par la «bévue» de son père sans corps et l’envoyant se faire crucifier pour sauver ses créatures décidément imparfaites: «Mon père m’a choisi pour ce rôle. C’est une erreur, une monstruosité mais cela restera l’une des histoires les plus bouleversantes de tous les temps. On l’appellera la passion du Christ ».
Et cela d’abord qui annonce des siècles d’imitation, de sacrifices, de martyres, mais aussi de meurtres par « devoir divin » et autres massacres : «Aucune souffrance humaine ne fait l’objet d’une aussi colossale glorification».
Sur quoi défilent, pour nous en tenir à la tradition chrétienne occidentale, en sculpture ou en peinture, les Christs de bois ou de pierre, les austères Christs romans et les Christs dolents ou maniérés de la Renaissance et du baroque, les Christs évanescents ou les Christs violents, les indigents et les triomphants, le cadavre affreux de Hans Holbein au musée de Bâle qui faisait dire à Dostoïevski que c’était une incitation à l’athéisme, les crucifiés saignant noir de Louis Soutter ou ceux de Friedrich Dürrenmatt entourés de rats; ou en musique : les Christ du plain-chant orthodoxe ou celui d’un Bach «capable du ciel», l’enfant Jésus de nos cantiques populaires à la Noël ou le Maître en gloire de Pâques et de la résurrection ; au cinéma le Christ pur et dure de Pasolini et le Christ frelaté deLa dernière tentation; en littérature le Christ de Rabelais (mais oui !) et les Christs de Dante, de Pascal et de Bernanos, de Léon Bloy et de Claudel ; le Christ chahuté par Nietzsche et scruté en sa face sombre par Vassili Rozanov ; enfin en théologie le Christ de Thomas d’Aquin et celui de Luther, le Christ des prêtres ouvriers et le Christ des moines ascètes, le Christ politisé à droite de l’Opus Dei ou à gauche par Dom Helder Camara, le Christ de Jean de La Croix, de saint FranCois des Fioretti ou de Simon Weil la juive confrontant la pesanteur et la grâce, etc.
Amélie et Jésus ou les malentendus
Dans un papier du magazine Marianne aussi railleur que superficiel, genre ouaf ouaf parisien, Amélie Nothomb se trouve qualifiée de midinette écrivant pour des coiffeuses et des ados férus de convivialité molle et de cuisine vegan, accusée, à grand renfort de citations prêtant en effet aux pires conclusions hâtives, de réduire Jésus aux dimensions d’un mec cool demandant pardon au figuier qu’il a maudit ou aux poissons qu’il a pêchés, dont la philosophie et la sagesse relèvent plus ou moins de «la mystique pour les nuls».
C’est brillant et ça se veut décapant, typique de l’esprit du temps qui ne peut imaginer qu’une auteure à succès soit autre chose qu’une « cruche », je cite, mais c’est aussi pécher par simplisme en ne voyant rien de ce qui est dit avec une rare simplicité.
Quand le Jésus d’Amélie dit à Marie de Magdala, dite Madeleine, pour laquelle il en a pincé dès qu’il l’a vue, sachant pourtant qu’elle a eu des tas d’hommes alors qu’il n’a point connu de femme jusque-là, qu’elle est son « gobelet d’eau », ça va pour ainsi dire de soi qu’on s’esclaffe. Trop drôle !
Or l’esprit du temps, citadin à qui on ne la fait pas, peut-il imaginer ce qu’est un verre d’eau dans ce pays de grande soif et de troubles politiques (déjà !) où Jésus dit qu’il a « choisi » d’apparaître ? Cela passerait mieux, évidemment si c’était Épicure, cité d’ailleurs par Amélie, qui s’exclamerait : « Un verre d’eau et je crève de jouissance ! »
De la même façon, quand le Jésus d’Amélie dit son bonheur d’être au monde, se réjouit du bon goût d’une pomme et du bienfait du sommeil, ou au contraire exprime sa peur de la douleur, le dégoût que la laideur ou la mesquinerie lui inspirent, l’envie d’échapper à son sort annoncé pour aller fabriquer du fromage de brebis avec sa Madeleine chérie à laquelle il fera une flopée d’enfants – quand cet humain dûment voué à l’incarnation par son « père » sans corps se retrouve flagellé (quel show !) puis cloué à la croix qu’il a portée jusqu’au Golgotha, il semble ridicule qu’il crie «pouce» après avoir espéré couper au supplice à l’aube où il s’est mis à pleuvoir. Imaginer une crucifixion romaine sous la pluie – vraiment cette Amélie est too much. Mais la pluie va cesser et c’est parti pour accomplir la prophétie, au terme de laquelle, comme Gargantua à sa naissance, il s’exclamera : «J’ai soif ! »
La dernière question du crucifié
Jésus croyait-il encore en Dieu sur la croix ? La question peut sembler blasphématoire pour un chrétien, loufoque ou sans intérêt pour un mécréant ou un chroniqueur à la coule, mais le crucifié d’Amélie nous incite à nous la poser. Lui-même ne se la pose d’ailleurs pas que sur la croix, mais aussi après sa mort, quand il se retrouve dans ce « corps » dont on ne sait rien.
Mais croire ou ne pas croire est-il si important que ça, se dit-il alors. On connaît le pari de Pascal, qui spécule sur la foi comme s’agissant d’une espèce d’à-valoir dont le salut éternel serait l’enjeu. Or le Jésus d’Amélie n’aime pas du tout cette sorte de petit chantage, pas plus qu’il ne souscrit à ce que l’évangéliste Luc lui fait dire avant de rendre son dernier souffle : « Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font », qui lui semble une parole condescendante alors qu’il ressent l’ultime besoin, lui, de se pardonner à lui-même quelque chose d’hyper-important.
Et quoi donc ? De ne pas s’être assez aimé lui-même, et d’avoir par trop humilié la chair – ce que lui reprocheront justement un Nietzsche ou un Rozanov. Tout à coup, sa parole « aimez-vous les uns les autres » lui semble vaine s’il ne recommande pas à chacun d’aimer en soi-même un être unique et incomparable. Et de renvoyer alors le diable à son inexistence, en rappelant la formule de Thérèse d’Avila qui disait moins craindre le démon que ceux qui le craignent…
Pour le Jésus d’Amélie, plus que le traître de la tradition chrétienne, Judas est un type trop cérébral, coincé dans son ressentiment et sa jalousie, qui manque littéralement de corps. Or le manque de corps aboutit au manque de soif, au sens physique ou spirituel – c’est du kif. Et voilà qui relie encore l’intuition centrale de ce roman à ceux qu’a indignés l’interprétation chrétienne étroite et punitive du « péché de chair », alors qu’il est évident qu’un amour sans corps n’a «pas d’histoire», ainsi que le remarque encore le Jésus d’Amélie en rappelant que le handicap majeur de son « père » est de n’avoir pas de corps…
Notre Amélie a un « grain…de génie », disait son oncle Paul

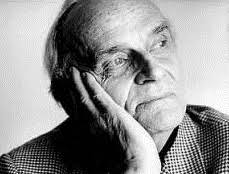
Il est trop facile de prendre Amélie Nothomb pour ce qu’elle semble être, genre diva médiatique à tenues voyantes, alors que la personne est tout autre que le personnage qu’elle a fabriqué pour se protéger.
À ce propos, je me souviens d’une bonne conversation, du côté des Ardennes bleues, avec son oncle Paul, ancien compagnon d’armes de Malraux et spécialiste avéré (traducteur et exégète) de l’Ancien Testament, qui me dit à peu près, comme je l’avais deviné dès ma première rencontre en 3D avec la romancière après la parution d’Hygiène de l’assassin, son premier roman à fracassant succès : « Voyez-vous, je crois que notre Amélie, avec laquelle j’aime beaucoup parler, a comme un grain… de génie, qui demande encore à pousser !»
Et de fait, suffit d’un gobelet d’eau et ça « pousse » en donnant Soif…
Amélie Nothomb. Soif. Albin Michel, 2019.
