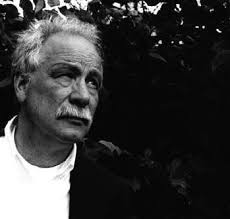Explorateur des mondes enfouis
À propos d’Austerlitz et autres écrits de G.W. Sebald,
par René Zahnd
Austerlitz, le personnage si dense qui habite le dernier livre de Sebald, s’étonne de la faculté qu’ont les écureuils de retrouver, sous la neige de l’hiver, les petites provisions enfouies à l’automne, ici ou là. Et nous, se demande-t-il ensuite, « comment faisons-nous pour nous souvenir, et que de choses ne déterrons-nous pas en définitive ? ».
Qu’elle soit collective ou personnelle, cachée au plus profond des apparences ou en pleine lumière, la mémoire est au coeur de l’oeuvre de Sebald. Or la mémoire, ici, n’est pas juste l’inventaire plus ou moins fragmentaire du passé. C’est une matière qui se travaille et qui évolue, un pays qui s’explore sans relâche, une source de réflexion pour le présent et sans doute pour les temps à venir. Par la recherche à l’intérieur de soi, par la collecte de récits de vie, par l’investigation en bibliothèque ou le questionnement de témoins (qu’ils soient humains, architecturaux, livresques…), Sebald va gratter la neige, déterrer ce que tant d’autres rongeurs ont oublié.
Les quatre livres que Sebald nous a laissés sont à considérer d’un bloc. ils forment un seul et même ouvrage, dont la construction suit l’ordre de parution. Vertiges, geste initial, raconte un retour au village de l’enfance. Les Emigrants trace le portrait de quatre personnes qui, pour des raisons et dans des circonstances diverses, ont fui le troisième Reich. Elles portent en elles une blessure béante et une mélancolie incurable.
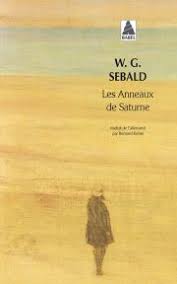
Les Anneaux de Saturne prend l’allure d’une authentique quête : lors d’un voyage à pied au sud de l’Angleterre, le narrateur s’interroge, rêve, fouille, se met à éplucher la réalité, par couches successives, comme un oignon qui fait pleurer. Enfin, apothéose de ce cheminement, Austerlitz semble contenir tout ce que Sebald a cherché dans ses livres précédents, avec des ouvertures et une ampleur plus considérables encore. Luttant contre «la montée du souvenir», l’homme dont il est question ici ressemble à Wittgenstein. Il cristallise quelque chose de l’ordre de la douleur d’être, comme s’il portait à lui seul le poids des catastrophes du siècle dernier.
Dans les itinéraires que Sebald parcourt, le détour est essentiel. Car ce flux suit des méandres imprévisibles, mais jamais innocents. Un accident de parcours, une prétendue coïncidence peuvent donner naissance à des développements inattendus (un peu à la manière de ces battements d’aile de papillon, à l’équateur, qu’on dit déclencher des typhons des milliers de kilomètres plus loin). Un pont métallique au sud de l’Angleterre entraîne le lecteur en Chine. L’intérêt pour la soie illustre, soudain, l’effrayante efficacité de l’organisation nazie.
Comme on parle de la manière de certains peintres, il existe une manière Sebald. Elle est très forte. L’écrivain procède souvent par longues phrases, tis-sant des motifs complexes, les-quels finissent par se fondre en une seule et même coulée, plus ou moins ample par moments, qui là encore semble naître à la première phrase de Vertiges, pour s’arrêter (dans son aspect visible en tout cas) au point final d’Austerlitz. Dans cette forme, le plus surprenant est la façon qu’a l’auteur de mêler les voix (avec l’élimination délibérée de certaines conventions, par exemple les tirets et les guillemets). Jamais on ne s’y perd. On sait toujours qui parle. Où nous en sommes. De la même façon, s’entrelacent le présent et le passé, l’érudition et le récit, le texte et l’image, dans un voyage complexe entre différents niveaux de réalité. Tout cela est mêlé si étroitement qu’on finit par ne plus distinguer les éléments les uns des autres.

Dans une ambiance cosmopolite, profondément européenne, Sebald témoigne. Il saisit l’empreinte parfois fugace des paradis perdus. Il décrit, sans jamais céder au sentimentalisme, les mécanismes de destruction et d’horreur. Il examine les cicatrices des renoncements et des arrachements. Il plonge son regard au coeur des «nébuleuses qu’aucun oeil ne distingue ». Il fouille dans notre histoire, petite ou grande, «presque exclusivement constituée de calamités ». Il s’émerveille de la beauté du monde et des êtres. Il consigne certaines manies qui deviennent des raisons de vivre.
Avec humilité et patience, avec opiniâtreté et non sans porter crédit à l’être humain, à l’art ou à la littérature, il recourt aux mots pour dresser ce constat sans appel : l’avancée des civilisations est destructrice de beauté et de vie. Cela a commencé il y a long-temps, très longtemps. La sensibilité de l’écrivain et son usage du Verbe deviennent alors comme des gestes peut-être dérisoires pour tenter de retenir la beauté qui se délite.
R. Z.
W. G. Sebald. Vertiges. Acte Sud, 2001, 238 pages.
Les Emigrants. Acte Sud, coll. Babel, 1999, 277 pages.
Les Anneaux de Saturne. Actes Sud, 1999, 351 pages.
Austerlitz. Actes Sud, 2002, 350 pages.
(Le Passe-Muraille, No 55, Février 2003)