Eveillé à la conscience, j’ai pris acte


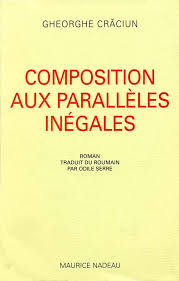
Texte inédit de Gheorghe Craciun
Je fume des cigarettes étrangères, les moins chères. Je les allume machinalement, mécaniquement, et les fume avec une avidité suspecte. Plus précisément, je les bouffe. Je donne des interviews, je parle bien et vite, je parle beaucoup et intelligemment — la peur de ne pas claquer. Je suis arrivé, enfin, à être un type dur. Je perçois, dans mon organisme, un besoin de poison et un besoin de silence. Fumer renforce les nerfs, me dis-je. Fumer fait passer vite ce qui se passe. Fumer est une mesure de protection, un signe de ma virilité de prof.
C’est ainsi que je fume dans le champ de patates. L’automne me retrouve dans mon équipement hétéroclite: jeans à tacons, bottes en caoutchouc ou bottines usées en cuir retourné, chemises décolorées anonymes. Je suis là dans le champ de patates de la famille, au ramassage, au milieu de tas de branches d’arbustes et de sacs alignés, de voitures et de charrettes, de parents et de voisins; et sans que je comprenne tellement leur fierté de propriétaires, leur peur désespérée de la pluie, que le tracteur puisse tomber en panne, qu’il n’y ait
plus de sacs ou de gens disponibles ou que la nuit puisse tomber pendant qu’ils sont là dans ce champ.
J’ai pris acte de ce que je vis dans ce monde impropre. J’inspire insatiablement l’odeur amère de la poussière, l’odeur amère des mauvaises herbes et des fleurs, l’odeur amère des pommes de terre et je prends sur moi. La fumée de cigarettes bon marché, les vivres dans le panier, le vin dans la bouteille, l’eau de la dame-jeanne sous un tas d’habits. La poussière explique tout. Je vis dans un monde impropre, je suis un peu plus vivant. Ma mère dit: « On n’a jamais eu autant de réserves dans le galetas. »
Dans le galetas de la famille sont apparus : une énorme malle en bois pour le seigle, des bouteilles de Coca-Cola, des nids de guêpes et de souris, des chats, une corde, une poulie pour monter des sacs, l’odeur persistante de farine, des longs tuyaux pour le gaz, des piles de journaux attachés avec de la ficelle, des chaussures d’importation usées, des bocaux de verre, des bidons, des pots, des habits hors d’usage, un trésor mirobolant. Je grimpe à l’échelle métallique du galetas, je m’émerveille, je m’étonne, le visage sceptique, je suis envahi par la mélancolie. La résignation me tourne autour, je regarde et je n’arrive pas à y croire, je m’interroge et je n’ai rien à me répondre. Dans un monde changé, ma vie est ma vie.
Il est vrai que je change chaque jour mes vestes, mes chaussettes, les chemises et les chaussettes, les chaussettes ne me suffisent plus. Autour de moi poussent des montagnes de papier, je me suis acheté une montre Seïko, des stylo-bille à usage unique, des souliers de l’Occident, des enveloppes couleur ocre, des dossiers en plastique, des dossiers métalliques, des rouleaux de scotch, des livres aux couvertures brillantes, des livres laqués, des livres colophanés, des livres doux avec une odeur française ; je me suis acheté des briquets que j’égare avec nonchalance, des rasoirs que je jette après les avoir utilisés deux ou trois fois ; je me suis acheté des kiwis que j’ai mangés, des jus d’ananas que j’ai bus, des images de la ville de Brasov que j’ai envoyées. Ma correspondance en dehors du pays se développe impétueusement, le téléphone me guide, les journaux me pressent, le téléviseur me télévisionne télépathiquement jusqu’au dernier recoin de moi-même, l’ordinateur me computérise le comporte-ment, la strada me fait stradateur et persévère, les lettres m’écrivent, les paroles me par-lent, les connaissances me font prendre connaissance, les amis ont des prétentions, l’eau appuie, la maison me case, la mouche bouge, la table mord, je n’ai plus de souffle, je n’ai plus de dents, je ne sais plus quoi faire avec mon soi-disant être, je le laisse se débattre dans le gouffre, parfois je lui promets que l’on va s’essayer ensemble le désespoir et les pleurs, le masque grisâtre de la personne normale et l’écorchement violet, intransigeant, de mon intériorité sans issue. Nous sommes un pays avec accès à la mer et cela me tranquillise. Je passe en train par des vallées ou je gravis des collines et des montagnes, je me plonge dans la civilisation en treillis des champs, je passe parmi des wagons de marchandises rouillés, à côté de gares délabrées, parmi des guérites aux portes défoncées et des tas de fer rouillé, je traverse un paysage de bois pourri et de barrières de fil de fer et de tôle, je m’envole avec le train par-dessus des terrains noircis par des mauvaises herbes et des ponts métalliques aux boulons écarquillés, je me presse comme je ne me suis jamais pressé de ma vie et ma vie cherche un point dont elle s’approcherait. La conscience n’a pas le cou-rage de le concevoir, la main au stylo-bille ne peut pas, il faut que je sourie en serrant mes lèvres, il faut que je passe à la télé pour que mon voisin de palier me lance jovialement le matin «je t’ai vu à la télé», il faut que je m’horrifie moi-même avec les dents ébréchées de ma mâchoire inférieure sur lesquelles ma langue se balade et je descends à la station Bucarest Nord avec l’enthousiasme classique de celui qui ne voyage pas pour rien et fait du provisoire une vertu.
Je survis avec mes habitudes, nous survivons ensemble, je survis avec mes ongles fissurés qui s’enfoncent parfois dans la chair de mes doigts, je pense préventivement au mollusque sensible de mon foie comme à une forme, assumée, de fatigue. C’est confortable. Je suis arrivé, enfin, au sentiment de l’inutilité, je vois dans la rhétorique de la lamentation une forme existentielle de l’être, il faut que j’écrive des articles pour les journaux et des essais, il faut que je hurle et que je crache, il faut que j’injurie et que je m’exerce en sorte d’atteindre un minimum d’éloquence académique, il faut que je promet-te, que je vomisse, que j’émette des propositions proclitiques, des prévisions privées, des projets promotionnels, il faut que je publicise le public, il faut que je tubulise la tuyauterie tourbillonnaire de ces vingt-sept lettres, il faut que je bogolise le beuglement, il faut que j’ubiqualise mon ubiquité d’écrivain aux dix doigts omnipotents. Et puis il faut encore que je descende des bières, que j’avale des plats, que j’essaie des habits, que j’entasse des chemises, que je commente le commerce sauvage, que je compote des choses qui compétent, que je comète des commissures d’accueil, que je monte dans des taxis et que j’arrive au but.

Plus marquée que tout est ma prédisposition à la théorie du dégoût. Personne n’a besoin de cette théorie. Le monde rit et consomme, paie et oublie, souffre et se réveille de son sommeil. Je suis assis sur une chaise et je regarde l’écran, j’absorbe les radiations, je vacille dans leur vacillement, à leur unisson. Je vieillis vaincu, poussé en avant, couché sur mon lit le visage enfoncé dans l’oreiller, dégoûté, écrasé, fouaillé par la folie sonore de nos quartiers ouvriers, ridiculisé par mes propres échecs, enveloppé par des croûtes superposées de fatigue et d’indifférence. La suspicion me saoule le cerveau comme une drogue, je me laisse aimer, aborder, ancrer dans de petites obligations, attaquer, admirer, pousser à l’avant-poste, éviscérer par les événements, exonérer de sens, expulser, expliquer, expédier. Je me laisse aimer et j’y perds mon temps et ma liberté, je crée des distances, des barrières artificielles, des balises, des costumes d’occasion, des masques. Je conçois des plans de fuite.
Je m’abandonne dans la routine et dans l’ivresse de ma sensibilité de verre, je m’abandonne résigné dans la routine et dans les obligations, dans des obligations morales et des obligations fragiles, je parle peu et incroyablement trop, je me tais grommelé marmonné, j’attends le miracle l’étonne-ment l’onction l’illumination et il n’y a rien qui se passe, je fixe avec obstination les murs, mes objets soumis, mes gages secrets, mes signes de fidélité dans l’espace, les plantes qui sont sur le balcon, les boites, les verres avec des stylos et stylo-bille, l’ordinateur sur le bureau, les cassettes, les tableaux, les appareils, les lampes, les modules, les cailloux de mer, les fleurs des champs séchées, les photos de groupe, le moniteur, le clavier et l’herbe plus loin, les légumes du jardin, la verdure, les balcons, les fenêtres des balcons et les gens aux bal-cons, les voitures multicolores, les chiens, les poubelles tourneboulées par le vent, le ciel blanc. Je sens la pression des heures dans mon occiput, je m’étale sur le lit, je répare le téléphone qui se tait pour haïr le téléphone qui sonne, je parle de l’anesthésie, j’écris à propos de l’anesthésie, je m’anesthésie, je me promets une sorte d’isolement-libération, je rêve d’un chalet, d’un studio, d’une grotte, d’un lieu caché, d’un ascenseur arrêté entre deux étages. L’inertie est confortable, elle me déchire. Elle sauve mon image, me pousse dehors, dans la rue, avec le chien en laisse, me conserve grisâtre et imprévisible dans une fiction munie d’un programme. Je suis ce programme.

Je sais que j’ai tout perdu. Ma résistance parmi les montagnes de livres n’est qu’une forme d’honnêteté. J’analyse et je ne comprends pas, je découvre et je ne cherche pas, j’apprends et je ne trouve pas. On me demande de la force, de la puissance et de me montrer brillant alors que je ne suis qu’un morceau de glace qui fond au soleil. Quelque chose s’use en moi, comme un savon. Quelque chose se consume en moi, comme une flamme de briquet. Je découvre la fatigue des relations, je comprends les mécanismes, je connais les chemins de sortie. Le rien à l’état pur. J’ai besoin d’un point. J’ai oublié comment on trace une ligne. Je fume des cigarettes étrangères achetées au marché, rangées sur le comptoir à côté de l’huile, du sucre, de chocolats, du café, des serviettes, des cacahouètes et du poivre. J’achète, je paie et je m’en vais.
G. C.
(Traduit du roumain par Marius Daniel Popescu. Texte paru dans le livre Reducerea la scara, Editura Paralela 45, 1999, Pitesti, Roumanie)
Une voix de Roumanie

Que devient la littérature de ce qu’on appelait hier l’Autre Europe, dont les « dissidents » tenaient alors le haut du pavé médiatique? Quels nouveaux écrivains sont apparus ces dernières années ? Quelles tendances se dessinent-elles ? A ces questions générales, les réponses particulières sont aujourd’hui sporadiques et diffuses, différentes en outre selon les pays.
En ce qui concerne plus précisément la Roumanie, ce que nous savons de l’état actuel de la littérature reste à vrai dire fragmentaire, insuffisamment illustré par l’édition francophone.
C’est dire l’intérêt que représente à nos yeux la publication de ce texte inédit de Gheorghe Craciun, dont la traduction a été établie par Marius Daniel Popescu, en complicité avec l’auteur.
Figure connue des lettres roumaines actuelles, Gheorghe Craciun (né en 1950 à Brasov) est à la fois écrivain, poète et romancier, essayiste, critique, animateur de revues et éditeur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le roman intitulé Composition aux parallèles inégales a paru en 1998 en traduction française, à l’enseigne de Maurice Nadeau.
JLK
Pastorale au dépotoir
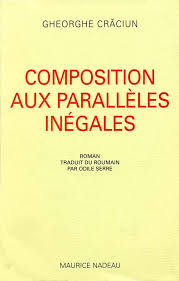
C’est un roman bien singulier de Gheorghe Craciun qui nous a été révélé par la traduction (signée Odile Serre) de Composition aux parallèles inégales, dont la version originale remonte à 1988 et qui constitue une mise en rapport à la fois inattendue et éclairante des amours antiques de Daphnis et Chloé et de la réalité roumaine des années 80. Pour mémoire, rappelons que le roman grec savamment (non moins que sensuellement) revisité par Craciun est le prototype de l’idylle sentimentale en sa fraîcheur ingénue, conçu par l’auteur grec Longus (dit aussi le Sophiste) au IIe siècle de notre ère. Avec le pied léger du poète et l’ironie du philosophe, et brassant la pleine pâte de la vie en romancier, Gheorghe Craciun va beaucoup plus loin que la parodie ou la variation: jusqu’à la pointe de deux réalités apparemment opposées, et qui ne se rejoindront pas plus que des parallèles jetées dans l’espace-temps, mais que la puissance du thème et le charme onirique de la narration font bel et bien se combiner en forme vivante et foisonnante. Dans un univers de grisaille et d’empêtrement existentiel, sur fond de désastre social et politique, voici donc courir, d’un bout à l’autre des millénaires, le furet de l’érotique bois joli qui rend un peu d’innocence et de vigueur aux mortels revenus à l’âge de fer, vivant tant bien que mal en leur pauvre et si bonne chair…
JLK
Gheorghe Craciun. Composition aux parallèles inégales, Editions Maurice Nadeau, 1998, 280 pages.
(Le Passe-Muraille, No 61, Juillet 2004)
