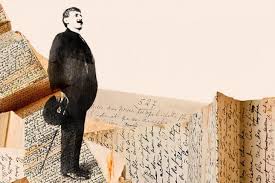Proust pile et face
Erreur sioniste et vérité sodomiste
Par Fabrice Pataut

Deux passages remarquables de La Recherche abordent la question des Juifs et des Sodomistes comme une question unique à deux faces. Le premier se trouve dans Le côté de Guermantes I, le deuxième dans Sodome et Gomorrhe I, respectivement aux pages 287-289 et 629-632 du deuxième volume de l’édition Pléiade de 1954.
Bien d’autres encore s’élaborent au fil des nombreuses remarques proustiennes sur l’affaire Dreyfus et l’esthétique particulière du monde clos des invertis, mais ces deux passages-là sont si spontanément complices qu’on résiste difficilement à la tentation de dévoiler des parallèles et des recoupements qui prennent de temps à autre des airs de conspiration. Ils se prêtent main forte par l’intermédiaire de M. de Charlus, Sodomiste par disposition, antisémite par snobisme — et inversement, tant sa détestation des Juifs lui est naturelle et son goût pour les hommes le distingue par le haut, du sommet de la hiérarchie, de ceux qui en ont un autre.
de Charlus, dont on vient de remarquer dans le premier passage que la diction ressemble à celle de Swann, voudrait savoir si Bloch est jeune et beau — « etc. », précise Proust silencieusement et comme par antiphrase en laissant la liste en suspens. C’est bien sûr la jeunesse et la beauté physique qui intéressent M. de Charlus, le « etc. » indiquant que le reste compte peu, ou ne serait qu’une variation répétitive sur ces deux caractéristiques dont il importe de savoir si elles s’appliquent ou non au camarade du narrateur. On ignore quelle réponse est faite, si elle est franche, embarassée, ou mensongère. Proust, qui a l’intelligence du raccourci et du non-dit, sait aller droit au but quand il le faut et laisse la chose dans l’ombre. Bien sûr. Ce qui intéresse M. de Charlus et qui annonce en douce un renversement des valeurs, c’est que Marcel, qu’il traite ici comme un protégé quoiqu’avec désinvolture et même par-dessus la jambe, n’a pas tort, s’il veut s’instruire (au sens mondain), « d’avoir parmi [ses amis] quelques étrangers ».
Marcel répond le plus naïvement du monde que Bloch est français. « Ah ! dit M. de Charlus, j’avais cru qu’il était juif. » Notez le choix de l’adjectif, et donc de la minuscule : Charlus est sur tout de suite sur le terrain de Marcel, qui dit de façon assez neutre que Bloch est français, et non pas un Français, ce qui pourrait avoir un air de résistance à une remarque encore plus chauvine, nationaliste et même ouvertement xénophobe.
L’erreur aurait été de conclure hâtivement que M. de Charlus est antidreyfusard parce qu’antisémite, ou, pire, qu’il l’est plus encore que ceux qui croient volontiers à la trahison de Dreyfus sans faire particulièrement cas de sa judaïté, aussi rares soient-ils. Il se passe en réalité tout autre chose.
de Charlus dévoile à Marcel la différence essentielle entre la vulgarité des antidreyfusards et la contenance hautaine de ceux qui ne pourraient croire que Dreyfus puisse jamais trahir la France. Toutes proportions gardées, c’est un peu comme la différence entre ceux qui s’abaissent à la lâcheté populacière du pogrom et ceux qui refuseraient un duel avec un Juif parce que l’idée qu’on puisse être offensé par un Juif est une erreur de goût.
de Charlus s’explique :
« Je crois que les journaux disent que Dreyfus a commis un crime contre sa patrie, je crois qu’on le dit, je ne fais aucune attention aux journaux ; je les lis comme je me lave les mains, sans trouver que cela vaille la peine de m’intéresser. En tous cas le crime est inexistant, ce compatriote de votre ami aurait commis un crime contre sa patrie s’il avait trahi la Judée, mais qu’est-ce qu’il a à voir avec la France ? »
L’objection de Marcel est immédiate. Il faut bien sûr défendre Bloch, et l’amitié pour celui à qui le narrateur emprunte parfois sa manière de parler. La réponse de Marcel a pour nous une résonance particulière après la Grande Guerre (vécue de loin dans La Recherche, essentiellement par l’intermédiaire de Saint-Loup, finalement tué au front en protégeant la retraite de ses hommes), et plus encore après celle qui nous sert aujourd’hui de référence pour la trahison des Juifs français par l’État et la nation, à savoir, la seconde.
« J’objectai que, s’il y avait jamais une guerre, les Juifs seraient aussi bien mobilisés que les autres. » Nous pourrions corriger rétrospectivement sans trop forcer : « que les Juifs s’engageraient aussi bien que les autres », ce qui fut le cas pour les deux guerres.
La réponse de Charlus à cette objection a un double aspect : le snobisme monte d’un cran, en même temps qu’une haine viscérale et profonde, exprimée avec ce que Marcel juge aussitôt être « des mots affreux et presque fous », accompagnés d’une violence physique, M. de Charlus serrant alors le bras du narrateur « à [lui] faire mal ».
Charlus ne peut bien évidemment croire que les journaux disent ceci ou cela du capitaine Dreyfus. Il le sait comme tout un chacun. La posture d’ermite mondain lui sert de figure de style. En authentique dandy, M. de Charlus se contredit volontiers ; et même le fait-il sans attendre, comme on agite un mouchoir, comme on lisse sa moustache, comme on prétend ne pas avoir remarqué une présence embarrassante. Après avoir répété inutilement qu’il le croit, il avoue tout aussi ouvertement qu’il en sait assez du crime supposé et de son rapport avec la patrie (élément essentiel du procès contre le capitaine Dreyfus) pour rendre sur le champ un verdict qui bouleverse le jugement de Marcel sur la place des Juifs dans le monde du boulevard Saint-Germain, sur leur attachement à la France, leur relation aux Chrétiens, anciennement aux Gentils, et maintenant, par- dessus tout, aux Français dits « de souche ».
« Votre Dreyfus pourrait plutôt être condamné pour infraction aux règles de l’hospitalité », précise M. de Charlus.
Ce « votre » condescendant sous-entend, je crois, une gradation. Sans que des mots particuliers ou spécifiques soient nécessaires pour le dire, nous passons de l’erreur de goût manifestée par l’intérêt pour une presse vulgaire qui commente tous les jours une affaire terriblement ennuyeuse, à une connivence religieuse partagée avec Bloch et le capitaine Dreyfus, malgré le fait que Marcel soit baptisé et que Bloch, aussi bien que Dreyfus, soient des Juifs laïques. De là, nous arrivons insensiblement à la communauté raciale. Pour peu que la communauté religieuse fasse défaut, il nous reste après tout celle-là, plus profonde, plus essentielle et finalement consitutive d’une judaïté authentique puisqu’aucune conversion ou reniement ne permet de s’y soustraire. Une seule chose l’indique, mais elle l’indique clairement, qui, de plus, jette les Juifs en bas de l’échelle raciale où se retrouvent pêle-mêle nombre de « créature[s] extra-européenne[s] ». Charlus s’explique : « […] si on fait venir des Sénégalais ou des Malgaches, je ne pense pas qu’ils mettront grand cœur à défendre la France, et c’est bien naturel ». Il y a, en quelque sorte par prémonition, dans une langue châtiée, un écho du racisme réservé par Céline aux Africains dans Bagatelles pour un massacre dix-sept ans plus tard (1937). Mais surtout, la descente est-elle ici vertigineuse : on passe des Juifs, qui ont quand même l’Ancien Testament pour eux, aux Noirs, dont chacun connaît l’ancien statut d’esclaves et rien d’autre ou à peu près, aux Malgaches dont on ignore tout. Qui, dans la société française de l’affaire Dreyfus (1894-1906), s’intéresse à la colonisation de Madagascar (1897-1946), excessivement violente, avec travail forcé et corvées à l’avenant, contemporaine du début de l’affaire à trois années près ? Elle n’est mentionée nulle part dans La Recherche ; elle n’existe pas. Être Juif, c’est être un patriote de la Judée (un Israélite, comme diront bientôt les antisémites des années 30 et 40). Être Noir, c’est être un sauvage d’Afrique. Être malgache, c’est être rien.
(Par contraste, remarquez comment Basin de Guermantes, frère de M. de Charlus, farouchement antidreyfusard comme il convient à sa classe, devient soudainement dreyfusard « enragé » par snobisme, au retour d’une cure d’eau, convaincu sans difficulté par une princesse italienne et ses deux belles-sœurs, à l’occasion d’une partie de bridge, de tout le contraire de qu’il a précédemment pensé (Sodome et Gomorrhe I, pp. 739-740). Le duc trouvait le dreyfusisme de Swann inacceptable pour la raison que Swann est un homme du monde, membre du Jockey Club, et qu’il appartient à un milieu infiniment supérieur à celui du capitaine Dreyfus. La culpabilité réelle ou supposée de Dreyfus importait peu. Ce qui comptait était que Swann, « un familier du duc de Chartres », commettait, en étant dreyfusard, une invraisemblable erreur de goût. Voilà le duc, par lâcheté, esprit d’imitation et sentiment d’infériorité intellectuelle devant des femmes, persuadé du vide de l’accusation. Voilà que la vacuité du procès passe tout à coup au-dessus des questions de hiérarchie, de convention et de bienséance sociale (Sodome et Gomorrhe I, pp. 677-679 ).)
En tout cas, avec les Juifs, a-t-on affaire autre chose. Il y a l’Orient, et bien sûr la Bible, qui fait que l’anti-judaïsme et l’antisémitisme ont qu’on le veuille ou non partie liée (historiquement, sinon conceptuellement). M. de Charlus prend d’ailleurs Racine à partie. Et quoi de plus français, de plus classique, de plus racé (en un sens), en tout cas de plus aristocratique que la magnifique prose théâtrale de Racine ?
« Mais laissons cela, conclut donc temporairement M. de Charlus. Peut-être pourriez-vous demander à votre ami de me faire assister à quelque belle fête au Temple, à une circoncision, à des chants juifs. Il pourrait peut-être louer une salle et me donner quelque divertissement biblique, comme les filles de Saint-Cyr jouèrent des scènes tirées des Psaumes par Racine pour distraire Louis XIV. »
Il y a bien sûr, en ce qui concerne Racine, non seulement le cas des Psaumes, mais celui d’Esther et d’Athalie, la dernière pièce. J’y reviendrai.
« Vous pourriez peut-être arranger cela, même des parties pour faire rire. Par exemple, une lutte entre votre ami et son père où il le blesserait comme David Goliath. Cela composerait une farce assez plaisante. Il pourrait même, pendant qu’il y est, frapper à coups redoublés sur sa charogne, ou, comme dirait ma vieille bonne, sa carogne de mère. Voilà qui serait fort bien fait et ne serait pas pour nous déplaire, hein ! petit ami, puisque nous aimons les spectacles exotiques et que frapper cette créature extra-européenne, ce serait donner une correction méritée à un vieux chameau. »
Quoi de plus drôle, en effet, du point de vue d’un dandysme condescendant, que de voir des Juifs se battre en eux ? Non seulement entre eux pour donner aux non-Juifs le désolant spectacle de leur vulgarité, mais, qui plus est, comme des bêtes ; et non seulement comme des bêtes, mais comme des bêtes elles aussi « extra-européennes », et pas n’importe lesquelles, d’ailleurs : des chameaux, animaux à la fois bibliques, juifs et arabes.
Voilà le monde de l’Ancien Testament réduit à des « spectacles exotiques » de cabaret, l’occasion d’un « divertissement biblique » où s’exhibent comme dans une foire des « créature[s] extra-européenne[s] ». Le spectacle serait au dire de Charlus, « asiatique », comme si la Terre Sainte, par un tour de passe passe géographique, se trouvait en Asie.
C’est ni plus ni moins l’Europe débarassée des Juifs qu’envisage M. de Charlus, la vieille Europe en proie à des considérations strictement raciales, agitée d’une manière à la fois inconséquente et contradictoire par « un préjugé violent contre un peuple de qui nous vint Jésus », pour reprendre les mots de Clémenceau au moment de l’affaire.
Marcel continue de répondre sur le ton de la conversation normale, faisant fi du caractère semble-t-il fantastique ou irréel du spectacle décrit par Charlus, le prenant au pied de la lettre, comme si, dans le cadre d’activités culturelles ludiques proprement juives, hors du cercle mondain du boulevard Saint-Germain, il était parfaitement envisageable de se battre comme des animaux pour le plaisir du public. Il note le plus pragmatiquement du monde que non seulement la mère de Bloch n’existe plus, mais que M. Bloch ne pourrait se plaire à un jeu auquel on pourrait lui crever les yeux,
de Charlus probablement fâché répond : « Voilà […] une femme qui a eu grand tort de mourir. Quant aux yeux crevés, justement la Synagogue est aveugle, elle ne voit pas les vérités de l’Évangile. En tous cas, pensez, en ce moment où tous ces malheureux juifs tremblent devant la fureur stupide des chrétiens, quel honneur pour eux de voir un homme comme moi condescendre à s’amuser de leurs jeux ! » La remarque sur l’aveuglement renvoie implicitement (entre autres) à Pascal, pour qui le Nouveau Testament révèle la vérité de l’Ancien. Je reviendrai sur ce point, en lien avec la remarque de Charlus sur lesPsaumesde Racine.
Si la fureur stupide est bien celle déclenchée par l’affaire Dreyfus, fureur à laquelle M. de Charlus refuse par snobisme de participer, M. de Charlus ne propose rien de moins qu’un substitut : plutôt que de s’acharner à prouver la culpabilité de Dreyfus, moquons nous plutôt de la vulgarité des jeux juifs.
Charlus, contre toute attente, prend finalement cette histoire de spectacle oriental au pied de la lettre. Et lorsque Marcel lui propose de lui présenter le père de Bloch, présent lui aussi à la matinée chez Madame de Villeparisis, il réplique, furieux : « Me le présenter ! Mais il faut que vous ayez bien peu le sentiment des valeurs ! […] Tout au plus, si on me donne un jour le spectacle asiatique que j’esquissais, pourrais-je adresser à cet affreux bonhomme quelques paroles empreintes de bonhommie. Mais à condition qu’il se soit laissé copieusement rosser par son fils. Je pourrais aller jusqu’à exprimer ma satisfaction. »
Par un renversement des contraires difficile à imaginer, nous sommes, dans le salon de Madame de Villeparisis, en train de discuter la possibilité d’une sortie théâtrale d’un genre un peu vulgaire, bien que toute aussi ordinaire et bienvenue qu’une autre pour peu qu’on veuille échapper aux obligations de son carnet mondain : à savoir une sortie au boulevard, à la comédie, au café-concert.
II
C’est dans de tout autres lieux et à l’occasion de sorties bien différentes de celles considérées par Proust dans le salon mondain de Madame de Villeparisis que se joue la question de l’homosexualité vue à travers le prisme de l’Orient biblique.
Proust envisage à ce propos une variation sur le thème du désir homosexuel. Certains invertis recherchent « essentiellement l’amour d’un homme de l’autre race, c’est-à-dire d’un homme aimant les femmes » (p. 631). En cas de réussite, le plaisir de la séduction pourrait s’en trouver augmenté. Il se doublerait de celui d’avoir séduit non pas un homme qui aime les hommes et ferait donc déjà partie de la race des êtres d’exception, lesquels, précise Proust, sont une foule, mais un homme qui vit, aime et souffre d’une manière différente pour ne pas dire opposée, autrement dit un homme étranger aux règles du monde clos des invertis.
C’est là un trait particulier de l’homosexualité de M. de Charlus, masochiste à ses heures, comme le narrateur le découvrira bientôt. M. de Charlus ne recherche pas seulement l’amour des hommes, il recherche l’amour d’un homme qui ne pourra pas l’aimer. Pour cet homme idéal et pour tous ceux qui comme lui se rassemblent en une foule beaucoup plus nombreuse que celle des invertis, laquelle reste après tout un club, la conversion n’est pas seulement improbable, elle est impossible. L’échec est d’autant plus certain que Charlus fréquente comme on sait des maisons de passe où de jeunes hommes pauvres se vendent pour de l’argent. Il s’y fait frapper et fouetter, souvent avec une grande violence. Dans ces lieux cachés aux yeux du monde, que ce soit celui des invertis ou des autres, il ne peut y avoir aucun plaisir à jouer le jeu de la séduction, à retrouver un habitué, à marquer une préférence, à laisser paraître son trouble. Les hommes qui font souffrir Charlus dans une chambre capitonnée ne sont pas le moins du monde homosexuels. Ils n’ont que faire des particularités sodomistes. L’argent seul fait la loi. On les paye pour être brutaux, méprisants, hautains même, sans pitié pour les dépravations des riches.
Mais quid ce deux qui sont, disons, homosexuels par nature ou de naissance, pour qui la conversion aussi bien que l’homophobie sont superflues ? Que dire de ceux pour qui la beauté du même corps est cause d’un trouble parfois tendre, à d’autres moments cruel ou désespéré, mais toujours spontané et incontournable ?
Tourner la tête pour ne pas se trahir. Voilà le signe.
À la manière d’un peintre ou d’un sculpteur qui saisit le mouvement sur le vif en lui donnant la fixité qui permet d’en observer les détails, Proust fait grand cas de ce geste à la fois pudique, prudent et révélateur. Les homosexuels eurent, dit Proust, « une nombreuse postérité chez qui ce geste est resté habituel ». Il se sont fixés partout, sur toute la terre, sans attache à un lieu particulier, « ayant hérité le mensonge qui permit à leurs ancêtres de quitter la ville maudite » (p. 632), c’est-à-dire Sodome. L’exil leur est consubstantiel et le geste en même temps salvateur et sacrificiel, loin de ne pas les trahir, joue le rôle biblique d’un stigmate.
Pourrait-on dire la même chose des Juifs, pour qui l’exil et l’errance sont certainement des caractéristiques historiques majeures, avec d’autres stigmates en tête ? Proust se garde bien sûr de suggérer qu’il y aurait une erreur sioniste à croire que les Juifs sont les citoyens historiques et attitrés de la Judée, comme il y aurait une erreur sodomiste à croire que les homosexuels ont un lien fondateur et essentiel avec un lieu particulier de l’antiquité hébraïque. C’est au contraire reconnaître une vérité sodomiste que comprendre que la foule des rescapés de Sodome est partout chez elle (à la manière des Juifs considérés sous l’angle des idéaux de la Révolution Française, aurait-on envie d’ajouter). On ne peut bien entendu soutenir que, bien qu’orientaux de naissance, les Juifs n’ont pas plus de droits à faire valoir sur la Judée que les homosexuels n’en ont à faire valoir sur Sodome. L’asymétrie tient en partie au fait que, si certains Juifs sont sionistes et revendiquent un droit territorial lorsqu’ils le sont, on a encore vu aucun descendant de Sodome exiger qu’on leur rende une terre natale au sud de la Mer Morte, que l’actuelle Jordanie occuperait illégalement par la force.
Proust insiste sur cette asymétrie en clôture de Sodome et Gomorrhe I : « [o]n a voulu provisoirement prévenir l’erreur funeste qui consisterait, de même qu’on a encouragé un mouvement sioniste, à créer un mouvement sodomiste et à rebâtir Sodome » (loc. cit.).
Qu’arriverait-il alors ? Ni plus ni moins ce qu’on observe partout où l’homosexualité doit se cacher. « [À] peine arrivés, les sodomistes quitteraient la ville pour ne pas avoir l’air d’en être, prendraient femme, entretiendraient des maîtresses dans d’autres cités où ils trouveraient d’ailleurs toutes les distractions convenables. Ils n’iraient à Sodome que les jours de suprême nécessité, quand la ville serait vide, par ces temps où la faim fait sortir le loup du bois. C’est dire que tout se passerait en somme comme à Londres, à Berlin, à Rome, à Pétrograd ou à Paris » (loc. cit.).
Les homosexuels sont réduits au mensonge, lequel a ses limites puisque, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils s’en défendent ou s’en félicitent, « [i]ls forment dans tous les pays une colonie orientale, cultivée, musicienne, médisante, qui a des qualités charmantes et d’insupportables défauts. » (loc. cit.). Ils sont donc visibles, notamment dans le microcosme mondain du boulevard Saint-Germain. Il y a une manière d’être homosexuelle comme il y a une manière d’être juive, chacune avec ses goûts propres, son lexique, ses prédilections, ses manies, ses faiblesses. Les Juifs pourraient eux aussi être obligés au mensonge ; et ils le sont bien sûr dès que leur judaïté — religieuse, culturelle, raciale, peu importe le critère choisi — les forcera à cacher qu’ils sont juifs, ou tout au moins à le passer sous silence ou à en nier l’importance. Ce sont là des faits sociaux prégnants et incontournables dont Proust observe les nombreux détails tout au long de la Recherche.
Qu’arriverait-il du point de vue proustien si on rebâtissait Israël ? Proust reste silencieux sur cette question. Mais il n’est pas contraire à l’esprit du livre — bien qu’on ne trouve à ma connaissance rien de tel verbatim dans la Recherche — que la remarque à propos de la « colonie orientale » s’applique également au cas des Juifs, notamment à celui des Juifs mécènnes, cultivés, musiciens, certes médisants mais après tout pas plus que les goyim catholiques du boulevard Saint-Germain.
Toute la question, aussi bien pour les Juifs que pour les homosexuels, est dans le phénomène complexe de l’exception et de la singularité qu’on partage contre son gré : la judaïté, pas plus que l’homosexualité, ne sont une question de délibération. Bien que le goût et la croyance soient de nature hétérogène, l’attirance pour les gens du même sexe reçoit ici une connotation pour ne pas dire une définition biblique, à l’instar du refus de croire que Jésus est le Messie. Proust, de même Charlus par son intermédiaire, est particulièrement sensible à cette question du microcosme dont les membres vivent selon des règles qui ne peuvent valoir ailleurs et sont vues de l’extérieur comme une bizarrerie, un égarement, voire une malheureuse erreur, aussi bien pour des raisons de bienséance morale (la sodomie) que de refus de la vérité révélée (Jésus seul vrai messie).
Proust, en fin observateur des mouvements du corps, inscrit le mouvement de tête sodomiste dans un cadre beaucoup plus large : « Au contraire, on laissa s’enfuir tous les Sodomistes honteux, même si, apercevant un jeune garçon ils détournaient la tête, comme la femme de Loth, sans être pour cela changés, comme elle, en statues de sel. De sorte qu’ils eurent une nombreuse postérité chez qui ce geste est resté habituel, pareil à celui des femmes débauchées qui, en ayant l’air de regarder un étalage de chaussures placées derrière une vitrine, retournent la tête vers un étudiant. Ces descendants des Sodomistes, si nombreux qu’on peut leur appliquer l’autre verset de la Genèse : ‘Si quelqu’un peut compter la poussière de la terre, il pourra aussi compter cette postérité’, se sont fixés sur toute la terre, ils ont eu accès à toutes les professions, et entrent si bien dans les clubs les plus fermés que, quand un sodomiste n’y est pas admis, les boules noires y sont en majorité celles de sodomistes, mais qui ont besoin d’incriminer la sodomie, ayant hérité le mensonge qui permit à leurs ancêtres de quitter la ville maudite. » (pp. 631-632).
Car non seulement détournent-ils la tête par peur de se trahir, exactement comme les Sodomistes de l’Antiquité, mais lorsqu’au contraire ils la tournent, c’est pour signifier à ceux qui ont leur goût qu’ils les ont reconnus — à un geste, à une attitude, à un regard — et partagent aussi bien l’opprobe que le plaisir, voire l’honneur, d’appartenir à cette « race » qui avait dû craindre, il y a si longtemps, le jugement de Dieu.
Comme quoi l’hospitalité, toujours fragile, prête à se retourner comme un gant pour prêcher l’exclusion, a des revers paradoxaux. À l’intérieur de la communauté hétérosexuelle plus large, la colonie homosexuelle se trahit, même si les homosexuels ne sont ni plus ni moins cultivés, musiciens et médisants que les autres. Les Juifs se trahissent-ils eux-aussi, quoiqu’avec d’autres signes distinctifs ?
Si le caractère oriental des homosexuels est toujours caché, celui des Juifs l’est rarement. Il l’est encore moins au moment de l’affaire Dreyfus et de La France juive d’Édouard Drumont (1886). La caricature antisémite se nourrit de particularités raciales : le nez busqué, voire crochu, les paupières lourdes, les cernes gris, les lèvres épaisses, le sourire fourbe. La caricature homophobe se nourrit plutôt de poses : la moue, le petit doigt relevé, la main molle, et de tics vestimentaires hérités du dandysme : cannes à pommeau, jabots volumineux, bijoux aux doigts, cols ouverts, vestes cintrées.
Aucun geste n’est emblématique dans le cas des Juifs ; l’Orient, pour la commuanuté juive mondaine observée par Proust, joue un tout autre rôle dont on trouve des traces dans les remarques acerbes et violentes de M. de Charlus.
J’y reviens rapidement pour finir, notamment aux Psaumes dont Racine a tiré des scènes pour distraire Louis XIV, et que Charlus élève pour ainsi dire au rang d’exemple. Comme pour Esther, écrit à la demande de Mme de Maintenon pour divertir les demoiselles de Saint-Cyr, l’appropriation racinienne de l’orient biblique lave l’Ancien Testament de trop de judaïté malséante. Si le propos était de montrer, comme l’affirme M. de Charlus, que la Synagogue est aveugle et ne voit pas les vérités de l’Evangile, il faudrait plutôt revenir à Athalie, dont il n’est pas question dans le salon de Madame de Villeparisis où le narrateur entend défendre son ami Bloch. Car c’est à propos de cette œuvre-là, finalement, que les remarques antisémites de Charlus sur la pureté classique de Racine, à la fois catholique et impénétrable aux Juifs coupables d’une lecture superficielle et bornée de leur propre Livre, pourraient être les plus malheureuses. C’est sur ce point littéraire que le rejet des Juifs prend la forme très insidieuse d’une préférence pour un sionisme qui, après tout, débarasserait la France de gens vulgaires et encombrants en recommendant qu’ils s’en retournent pour de bon en Palestine.
Joas, seul survivant des descendants de David, héritier légitime du trône d’Israël, caché dans le Saint des saints, n’a rien de moins qu’une nature christique. Racine prend soin de préciser dans sa préface à Athalie : « Il s’y agissait non seulement de conserver le sceptre dans la maison de David, mais encore de conserver à ce grand Roi cette suite de Descendants dont devait naître le Messie. Car ce Messie tant de fois promis comme Fils d’Abraham, devait aussi être Fils de David et de tous les Rois de Juda. » (p. 1012, dans le premier volume des Œuvres complètes de l’édition Pléiade de 1999). Et plus loin : « il s’agit de mettre sur le trône un des Ancêtres du Messie » (p. 1013).
Dans ses notes manuscrites pour Athalie, Racine, revenant sur le « Quelle Jérusalem nouvelle […] ? » de la scène VII de l’acte III, cite les Psaumes en latin, notamment le psaume LXXXIX, au vers 52 (p. 1088) : « Exprobaverunt vestigia Christi tui » : « Ils ont outragé les pas de ton oint ». (Dans la traduction de Louis Segond : « Souviens-toi […] de leurs outrages contre les pas de ton oint ».) Racine choisit à dessein la majuscule pour Christi. L’oint est bien sûr le Rédempteur lui-même et non pas n’importe quel oint (christos) qui aurait reçu l’onction d’huile sainte. L’intention est claire : montrer, au cas où les catholiques l’auraient oublié, que le salut vient par les Juifs. Les Sodomistes n’ont bien évidemment pas droit à une telle faveur, encore moins à quoi que ce soit qui montrerait que l’opprobe dont ils sont victime est indigne et pêche par erreur. Bien au contraire. Il est toujours dangereux, dans le monde proustien, de détourner la tête vers les jeunes garçons, et cette vérité-là est sans appel.