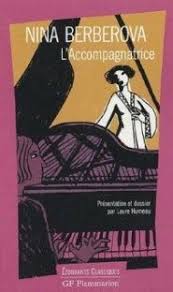En mémoire de Nina Berberova
Elle fut l’indomptable accompagnatrice du siècle. Après un accès tardif à la célébrité, l’exilée russe s’est éteinte à Philadelphie en septembre 1993, à l’âge de 92 ans. Elle laisse une œuvre intéressante, quoique inférieure au battage médiatique qu’elle suscita…
par Gian Gaspard Kasperl
En un temps où il suffisait, ou presque, de faire une bonne prestation sur le plateau d’Apostrophes pour être consacré grand écrivain, le nom de Nina Berberova s’auréola de gloire aux yeux du grand public ignorant le plus souvent ceux du grand poète Khodassiévitch (son amant), d’Ivan Bounine (premier Nobel russe de littérature), du génial Zamiatine ou de l’éclatante Tsvetaeva, contemporains de la star d’un jour dont les talents surclassent assurément de beaucoup le sien.
Personnage fort intéressant, au demeurant, que Nina Berberova. Témoin précieux (mais parfois peu fiable) de toute une époque, et, plus précisément, des tribulations de l’émigration russe depuis les années vingt, elle laisse, notamment, une très volumineuse autobiographie à travers le siècle, de son enfance pétersbourgeoise à l’exil américain, en passant par ses années parisiennes, intitulée «C’est moi qui souligne» et publiée à l’enseigne d’Actes-Sud en 1990.
Quant à en faire un grand écrivain comme s’y employa Hubert Nyssen, son éditeur en langue française, cela nous semble excessif. De fait, on ne saurait la placer à la même hauteur qu’un Andréi Biély ou qu’un Vladimir Nabokov, qu’elle a rencontrés et dont elle parle d’ailleurs avec feu, ni non plus sur le même rang de quelques autres qu’elle rabaisse trop facilement.
On s’y tromperait en effet à n’écouter qu’elle, tant Berberova s’y entend pour arranger son personnage et distribuer bons et mauvais points en fonction de critères souvent passionnels. Cela souligné, après tant de médiatiques pâmoisons relancées par un film tiré de «L’accompagnatrice», restent du moins le témoignage substantiel et profus que nous venons de citer, et cet autre document de première main que constitue sa relation quotidienne de «L’affaire Kravtchenko», honteux épisode de l’histoire intellectuelle française d’après- guerre.
A côté d’une biographie de la baronne Boudberg, romanesque agent double qui fut la maîtresse de Gorki, Nina Berberova laisse encore une série de très courts romans doux-acides qui évoquent, dans un climat expressionniste «à la Dostoïevski» qu’adoucit une certaine mélancolie «à la Tchékhov», les tribulations de personnages déracinés comme elle, en butte à la pauvreté et aux passions véhémentes ou malheureuses («Le roseau révolté»), à la déréliction marginale («Le laquais et la putain»), à la solitude exacerbée par l’envie («L’accompagnatrice») ou au poids du monde, qu’on ressent particulièrement dans l’émouvant «De cape et de larmes».
«J’avais une secrète intuition qu’au- delà de la réalité et des événements il y avait l’image, la mélodie», remarque la narratrice de ce beau récit. «Comme si, dans les années les plus obscures, les plus bestiales de mon existence, la beauté et la poésie du monde m’avaient fait un clin d’oeil en passant comme un éclair.»
Peut-être est-ce ce «clin d’œil», précisément, qui a donné à Nina Berberova la force de surmonter, avec une énergie indomptable, les difficultés et les épreuves, dont on perçoit les échos d’autant plus touchants qu’ils sont dépouillés jusqu’à l’os, dans son «Cahier noir» rédigé entre 1939 et 1950?
En février 1941, à Paris, elle note ainsi: «A l’approche des époques de famine et de froid, les allumettes brûlent difficilement. Je l’avais déjà remarqué en 1920. C’est là le présage d’une grande misère.»
Et en décembre: «Si seulement je pouvais m’empêcher de trembler en regardant une carte de la Russie, mais je n’y arrive pas…»
G.G.K.