Du Sud à l’infini
Borges sans Nobel ni Grande muraille,
par Christophe Calame
Borges est mort sans voir reçu le Prix Nobel. Son œuvre, ni humaniste, ni optimiste, ni sérieuse, ni morale, ni même tragique, n’avait rien de ce qui paraît louable en Scandinavie. Borges prétendait avoir besoin de l’argent du Prix Nobel pour aller visiter, lui aveugle, la Grande muraille de Chine, monument insensé («Enclore un verger ou un jardin est chose commune, mais non enclore un empire» rappelle Borges) édifié par le même empereur qui ordonna aussi la destruction de tous les livres, trait qui lui vaut d’être un personnage borgesien. La présence de Borges sur la Grande muraille aurait ainsi, plus que tout prix Nobel, représenté le triomphe de l’auteur sur l’empereur, de la mémoire sur le pouvoir, du livre sur le feu qui le détruit. Mais l’humanité n’avait manifestement pas les moyens, à ce moment-là, de s’offrir un tel symbole.

Pince-sans-rire résigné, Borges se demande pourquoi le même empereur a voulu attacher son nom – qui est devenu celui de la Chine, d’ailleurs – à ces deux actes-là. Il discute tour à tour les hypothèses suivantes: l’empereur voulait peut-être effacer tout le passé pour effacer un seul souvenir, celui de l’infamie de sa mère ? Ou alors la muraille et le feu furent-ils des barrières destinées à arrêter la mort, en arrêtant le temps ? Et si les deux actes ne sont pas simultanés, peut-on rêver à «l’image d’un roi qui commença par détruire, puis se résigna à conserver, ou celle d’un roi désenchanté qui détruisit ce qu’il avait d’abord défendu» ?
«Peut-être la muraille fut-elle un métaphore : peut-être Chi Hoang-ti condamna-t-il ceux qui adoraient le passé à une œuvre aussi vaste que le passé, aussi vaste et aussi inutile» ? Peut-être enfin, l’empereur agit-il sagement, car l’empire était périssable tandis que les livres ne l’étaient pas, qui n’enseignent que «ce qu’enseigne l’univers entier ou la conscience de chaque homme» ? Tout l’art de Borges n’est pas de raconter une histoire, mais de la problématiser en la faisant crouler sous les hypothèses, comme si c’était la critique qui inventait l’œuvre et ses multiples possibles.

Dans toutes ses fictions, le ludisme de l’érudition exclut tout plagiat (puisque tout livre, même et surtout exactement réécrit, est unique dans Babel), et le fantastique métaphysique tout recours à l’humanisme lacrymal. L’œuvre de Borges est abstraite, sèche, donc toujours drôle. Le Dictionnaire philosophique de V oltaire n’est jamais loin, même si le bibliothécaire de Babel ne prétend pas, lui, écraser l’Infâme. En politique, il déclare tout simplement avoir «adhéré au parti conservateur car ce parti est indubitablement le seul à ne pouvoir susciter le fanatisme». L’auteur de L’Histoire de l’infamie n’avait pas de tendresse pour Perón qui le lui rendait bien, puisqu’il le destitua de sa charge de directeur de la Bibliothèque nationale pour le nommer inspecteur des volailles des marchés de Buenos-Aires.

Le premier tome des Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, en recueillant des textes publiés de 1923 à 1952, nous permet de mieux répondre à la question: comment Borges est-il devenu écrivain ? On le suit dès ses premiers pas, dans cette découverte de l’inauthenticité fatale de la littérature gauchesca qui fut aussi pour lui la découverte de l’universalité fatale de la littérature. Mais Borges ne s’est que peu expliqué sur la genèse de son œuvre, et a même déclaré qu’il n’avait accepté de voir publier ses œuvres complètes en espagnol que pour «l’occasion que cela donnait de supprimer ces écrits ridicules». (Mais quelle sottise, d’écouter un écrivain – ou pire encore ses proches – quand il s’agit de dresser ses œuvres complètes ! La coquetterie et les scrupules rendraient cette tâche impossible, si on devait les suivre. La pathologie ordinaire du rapport à soi, toujours justement réprimée dans la vie sociale, doit-elle être sanctifiée dans la vie littéraire ?)
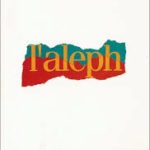
Chez Borges, le Sud c’est la mort. Le personnage de la nouvelle intitulée précisément Le Sud, qui fait le choix de s’enfoncer dans la campagne, vers cette pampa où combattirent ses ancêtres, va mourir dans un duel sans gloire, lui qui «empoigne avec fermeté le couteau qu’il ne saura sans doute pas manier et sort dans la plaine» comme le dit la conclusion de la nouvelle. C’est pourtant bien cela la littérature au premier degré: un petit instant de bravoure fatale. Mais cette littérature est essentiellement limitée. La nouvelle intitulée L’Aleph nous offre au contraire la vision de l’infini. Allongé dans le noir, sous la dix-neuvième marche de l’escalier qui descend à la cave dans un immeuble de Buenos-Aires, on peut voir tout, c’est à dire l’infini, le multum in parvo alchimique et cabaliste. Un auteur stupide s’en sert pour écrire une description détaillée du monde. Le narrateur de la nouvelle, dégoûté de sa vision simultanée de la totalité, comprend que la littérature est aussi vaine que la carte de l’Empire qui devait avoir la taille de l’Empire. Le jour où la littérature romande s’apercevra que le petit village de montagne est une convention aussi déplorable que le gaucho, elle connaîtra elle aussi, sans doute, la vision de l’Aleph.
Comme tous les gens qui connaissent vraiment bien le monde, Borges a bien aimé la Suisse. On peut mentionner une expérience mystique sur laquelle il restera silencieux (l’Aleph ?) qui aurait eu lieu à Fribourg, mais aussi son premier poème écrit à Martigny, son «vague baccalauréat obtenu à Genève, que la critique continue à rechercher» selon la notice autobiographique des œuvres complètes en espagnol – dans ÉCRITURE 28, Daniel Mayer et Sylviane Roche avaient établi que ce baccalauréat n’existe pas, mais quelle vanité borgésienne que d’établir la vérité : la chronologie de Jean Pierre Bernès, l’éditeur de la Pléiade, ne tient aucun compte des preuves rassemblées à partir des archives du Collège Calvin ! –, et cette tombe enfin, à Genève, où il est revenu mourir après avoir relaté dans une nouvelle de jeunesse la rencontre avec son double, un autre Borges plus âgé, sur les quais du Léman.

Dans le dernier poème du dernier recueil de l’auteur traduit en français, Les Conjurés, un hommage est rendu à la Suisse. Des trois Suisses du Pacte, Borges écrit «Ils ont pris l’étrange résolution d’être raisonnables (…) Ils furent soldats de la Confédération puis mercenaires, parce qu’ils étaient pauvres, avaient l’habitude de la guerre et n’ignoraient pas que toutes les entreprises de l’homme sont également vaines (…) Les cantons maintenant sont vingt-deux. Celui de Genève le dernier , est l’une de mes patries / Demain, ils seront toutes la planète». Contre la domination de cet infini qui est une révélation vaine et comique, la simple raison reste le seul véritable complot possible de l’humanité. Quand on a vu l’Aleph et son double, on renonce à la folie, et peut-être aussi au sérieux de l’écriture.
Ch. C.
Borges, Œuvres complètes I, édition présentée, établie et annotée par Jean Pierre Bernès, Bibl. de la Pléiade, Gallimard 1993.

