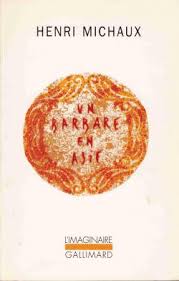Constellations des gouffres
À propos de l’entrée de Michaux le transgressif en Pléiade,
par Christophe Calame
Il y a vingt-cinq ans, on ne comptait pas Henri Michaux parmi les classiques, mais parmi les écrivains de la transgression. Au rayon des «maudits», Baudelaire, Quincey, Burroughs et Jünger étaient alors les classiques de la drogue, fléau qui n’était pas mieux connu des parents que de leurs enfants fascinés. Il faut dire que la drogue ne frappait pas encore les enfants les moins aimés et les plus dépourvus de ressources culturelles, comme aujourd’hui.
Non, la drogue était goûtée par les plus doués et les plus nantis, mais avec prudence et mesure, comme un signe initiatique de reconnaissance et de révolte à la fois. «Psychédélique» voulait dire quelque chose: on ne considérait pas la drogue comme un stimulant, ni même comme un excitant.
Dans son article «révolutionnaire» de 1851 sur Le vin et le haschisch comparés comme moyen de multiplication de l’individualité, le jeune Baudelaire oppose au vin légitime de l’ouvrier révolutionnaire («le vin est semblable à l’homme») le haschisch «antisocial»: «Le haschisch appartient à la classe des joies solitaires; il est fait pour de misérables oisifs.» Ces termes me sont restés: j’ai observé bien des fois comment les drogues douces viennent combler l’absence de pensées, de sensation, l’ennui du sous-prolétariat marginalisé, fut-il universitaire. Misérables oisifs !

Avec Michaux, de plus, on n’en était pas resté au haschisch. On allait bien plus loin, dans le gaspillage de ce que Baudelaire et son siècle appelaient le «fluide nerveux». Mais, à nos propres yeux, nous n’étions pas de «misérables oisifs»: la route qui conduisait à Kaboul était encore ouverte, et nous étions quelques-uns à la préférer à la route qui menait à Pékin. Elle nous semblait renouer avec l’homme intégral plus directement que la barbe de Marx ou la moustache de Staline qui, après tout, n’étaient pas des hommes extraordinaires. Katmandou n’allait pas avec le venin universitaire ni avec la démence tyrannique. L’œil du Bouddha s’ouvrait lentement sur le siècle.

La petite librairie La Marge, en face du Gymnase, à Lausanne, présentait en vitrine un magnifique pot de chanvre indien florissant dont les feuilles découpées étaient encore peu connues, en tout cas de la gendarmerie vaudoise qui patrouillait placidement, en veillant sur l’«agitation» à la sortie des écoles. Dans la librairie subversive, les livres interdits en France, ceux de Pauvert et Losfeld, trônaient en bonne place (selon un historien de l’édition, Pascal Fouché, «il faut constater que la période qui a comporté le plus d’interdictions de livres s’est située après Mai, et jusqu’en 1973, période où Raymond Marcelin était ministre de l’Intérieur»): Sade et le cinéma, l’alchimie et la science-fiction appelaient à la révolte contre la raison. Et Gallimard ne figurait, à vrai dire, dans cette officine fascinante que par les œuvres d’Henri Michaux.
J’acquis alors quelques livres que je possède toujours. J’avoue que je ne les ai jamais lus d’un bout à l’autre (et que ferons-nous, bientôt, de 1200 pages de textes et de dessins à la mescaline ?). Mais ils m’étaient nécessaires: ils étaient là pour attester de la possibilité toujours ouverte de ce voyage intérieur, qui n’est qu’un prolongement immobile du grand voyage que je n’ai pas fait: celui de la Route par excellence, celle des livres de Bouvier, de Pestelli et de Lovay (Chappaz ne connaissait pas encore le Tibet).
Le voyage était absolument à l’ordre du jour: non pas sarcastique et narcissique comme dans les années 80 (avec le Quai Voltaire, Paul Morand, Evelyn Waugh, Paul Bowles). Non, le voyage se «portait» extatique et initiatique. Le Moi devait éclater, et non se réparer infiniment, ni demander réparation à la société ou à l’Etat. La route qui allait du Barbare à Katmandou n’était pas faite pour des victimes. Elle était meurtrière, bien sûr, mais nous ne voulions pas le savoir. Ce rêve de voyage n’aurait pas supporté des lectures comme celles de Leiris ou même d’un certain Michaux, voyageurs désabusés, et bien cartésiens dans leurs déceptions et leur retour de tout.
Descartes ? On sursautera peut-être à ce nom, inattendu à propos de Michaux. C’est que l’emblématique «cavalier français qui partit d’un si bon pas» (Péguy) avait, lui aussi, voulu lire dans le grand livre du monde, avant de découvrir qu’il était écrit en langage mathématique, et de s’enfermer dans un poêle en Allemagne, ayant pris la «résolution d’étudier en moi-même». On retrouvera chez Michaux le même soin et la même crainte de la renommée. Un même besoin de célébrité secrète (pas d’interviews, pas de photos: on voit bien Descartes imposer aujourd’hui à ses correspondants un régime semblable).
Mais le jeune Descartes était lassé des livres et des écoles, tandis que le jeune Henri Michaux n’avait pas fait de bonnes études (il avait lu Lautréamont).

Quand il débarque à Paris en 1924, il est surréaliste comme tout le monde. Mais Paulhan le prend en charge, et le pousse dans sa propre voie. Derrière Ecuador, Un Barbare en Asie, ou Plume, on sent la sécheresse et la dureté de Paulhan, ses obsessions, ses hantises. Ce n’est pas le moindre intérêt de cette Pléiade de nous révéler ce premier itinéraire littéraire, moins pur et moins original qu’on pourrait le croire.
Mais enfin ces livres, qui m’auraient tant déplu il y a vingt ans si je les avais compris, ces livres de retour et de doute hyperbolique, cette Amérique du Sud sans la culture indienne et la mort d’Ecuador, ces Hindous sans extase, ces Chinois sans Histoire, ces Japonais sans éros du Barbare en Asie, ce pauvre individu «plumé» des années fascistes, tous ces livres ont conduit – après la longue captivité du Belge Michaux dans les camps français – à la quête de la vérité du Moi et de son éclatement, à la quête cartésienne vers laquelle, sans doute, ils marchaient. Mais toujours négativement, par élimination.
Je sais que Michaux est infiniment revenu sur ses premiers livres, avouant en nombreuses préfaces, avertissements, notes et introductions, combien sa vue de l’Asie en particulier avait été courte, myope, péremptoire, partiale. Mais enfin, il n’a pu revenir sur le monde qu’en passant par le détour de l’exploration de son ego, même éclaté, extatique, stupéfié. Mais il y a vingt ans, dans la librairie La Marge, je ne savais pas que Misérable miracle me ferait penser un jour au Discours de la Méthode.
Ch. C.
Henri Michaux, Œuvres complètes, tome 1, édition de Raymond Bellour et Ysé Tran, La Pléiade, Gallimard, 1998.