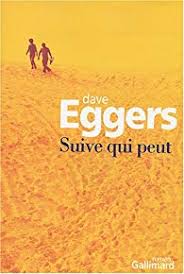Clochards aux baskets de vent
À propos de Suive qui peut, de Dave Eggers,
par Marie-Françoise Piot
Entrez, entrez, Mesdames et Messieurs, entrez dans le Grand Huit de Dave Eggers. Vous y serez essorés, chahutés, secoués et vous n’en ressorti-rez pas indemnes. Vous vibre-rez avec ces deux jeunes garçons lucides et naïfs à la fois. Vous voyagerez avec eux, sans avoir besoin de prendre l’autocar de la ligne « Greyhound ». Si vous n’aimez pas l’avion et les dépaysements, renoncez.
Prenez le héros, Will Chmielewski, Polonais immigré de son état. On est en Amérique. Il est jeune (27 ans). Il s’est fait tabasser par des salauds qui l’ont pris pour un autre. Cela se passait dans un entrepôt d’Oconomowoc, Chicago. Il doit partir pour se faire oublier. Il essaye pendant tout le roman de se faire passer pour fou, sans y parvenir tout à fait. Son humour déjanté le signale cependant comme particulier : « Ma tête est une église désaffectée au clocher peuplé de chauves-souris, mais je passe à la seconde de mes sombres pensées à l’euphorie dès que je songe au départ. » Partir, tel est le credo de Will et de son bon copain Hand. Remarquez en passant les prénoms en forme d’onomatopée significative, qui vous rappelleront peut-être un certain Beckett. Les noms claquent, dans ce roman rapide. Chicago, Saskatchewan, Marrakech, Tallin. On caracole avec nos héros, prenant l’avion à tort et à travers, pour survoler un maximum de continents en un minimum de jours. On va s’immerger dans d’autres cultures, rencontres dans des
bars avec de drôles de personnages.
Le roman prend sa véritable dimension dans la force des monologues intérieurs de Will, personnage décidément pas banal. Il observe, féroce-ment. Il mène la sarabande, il analyse, il réfléchit. Les dialogues de nos deux clochards aux baskets de vent se bousculent, pas aussi absurdes qu’ils en ont l’air. Will-Hand-Hand-Will, Jack. Tiens, que vient-il faire ici, celui-là ? Tout s’éclaire : Jack, leur ami, a été tué par un chauffard. La grande faucheuse a déclenché cette frénésie de fuite en avant qui fera parcourir à nos deux héros en huit jours (tiens, un de plus que pour la Création du monde) un vaste zigzag qui les ramènera rapidement à leur point de départ. Complètement zinzin. Suive qui peut, comme l’a bien rendu le traducteur, Pierre Charras, le titre original étant You shall know our velocity.
Un mot, encore, pour expliquer que Will part pour échapper à son destin, pour fuir son traumatisme, la mort accidentelle de son copain Jack, pour claquer les 32 000 dollars qu’il a reçus pour prêter sa silhouette à une pub.
L’argent, c’est de la merde, c’est obscène. Alors Will et Hand vont coller des dollars sur les flancs d’une chèvre, les glisser dans la main d’une pute (déjà plus classique) et opérer mille ruses pour claquer jusqu’au dernier billet, vraiment. Et on y croit ! Pour-quoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu’on a affaire à une satire de l’Amérique. Il y a du Fante dans cet auteur. Et ça fait du bien à entendre. Il murmure à notre oreille autre chose que ce qui est dit ! Et c’est ça qu’on aime chez un écrivain bien trempé ! Henry Miller, dans un recueil d’essais inédits, digresse justement sur l’argent : «L’argent est un des problèmes insolubles de la vie. Les théoriciens vous diront que l’argent est inutile, mais les théoriciens sont en général des gens ignorants. Souvent, ils n’ont pas du tout d’argent et, s’ils en avaient, ils ne sauraient pas quoi en faire ». Will et Hand sont des théoriciens ! Ils ont de l’argent, et ils ne savent pas quoi en faire. Il y a une forme de rédemption dans leur manière de ne rien garder, de tout distribuer. C’est biblique ! Henry Miller, toujours, à propos des déplacements dans l’espace: «Peut-être que de façon einsteinienne, le modeste saint Milarepa, assis sur la queue d’une comète, converse avec ce délicieux escroc de Lao Tseu, tandis qu’ils vont joyeusement d’une planète à l’autre, d’un univers à l’autre… » (in : Henry Miller, L’oiseau-mouche, Bourgois, 1997).
Si Dave Eggers n’est pas «un génie renversant» (allusion à son premier ouvrage, Une oeuvre déchirante d’un génie renversant, Balland, 2001), il nous transporte dans Suive qui peut dans une réflexion sur le sens de la vie qui peut sembler délirante, loufoque et déjantée, mais c’est cela justement qui fait sa force, et qui peut-être explique son succès outre-Atlantique. Il nous touche parce qu’il est «voyant», un de ceux qui ont côtoyé la mort de près. Il nous transporte dans une sorte de « multivers » très Calvin et Hobbes. Terminons par cette sorte de prière adressée au copain dis-paru: « Jack, je me suis forcé à rêver de toi… Seigneur Dieu, Jack, hier nous avons voyagé en plein soleil dans des forêts qui ressemblaient aux nôtres… Le multivers explique l’existence des rêves, n’est-ce pas? Putain, Jack, j’ai vraiment cru qu’on te verrait. Mais j’ignore totalement si c’est possible pour toi, pour un autre toi, de vivre ainsi quelque part après être mort dans le Wisconsin. S’agit-il de nombreux nous-mêmes vivant simultanément, mourant simultanément, ou alors de tous ces nous-mêmes suivant chacun un chemin différent ? J’aurais dû poser la question. Pourquoi est-ce que je n’ai pas posé la question ? »
Au fond, ce que j’ai aimé dans ce roman, c’est qu’il pose des questions. Et qu’aucune, non, vraiment aucune, n’est absurde.
M.-F. P.
Dave Eggers. Suive qui peut. Traduit par Pierre Charras. Gallimard, coll. « Du monde entier», 2003, 461 pages.
(Le Passe-Muraille, No 60, Avril 2004)