Claude Frochaux ou la pensée buissonnière
À propos de L’Homme seul,
par JLK
C’est un livre formidablement stimulant qu’a publié récemment l’écrivain et éditeur lausannois Claude Frochaux, constituant bonnement une explication du monde, des origines de la civilisation à nos jours. Le projet pouvait sembler d’une incroyable prétention. Or, le résultat de quelque quinze ans de travail solitaire, enrichi par un bon millier de lectures, est un livre sans boursouflure aucune, d’une épatante originalité, qui se lit et se vit comme une conversation incessamment enrichissante.
Vous aurez remarqué qu’il se trouve, depuis la nuit des temps, au fond des préaux d’école ou au zinc du café d’à côté, un même personnage qui n’en finit pas de faire et de refaire le monde. Ce n’est pas le type du je-sais-tout qu’on pourrait imaginer, qui rafle tous les prix d’excellence. Bien plutôt, c’est un éternel rêveur, dont les qualités essentielles pourraient être définies par ces deux termes: la candeur et la curiosité.
Et tel est Claude Frochaux. Vous le connaissez peut-être: il n’a pas, spécialement, l’air d’un aigle dans aucune spécialité du savoir. Sans titre universitaire, venu à l’édition par la librairie et à la littérature sans ambition déclarée de faire grande œuvre, il est toujours resté un peu en retrait de la scène, un peu à l’écart, un peu velléitaire même, tout en manifestant un goût vif pour la discussion.

Jusque-là, l’écrivain avait produit quelques livres, tous différents les uns des autres et toujours intéressants à quelque égard. Dans un texte que nous nous rappelons très nettement, Claude Frochaux déclarait: la littérature est une vitesse. On ne savait pas trop ce que cela voulait dire mais c’était juste le concernant: la littérature de Claude Frochaux avait une certaine vitesse. Le Lustre du Grand Théâtre avait une vitesse, disons, esthétique, de même qu’Heidi ou le défi suisse avait une vitesse critique, que Lausanne ou les sept paliers de la folie avait une vitesse imaginative, que Les Amis de Paméla Gibson avait une vitesse existentielle et qu’Aujourd’hui je ne vais pas à l’école atteignait ce qu’on pourrait dire la vitesse de pointe de l’écrivain, avec un mélange très singulier de verve verbale et de bonheur spéculatif.
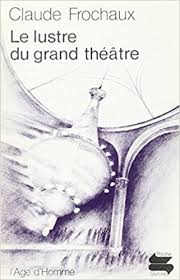

Or, voici quinze ans que Claude Frochaux ne s’était plus manifesté en tant qu’auteur, portant certains de ses lecteurs à s’inquiéter. Que devenait-il donc ? Le travail qu’il consacrait, à l’Age d’Homme, à la défense des auteurs romands, l’avait-il fatigué ? Etait-il en train de s’éteindre dans son cagibi poussiéreux ? Ou n’avait-il simplement plus rien à dire ? Un jour que nous lui demandions des nouvelles de son travail personnel, il nous répondit qu’il s’était attelé à un machin «assez énorme» et «de longue haleine», et nous l’avons pris sans trop y croire, d’abord parce que lui-même ne semblait pas lui accorder une importance excessive, et ensuite parce que l’annonce d’un machin «assez énorme» et «de longue haleine» prélude le plus souvent à une attente sans objet.
Et voici qu’on annonçait bel et bien, à l’automne dernier, la parution du fameux «grand machin», puis voilà que nous arriva ce livre au titre aussi nu que son texte d’à peine moins de 500 pages, sans une note ni une référence, avec six têtes de chapitre annoncées et une conclusion suivie d’une conclusion de la conclusion.
Nous avons lu les têtes de chapitre: L’Histoire, La Géographie, La Religion, La Philosophie, Le Théâtre, la Littérature. Diable ! Ainsi donc, Claude Frochaux allait nous parler de tout ça. Encore heureux que nous coupions à l’Economie, à la Politique ou à l’Avenir, mais quel programme en attendant! Nous nous rappelions, à ce propos, le même pari fou du journaliste Jean-François Kahn, deux ans plus tôt, qui sous le titre de Tout change parce que rien ne change s’était lancé dans la confection d’un même énorme soufflé, lequel devait retomber, hélas, faute de substance et de réelle originalité.
Tout au contraire, et dès les premières pages de L’Homme seul, le sentiment d’une vitesse retrouvée nous réjouit, et bientôt aussi, et de plus en plus vigoureuse au fil des chapitres: cette alacrité d’une pensée personnelle entièrement engagée dans un combat vital, qui nous rappelait soudain ces lectures «essentielles» de notre jeunesse qu’il nous fallait poursuivre absolument jusqu’au cœur de la nuit.
Ce qui est cependant très étonnant, aussi, c’est le ton sur lequel Claude Frochaux traite de ces fameuses questions «essentielles», le ton et le point de vue. Vous vous figurez le culot de s’engager là-dedans: l’Histoire. Les origines. Non pas les origines de tout, qui nous valurent déjà d’être vannés par les scientistes à la Reeves ou leurs épigones spiritualistes à la Chaunu, mais quand même: les origines de la civilisation. Comment tout a commencé, non pas scientifiquement démontré, mais raconté. Non pas la Genèse ressassée, mais l’histoire du limon, l’histoire du premier coup de reins hors de la gangue naturelle, l’histoire du premier agriculteur, l’histoire du premier remords, l’histoire de la découverte consciente de la sexualité et l’histoire de la naissance de la solitude de l’homme.

Tout cela, Claude Frochaux le raconte avec ses mots et avec ses images, mais dès la première page aussi son récit est porté par un sens. C’est que lui-même est porté par un sentiment profond que tout ce qui nous arrive sur terre correspond non pas à un hypothétique «sens de l’Histoire», mais que la marche de l’homme va dans un sens continu dont on peut suivre l’évolution sur la carte, car l’Histoire, pour Frochaux, c’est essentiellement «de la biologie sur du géographique».
La géographie n’a pas de majuscule, mais Frochaux lui accorde nettement plus d’importance qu’à l’Histoire, en cela que le climat détermine la progression de l’Histoire et que la psychologie des hommes, leur aptitude au travail et tous les facteurs de développement dépendent de leur situation géographique. Ainsi résumé, tout cela ne paraît guère original à vrai dire, pas plus que les observations initiales de Frochaux sur les grands flux de l’évolution ou, plus tard, sur les déterminismes pesant sur l’évolution de la religion ou de la philosophie. Réduit à des schémas, L’Homme seul ne serait pas d’un grand intérêt, péchant par réductionnisme.
Or ce livre, nous semble-t-il, est beaucoup moins réducteur qu’il n’y paraît, dans la mesure où il montre à tout moment comment la civilisation échappe précisément, ou contourne les déterminismes. Plus encore, c’est par le choix des détails qu’il met en va-leur que Frochaux nous convainc non pas de la Vérité, car jamais il ne prétend en assener aucune exclusive, mais de la vraisemblance d’une interprétation qui corrobore une vision d’ensemble.
Sans doute, racontée par Claude Frochaux, l’histoire de la philosophie est-elle marquée par un constant déterminisme, mais com-ment nier celui-ci ? De la même façon, son interprétation de l’évolution de la littérature, des sources communautaires de la tragédie, réponses symboliques à des questions collectives vitales, à l’individualisation et à l’intériorisation progressive du roman, se conforme-t-elle à une même prise en compte lucide et nuancée des déterminations extérieures.
Or le «réalisme» de Frochaux, son honnêteté foncière à base de candeur et de curiosité, fonde aussi ce que nous pourrions dire son optimisme à long terme, nullement contredit par le tableau plutôt sombre qu’il brosse de la culture et des sociétés contemporaines. Claude Frochaux n’est pas ce qu’il est convenu d’appeler un croyant, et pourtant L’Homme seul est l’un des livres les plus chargés de spiritualité qu’il nous ait été donné de lire depuis longtemps. Sa leçon modeste et têtue, souvent malicieuse, jamais blessante, est d’une pensée libre et généreuse dont il faut examiner et discuter les propositions avec la même disponibilité que celle de l’auteur.
Ce livre est, en outre, une grande œuvre de mémoire. Une fois encore, l’auteur n’est pas un savant ni même un spécialiste. C’est un homme qui a pris la peine de lire beaucoup de livres qui ont façonné le cœur humain. Sa façon de resituer la vocation de la littérature et ses enjeux majeurs, même au fil d’aperçus partiels (voire partiaux, mais lisez ses aperçus sur l’amour courtois, sur Shakespeare, le superbe Quichotte, et Racine, mais pas Molière ! et le romantisme ou Joyce à l’extrême parapet !) devrait lui valoir aussitôt une chaire à l’Université, car voici l’universalisme, et dans la meilleure tradition helvétique !
De fait, et pour conclure, en lisant L’Homme seul, nous pensions à toute une Suisse terrienne mais cultivée, sceptique et mystique à la fois, voyageuse et non conformiste, que Claude Frochaux continue à sa façon candide et curieuse, sur les sentes buissonnières du gai savoir.
J.-L. K.
Claude Frochaux, L’Homme seul, L’Age d’Homme, Lausanne, 485 p.
[Ndlr] Les extraits figurant en marge de cet article sont tirés de L’Homme seul. Les titres sont de la rédaction.

Ce que dit Claude Frochaux
De la déraison raciste
Les Africains auraient pu construire Chartres ou la Tour Eiffel. Mais il aurait fallu qu’ils vivent en France au moins 3000 à 5000 ans. C’est cette dimension temporelle qui fausse le plus les esprits et conduit le plus sûrement au racisme. Car il y a supériorité des uns sur les autres. Il y a supériorité des Européens sur les Africains. Mais elle n’est pas de type humain. Elle est de type historique. Si les Européens sont supérieurs aux Africains, c’est parce que la terre d’Europe, la situation de l’Europe, son climat, son sous-sol, son accès à l’eau et mille autres choses sont supérieurs à ceux de l’Afrique. Il ne faut rien nier de ces supériorités, mais il faut les définir clairement. Chacun n’a pas eu les mêmes atouts de départ, les mêmes possibilités d’expansion et de développement. Cela bien vu, reconnu et analysé, toute forme de racisme disparaît. Chaque homme est inégal, parce que chaque situation de départ est inégale. La parité morale, humaine, celle des valeurs essentielles n’est pas en cause.
De la tragédie
La tragédie grecque nous oblige à affronter ce que nous voudrions tous oublier. Nous avons été des animaux, si nous ne le sommes plus. Nous avons suivi d’innombrables chemins, avant de découvrir celui qui nous mènerait à la voie, seule possible. Celui qui nous permettrait de ne pas être récupérés par la nature ou, au contraire, de dégénérer faute d’ouverture et de renouvellement. Qu’elle mette en scène l’inceste, Médée mangeant ses enfants ou, au contraire, la perte par dispersion, solitude ou aventure, les tragiques grecs ont désigné ce qu’étaient les dangers mortels qui avaient assailli nos ancêtres, avant qu’ils ne découvrent, dans la violence, hélas, inévitable, la voie médiane, seule apte à perpétuer la race humaine, sortie de son berceau naturel.
Du nouvel homme
Il y a aujourd’hui beaucoup de résistances à ce qu’un constat simple, logique s’établisse. On essaie un peu partout de se rassurer. Non, le sacré n’est pas mort. Oui, le divin existe. La transcendance aussi. Le sacré n’a fait que se déplacer. Il était hors de l’homme, il est dans l’homme. La transcendance allait de l’homme à Dieu. Elle va maintenant de l’homme à l’homme. L’homme peut s’auto-transcender. C’est l’idée de Nietzsche. Le dépassement. Le sacré n’est pas mort. Il est en nous. Il faut le redécouvrir. L’alimenter. La création artistique peut continuer, vivre, produire. Il lui faut se contenter de rester dans les limites, certes étroites, mais suffisantes de l’homme. De l’homme-Dieu. De l’homme qui s’est lui-même divinisé en s’extirpant de la gangue naturelle. Peut-être n’a-t-il jamais été aussi grand qu’aujourd’hui…
On peut le penser. On peut penser que la grandeur de l’homme peut s’édifier ailleurs que dans la création imaginaire. La réalité l’emporte: il est normal qu’elle sonne le glas de la culture, selon sa conception ancienne. Et il nous reste le plus fabuleux des passés. Mais faut-il se leurrer ? Faut-il croire à cette autotranscendance de l’homme-Dieu ? Pourquoi ne pas jouer la carte de l’homme adulte et avoir, collectivement, par rapport à notre passé, le regard de l’homme adulte sur l’enfant qu’il fut. Il faut apprendre à aimer cet enfant et il faut apprendre à vivre une nouvelle phase de notre histoire. Une histoire qui sera sans tristesse, sans regrets, sans remords, l’histoire de l’homme seul.
De la solitude
Nous ne sommes pas seuls, individuellement. Chacun par rapport à d’autres. Nous sommes seuls, tous ensemble. Nous ne sommes pas seuls séparément. Nous sommes seuls ensemble. Par rapport à quelque chose. Et non par rapport à quel-qu’un. Nous sommes seuls d’être hors nature. Nous sommes seuls parce que humains. Par rapport aux plantes, aux animaux, à l’univers. Nous sommes cinq, six, bientôt sept milliards à être seuls ensemble.
C. F.


