Mes bibliothèques d’enfance
Un texte inédit de J.M.G. Le Clézio, en ouverture du Passe-Muraille de décembre 1993. Le monde fabuleux d’un lecteur omnivore…
Le plus ancien souvenir que j’ai d’un livre, c’est le livre dans lequel Alice, ma grand-mère m’apprenait à lire. C’était la guerre, il n’y avait pas d’école, et je me souviens des pages de ce livre, que je tournais lentement, en regardant les illustrations, et en cherchant à déchiffrer les signes noirs qui dansaient devant mes yeux. Dehors, il pleuvait, il y avait ce silence si particulier aux périodes de tragédie. Le livre racontait l’histoire d’une pie qui survolait un paysage ensoleillé, une rivière, des champs. C’était une extraordinaire impression de liberté. Le livre s’appelait La Joie de lire.
C’est toujours chez ma grand-mère Alice que j’ai fait connaissance d’autres livres, plus tard. Mon père était en Afrique, je ne savais rien de lui. La bibliothèque de ma grand-mère regorgeait de trésors, certains interdits: Guy de Maupassant, Une vie, Le Horla. C’était étrange, lointain. Il y avait des mots inconnus, des apparitions; je me souviens d’un très fort parfum de femme, un parfum capiteux, profond, qui me faisait frissonner. C’était captivant et dangereux comme une mauvaise rue. Je lisais aussi Nana, Germinal, L’Assommoir. Il y avait chez ma grand-mère surtout des livres du début du siècle, dans des éditions brochées, bon marché, en mauvais état, avec ces couvertures aux caractères démodés, belle époque, et ces illustrations venues d’un autre temps. (Je me souviens de Bel-Ami, le lit défait, cette jeune femme dont l’épaule blanche glissait hors de la chemise, et l’homme qui l’enlaçait, sanglé dans son costume, sa moustache en bataille…)
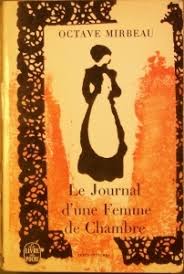

Beaucoup de ces livres aujourd’hui oubliés, disparus, transformés en poussière, objets rejetés sur l’étal des bouquinistes comme les bois flottants abandonnés par la mer sur les rivages: Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices; peut-être le Journal d’une femme de chambre. Eugène Dabit, Hôtel du Nord. Marcel Prévost, Les Demi-Vierges. Jean Lorrain, La Maison Philibert. Pierre Loti, Madame Chrysanthème, Ramuntcho. Pierre Louys, Aphrodite. Livres que je n’ai pas lus, livres que j’ai flairés, dont j’ai touché longuement les pages lisses, à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, le monde brillant, léger, vaporeux comme un mirage, les lumières des grands boulevards, le brouhaha des fêtes et le tumulte des sentiments, pour moi qui vivais si loin, si fermé au monde, dans cette ville de Nice peuplée de vieilles dames.
Dans cette même bibliothèque de ma grand-mère, j’accédais à quelque chose d’autre, encore plus mystérieux, qui s’appelait la littérature. Je lisais sans ordre, à la suite, pendant ces longs après-midi d’hiver, Don Quichotte, le Lazarillo de Tormès, les Contes drôlatiques de Balzac, les Voyages de Gulliver, Manon Lescaut, le Télémaque, Gil Blas de Santillane, De la nature des choses, Ossian, Ivanhoe, Les Misérables, L’Ami Fritz d’Erckmann-Chatrian, et, bien sûr, les Aventures de Robinson Crusoé, dans l’édition Marne de 1867, deux petits volumes reliés de toile rouge, dont les illustrations me faisaient rêver indéfiniment, Robinson vêtu de peaux de bêtes, coiffé d’un haut chapeau, portant majestueusement son parasol de feuilles, ou encore Vendredi: «Il prend un de mes pieds et le pose sur sa tête».
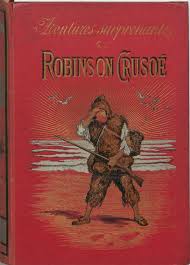
J’ai aimé ces deux petits livres plus que tout autre, je les ai gardés avec moi, ils m’ont accompagné dans mes études d’anglais. Sur une page, quand j’avais dix-huit ans, j’ai écrit: Why ? — because he can’t go from the hill. Les livres qu’on aime sont vraiment ceux sur lesquels on griffonne des phrases insensées.
Je reviens à cette bibliothèque de ma grand-mère Alice, comme à la source infinie de mes lectures d’enfant. Il y avait, au deuxième étage de ce meuble, une collection de livres reliés en cuir fauve, portant écrit au dos, en lettres dorées, Dictionnaire de la conversation. Je crois qu’aucun livre ne m’a apporté autant de plaisir et de profit que ces dictionnaires, publiés autour de 1860, et qui représentaient la somme des connaissances au XIX’ siècle, avec des articles sur des sujets aussi divers que la mythologie grecque, l’hermaphrodisme, la pensée de Leibniz, ou l’astronomie, écrits par des esprits aussi brillants et compétents qu’Onésime Reclus, Ernest Renan, Fabre d’Olivet ou Alfred Maury. Je passais de longs après-midi plongé dans les dictionnaires, lisant au hasard des pages, passant d’un thème à un REPÈRES autre sans aucun ordre logique, comme dans une sorte d’aventure totale. Sans doute ai-je gardé de la lecture des Dictionnaires de la conversation de ma grand-mère le goût pour les diction-naires encyclopédiques, pour l’Encyclopaedia Britannica que mon père acheta par la suite, dans une vieille édition des années 30, et qui contenait des chapitres si étonnants sur l’urbanisme des temps futurs, ou sur l’art des bouquets au Japon. Les dictionnaires m’ont semblé, à partir de là, les livres premiers, ceux qui me permettaient d’ima-giner, qui contenaient en quelque sorte l’amorce de mes propres livres, mes personnages, mes fantasmes les plus secrets. Le Dictionnaire Quillet, édition de 1935, les Dictionnaires Larousse illustrés en sept volumes, édition de 1902, le Larousse Gastronomique, édition de 1938 illustrée, contenant des renseignements aussi utiles que la carte des vins de Bordeaux, et aussi étonnants que la recette de la sauce béarnaise ou des nids de l’hirondelle salangane selon l’usage en Extrême-Orient.



De la lecture des Dictionnaires j’acquis aussi le goût des cartes et des atlas, particulièrement de l’Atlas Larousse illustré (édition du début du siècle dans laquelle figurait encore l’Empire de Russie, et l’Empire ottoman qui s’étendait jusqu’à la Mer Rouge). Des cartes sur lesquelles le mon-de semblait encore immense, avec ces mentions qui faisaient rêver: Régions gelées, ou Terres inexplorées. Les sources de l’Amazone encore incertaines, et les affluents de l’Orénoque en pointillés. Plus tard, j’ai préféré la lecture des Dictionnaires à celle de n’importe quel essai, et même à celle de beaucoup de romans. Dans le Price’s Text-book of The Practice of Medicine (Oxford University Press) ou dans le grand Atlas Bartholomew, je trouvais la matière première de la littérature. L’Astronomie Populaire de Camille Flammarion (édition de 1867) avec ses gravures montrant le lever de terre sur Vénus, ou le ciel de Saturne barré de ses immenses arcs-en-ciel. Un ami de ma grand-mère, un certain Claudius Véran avait laissé un trésor extraordinaire, sous la forme d’une collection complète du Journal des Voyages (années 1870-1880) dans laquelle je pouvais suivre, comme si c’étaient des événements contemporains, les voyages de Richard Burton en Haute-Egypte, ou l’exploration du Niger par Stanley.
La bibliothèque de Sir Eugène
Plus tard, lorsque mon père revint d’Afrique, je découvris une autre bibliothèque, qui fut pour moi comme l’entrée dans un autre monde. C’étaient les livres ayant appartenu à mon arrière-grand-père Sir Eugène Le Clézio, et qui était revenue à mon père par le jeu des héritages. Tous les livres portaient sur la première page la marque de mon arrière-grand-père, sa signature écrite d’une main fine et élégante. Livres reliés, le dos orné de fers dorés, avec ce poids et cette odeur de cuir qui évoquaient la majesté passée de ma famille, le temps de la grande maison d’Euréka, le temps où il était chef-juge à la cour suprême de Maurice, et où on lui proposait d’être le gouverneur de Ceylan. Dans les quatre bibliothèques majestueuses de style victorien, les livres étaient à la fois attirants et effrayants, ils n’avaient rien de commun avec les bouquins sulfureux et démodés de ma grand-mère. Pourtant c’est d’eux que j’ai appris le mélange d’étrangeté et de force familière qui émanent des mots imprimés.
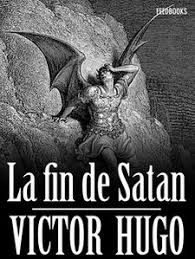
Une fois ouverts, les livres donnaient leur nourriture, et même l’enfant que j’étais (j’avais dix, douze, quatorze ans) pouvait se les approprier. Il y avait une collection complète des grands auteurs, de Baudelaire à Flaubert (La Tentation de Saint-Antoine) ou de Hérédia à Hugo (La Fin de Satan, Toute la Lyre). Il y avait Rabelais, Goethe, Horace, Lucrèce, Virgile, Scarron, Tôpffer (Les Voyages en zig-zag) Swift, Byron. Des livres que je n’ai trouvés que là, comme Fiera-bras de Mary le Fon, Florian, Gessner, Grandville (Cent Proverbes), Henri Monnier (Scènes Populaires); et cette collection de livres illustrés, qui me faisaient rêver, publiée par Rothschild en 1867, Les Fougères, Les Palmiers, Les Plantes à feuillage coloré, Les Papillons, Les Coléoptères. Qui entretenaient mon goût des encyclopédies. De Victor Duruy, Histoire des Grecs, ou de Maurice Maeterlinck, Les Fourmis. Et surtout, dans la bibliothèque d’Eugène, je trouvais cette extraordinaire collection de livres de voyages qui m’a influencé plus que toute autre lecture ou toute autre expérience réelle dans ma vie. Je cite ici quelques-uns des titres, non dans l’ordre de mes lectures, mais dans l’ordre de rangement dans la bibliothèque II qui leur était entièrement consacrée:
Tablette 1. Souvenirs de la Réunion (1853); Bory de Saint-Vincent, Voyages dans les quatre îles de la Mer d’Afrique (1804); Tombe, Voyage aux Indes Orientales (1810);. Marchand, Voyage autour du monde (An VI de la République); Cook, Voyages aux Mers du Sud; Duchesne, Atlas des Plantes utiles et vénéneuses; Voyage de François Leguat, (1708). Et ce petit livre étrange, qui m’a fait beaucoup désirer, Le Projet de République à l’île d’Eden, du Marquis Henri du Quesne, publié par Sauzier en 1887.
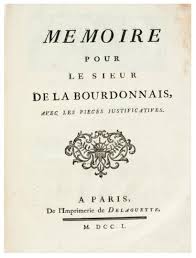

Tablette 2. Abbé de Caille, Voyage au Cap de Bonne Espérance, (1763). Les Mémoires de La Bourdonnais (1751); Souchu de Renne-fort, Histoire des Indes Orientales (1668); Luillier, Voyages aux Indes (1726); Dubois, Voyage aux îles Dauphines (1674);
Tablette 3. Le Gentil, Voyage dans l’Inde (1777); De Laval, Voyage de Pirard (1679); De Flacourt, Histoire de Madagascar (1661); Relations véritables et curieuses de Madagascar & Brésil (1651); Drury’s Madagascar (1807); Lacombe, Voyage à Madagascar (1840); Abbé Rochon, Voyage à Madagascar (1801); l’étonnant voyage de l’aventurier Bényoski (Voyage, 1791); Le Vaillant, Voyage à l’Intérieur de l’Afrique (1790); Haussmann, Voyage en Chine (1847); Dumont d’Urville, Voyage au Pôle Sud, (1842); Le Livre des Merveilles, de Marco Polo (1865); Billard, Voyage aux Colonies Orientales (1829); Voyage à l’Arabie Heureuse (1716); Prince Roland Bonaparte, Voyage en Insulinde (1884); Régnon, Madagascar et le Roi Radama (1865).
Tablette 4. Albert Pitot, Ile Maurice (1810); Charles Grant, History of Mau-ritius (1801); Milbert, Voyage à l’Ile de France (1812); Adrien d’Epinay, un manuscrit intitulé L’île de France (1901); Bojer, Hortus Mauritianus (1897); d’Unienville, Ile Maurice (1885); Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Ile Maurice (1773); Pierre Poivre, Voyage d’un Philosophe (1794); Charles Baissac, Etude du patois créole (1888); Incidents of Tropical Life (1839); Matou, les Guêpes Mauriciennes (1861); Pajot, Simples Renseignements sur Bourbon (1878).
Tablette 5. Essai sur les Invasions normandes en Gaule (1823); Austen, Naval History of Mauritius, 1715-1810. À ces livres s’étaient mêlés ceux de mon père, les livres d’Elspeth Huxley et de Laurens Van der Post, The Lost World of Kalahari, de Stuart Cloete, The African Giant, Mamba. Et tout en bas, les merveilleuses recherches de l’ami de toujours de mon père, le District Officer Jeffreys sur les rapports entre les Ibos du Nigeria et l’antique culture de la Haute-Egypte, et l’écriture hiéroglyphique des Bamoun du Cameroun.
J’ai lu ces livres comme s’ils avaient été écrits pour moi, comme s’ils détenaient la vérité. Puis, plus tard, j’ai appris aussi à me détacher de ces bibliothèques sublimes et étouffantes, et j’ai acheté des livres, moi aussi: Salinger, The Catcher in the Rye, For Esme with Love and Squalor; Rimbaud, Une Saison en enfer; Artaud, Les Tarahumaras; Isaac Asimov, Foundation. J’ai lu Kafka et Saint-Exupéry, j’ai lu Boris Pasternak et Nathaniel Hawthorne, Italo Svevo et Flannery O’Connor.

J’ai aimé Stig Dagerman (Le Serpent), Marguerite Yourcenar (Quoi ? L’Eternité), Henri Michaux (Ecuador, Un Barbare en Asie), les poèmes de Sor Juana Ives de la Cruz, les Essais de Lévi-Strauss, le Kojiki, Dieu d’eau de Griaule, Soleil Hopi de Don Talayesva. Récemment, j’ai lu l’Almanach de Comté de Sands d’Aldo Leopold, un petit livre qui m’a fait beaucoup de bien. Mais aucun livre ne m’a apporté ce que m’ont donné les livres contenus dans ces deux bibliothèques infinies, celle d’Alice et celle d’Eugène, ce sentiment à la fois inquiétant et familier d’entrer dans une autre vie, dans une vie nouvelle.
J. M.G. Le Clézio


