Aux sources d’une parole fraternelle
Rencontre et conversation, sous l’égide de Dostoïevski, avec Michel del Castillo,
par JLK
Comptant au nombre des francs-tireurs de la littérature française contemporaine, non loin (notamment) d’un Louis Calaferte par l’intensité de son investissement existentiel et par la probité de sa démarche, Michel del Castillo n’a cessé, depuis la parution de Tanguy, en 1957, de travailler la matière de sa mémoire d’enfant humilié et offensé, puisant à la fois aux sources de la tragédie collective. À divers égards, les ressaisies romanesques de sa jeunesse massacrée (né en 1933, il fut d’abord renié par son père français, puis abandonné par sa mère très aimée, avant de croupir de longues années dans un bagne de mineurs), évoquent l’univers de Dostoïevski aux atmosphères mêlées de déréliction et d’incandescence spirituelle, d’amour et de meurtre, de terrifiante cruauté et de tendresse increvable. Plus encore, c’est dans son choix esthétique d’une langue-geste, dépouillée pour mieux dire le vrai, mais aussi le trouble et l’obscur, que l’écrivain s’apparente au grand Russe.
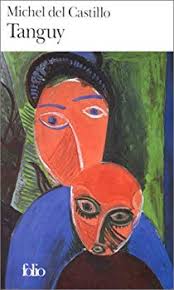
De Tanguy (récemment réédité) à Rue des Archives, en passant par La Nuit du Décret, le lecteur aura déjà décelé, peut-être, le rôle explicite joué, dans le développement de la poétique de Michel del Castillo, par celui qui fut plus pour lui qu’un écrivain de prédilection: un véritable frère secret qui l’aida à se comprendre lui-même et à supporter le monde ignoble qui l’entourait, avant de se «reconstruire». De cette alliance vitale, l’auteur du Crime des pères témoigne dans son dernier livre, intitulé Mon frère l’idiot et constituant, sous forme de lettre où se croisent et s’éclairent deux destinées et deux œuvres, un très bel acte de reconnaissance.

– Un sentiment profond de honte vous lie à Dostoïevski. Pourriez-vous nous en parler pour commencer ?
– Il le dit très bien dans L’Adolescent et cela revient tout le temps dans sa correspondance: très tôt dans son enfance il a éprouvé ce sentiment de honte lié à ce qu’il voyait dans son entourage et, plus précisément, à la laideur morale de son père. On sait à peu près tout de celui-ci: sa formation de séminariste (comme Staline…), son expérience de médecin militaire qui se réduit à peu près à l’époque à celle d’un infirmier, son vestige d’orgueil de nobliau ruiné, et surtout ses démonstrations d’alcoolo pleurnichard, violent et dévot. Or l’enfant, pour des raisons très mystérieuses, restera toujours stupéfait par l’opposition du discours moralisant de son père et la violence tyrannique, la lésinerie, la ladrerie que celui-ci impose à son entourage. C’est ce regard stupéfait de l’enfant sur le monde que j’appelle l’éternel enfant chez Dostoïevski. Dominique Arban a raison de s’étonner qu’un enfant de huit ans se mette à sangloter, à l’église, en entendant la lecture du Livre de Job. Mais c’est en somme son pain quotidien: ce qui le terrorise dans ce texte recoupe ce qu’il vit chez lui, et l’on comprend qu’il se demande, en garçon conséquent, comment il peut se faire que Dieu, s’il existe, ait pu passer un pacte avec Satan pour éprouver un juste: comment Dieu peut jouer avec la souffrance des innocents ? C’est pour Dostoïevski l’essence même du tragique. Et ça va revenir d’une manière permanente avec le thème de la souffrance des enfants. Une fois que cette organisation esthétique est en place, tout en découle. Nous vivons dans une société où les explications rationnelles ou scientistes nous empêchent de concevoir un tel processus: nous avons perdu de vue ce qu’est une vision du monde de type artistique. Dostoïevski, lui, n’a pas d’explication préalable. Il a ce regard stupéfait, la douleur le taraude, et c’est à partir de là qu’il commence à interroger le réel. Et même: quand il pourrait avoir une réponse à propos de l’existence de Dieu, il choisit le doute, comme si le fait d’avoir une certitude risquait de le tuer moralement. C’est pourquoi, entre le Christ et la vérité, il choisit le Christ. Cela nous paraît incompréhensible, et ça l’est si l’on ne comprend pas cet élan obscur et irrépressible qui procède d’une vision poétique. Il y a quelque chose de nietzschéen dans cette façon de poser le tragique comme source de connaissance. Tout ce qu’on a dit contre son sentimentalisme, son dolorisme, son mysticisme chrétien, et l’image de Kundera qui est si forte, du jeune tankiste russe qui pleure en appuyant sur la détente: tout cela est vrai. Cependant, si déraisonnable que ça paraisse, c’est aussi là que réside sa découverte, et le fonds de sa langue, et la substance même de sa poésie, étrangler en sanglotant, sangloter en poignardant – tout le temps il a été écartelé. Sur la question de l’antisémitisme, par exemple, à la fin de sa vie, quand il publie le Journal d’un écrivain, une jeune étudiante juive lui écrit pour s’étonner de ce que lui, qu’elle aime tant, puisse nourrir de tels sentiments. Alors lui de se récrier que non, qu’elle l’a mal compris, que ce n’est pas contre elle qu’il en a, qu’il est son ami, etc. En fait il est empêtré, comme toute sa génération, avec son idée que le Juif c’est Rotschild, la spéculation et la finance, la base même du capitalisme. Soit dit en passant, il y a des pages de Marx d’un antisémitisme virulent. Du Juif, Dostoïevski fait pour sa part une figure métaphorique à caractère satanique, puis il tombe sur une jeune Juive en chair et en os, qu’il ne peut évidemment englober dans sa typologie. Eh bien on sera sans cesse, avec lui, dans l’écartèlement. Dans L’Eternel mari, il est dit à un moment donné d’un personnage qu’une minute avant il ne savait pas s’il allait embrasser ou étrangler son interlocuteur, comme si tout se jouait sur une carte ou comme à la roulette, la pulsion pouvant tourner d’un côté ou de l’autre. Et telle est l’instabilité de cet univers. Lorsque je l’ai découvert, j’avais douze ans et pas la moindre clef pour l’interpréter. Pourtant, dans la situation où je me trouvais, lorsque l’ivrogne qui m’avait pris sous sa protection m’a donné Souvenir de la maison des morts, sans doute avec la conscience de me transmettre un secret, j’ai eu le sentiment que le monde qui m’entourait sortait de Dostoïevski et que celui-ci m’aidait en retour à le comprendre.
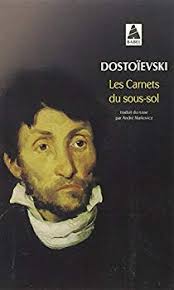
– A quelle époque votre réflexion concertée sur Dostoïevski remonte-t-elle ?
– Mes premières notes datent du début des années 70, mais tout était en place bien avant. Mon regard d’adolescent était, à bien des égards, le même que le sien. De surcroît, il me semble qu’il avait saisi, avec sa vision prémonitoire, l’essence même de l’époque dans laquelle je me trouvais précipité. Il a décrit les conditions historiques que j’allais vivre d’abord sans les comprendre. Ainsi, lorsque j’ai été confronté à la guerre, aux grands discours sur le socialisme, à tous les aspects du mal commis au nom du bien, j’ai reconnu un monde que je connaissais déjà par mes lectures. Dostoïevski a pressenti avec fulgurance ce qu’allait devenir l’Europe de notre siècle. Il le dit d’ailleurs sans cesse: en partant de la liberté j’arrive au despotisme, il faut tuer beaucoup au nom de l’amour, etc. Il voit que les idéologies totales contiennent fatalement le germe du totalitarisme. Ce qu’il dit sur Tolstoï est plein de mélancolie, mais la critique esthétique va bien au-delà de la forme: c’est toute une conception de l’Harmonie fauteuse de chaos qu’il incrimine.
– Vous opposez les écrivains du langage et les écrivains de la parole. Qu’entendez-vous plus précisément par là ?
– Il y a toute une catégorie d’écrivains qui pensent que la langue est une mécanique de mots: qu’il n’y a que la forme qui tienne. Ce sont les esthètes à la manière du XVIIIe qui pratiquent volontiers l’ironie et le deuxième degré. Pour les écrivains que j’appelle de la parole, je dirais qu’il y a quelque chose, derrière la mécanique des mots, qui cherche à se frayer un passage, sans qu’on puisse bien savoir de quoi il s’agit exactement. Donc on trébuche, comme chez Bernanos, on cherche, on vocifère, on s’empêtre pour dire ça. Au fil de mes propres expériences, dans ce bagne d’enfants où je me suis trouvé, j’ai été très frappé de voir que, malgré toutes les façades, les duretés, la jactance, la violence poussée à l’extrême, d’un seul coup, vers une heure deux heures du matin, ressurgissaient des voix d’enfants qui racontaient des histoires invraisemblables, qui inventaient une mère n’ayant jamais existé, un père qui allait les emmener en Amérique, et ce qui essayait de se frayer un passage ressemblait tout à fait à la parole de l’homme du souterrain qui avoue, après toutes ses provocations, qu’il n’aspire pas du tout au souterrain… et qu’il ne sait pas, d’ailleurs, ce qu’est exactement l’objet de son désir…

– Parlons alors plus précisément du «choix» de langue opéré par Dostoïevski.
– Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’obsession majeure de Dostoïevski reste Pouchkine tout au long de sa vie, parce que c’est celui-ci qui a créé la langue. Dans son adolescence, Dostoïevski a versé des larmes sur la mort de Pouchkine. C’est un deuil personnel: il a pleuré un frère. Mais quand il s’agit de choisir, c’est le petit-russien de Gogol, la langue populaire qu’il choisit en disant que le beau style signifie l’université, l’académie, pas ça du tout… comme si d’instinct il flairait que, pour ce qu’il cherche et qu’il ne connaît pas, il faut une langage apparemment heurté, apparemment violent, apparemment rugueux, non pas la belle langue mesurée de Pouchkine, mais celle de Gogol.
– Vous citez Pierre Pascal selon lequel c’est le bagne qui a fait Dostoïevski. Ne pensez-vous pas, comme Chestov, que la «révélation de la mort», le jour où il a échappé à celle-ci par grâce in extremis, est également un moment-clef ?
– Il revient toute sa vie à cette minute qu’il n’a pas comprise. Il avait déjà les yeux bandés et s’est senti, littéralement, de l’autre côté. Mais pas une pensée «élevée» à ce moment-là. Quelque chose de terrible. Et cela aussi: quelque chose d’intransmissible. Il parlera toute sa vie de ce qui précède ou qui suit. Il dit le trajet: tout ce qui s’est gravé dans sa mémoire au moment d’aller à la mort, les arbres, les oiseaux, la vie qui continue, tout ça, et ses larmes au moment d’embrasser ses camarades. Puis c’est le trou. Noir. Et ensuite, il raconte qu’après qu’on lui a retiré le bandeau, loin de trouver la vie «fantastique», il s’est borné à penser qu’on n’avait pas le droit de faire ça à un homme. Il dira que c’est de cette horreur-là que le Christ a parlé. D’où l’importance qu’il attache à l’Evangile de la résurrection. D’ailleurs il n’est pas seul: l’appel à Lazare, le «lève-toi et marche», les Russes le reçoivent comme une véritable commotion.
– Avez-vous vécu ce type d’expérience ?
– J’ai vécu quelque chose de ce genre lorsque j’ai compris que ma mère était en train de m’abandonner, alors que j’étais âgé de neuf ans Je n’ai pas pu parler pendant longtemps: littéralement j’en suis resté muet. Et longtemps après, je suis resté convaincu que tous les mots que je pourrais dire seraient faux. Sur le moment, cependant, ç’a été comme une illumination: c’était ainsi et pas autrement. Et je me suis dit, aussi, qu’on n’avait pas le droit de faire ça. C’est la réaction naturelle devant la tragédie, le «c’est pas vrai» qui en dit long…
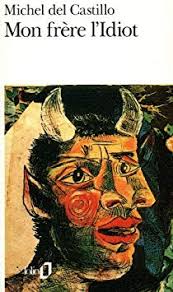
– Vous dites que jamais vous ne serez un auteur comique. Cependant le comique et le tragique ne sont pas incompatibles.
– Je l’entendais au sens d’une certaine légèreté, d’une certaine façon d’être spirituel, style Sacha Guitry, n’est-ce pas ? Or cela se voit dans ma langue: je n’aime pas les choses molles, j’ai peu de goût pour la démagogie, je suis profondément hostile à tout ce qui fait la sauce actuelle, une certaine fausse spiritualité, l’amour avec un grand A, l’harmonie avec un grand H et tout le bazar, la fausse tolérance, cette espèce d’amollissement général auquel on assiste à la télévision, la facilité de ne rien payer d’aucun effort. Avec l’athée, j’ai encore un dialogue, mais la démagogie humanitariste est le contraire de l’humanisme. C’est pourquoi je reviens sans cesse à nos sources. Dès le départ, ça se joue en Grèce autour de la mort, de la conscience, de l’individu et du conflit intérieur. Antigone fait un choix tragique: elle connaît très bien la loi qu’elle choisit d’enfreindre, et cela même fonde sa liberté et consomme son sacrifice. A l’inverse, quand on a tendance à tout confondre, on ne sait plus où on est. Je préfère, quant à moi, un Céline, même quand il est monstrueusement dégueulasse, à un simulateur d’humanisme, car je sais qu’il y a chez Céline une vraie révolte. Pensez aussi, à l’heure des simulacres de confessions qui se répandent à la télévision d’une façon si dégoûtante, à cette matrice de la conscience européenne qu’est l’aveu. Toute la Grèce connaît l’histoire d’Oedipe par cœur, et pourtant on va voir la représentation pour assister au tomber du masque. Comme si l’humanité ne se fondait pour les Grecs que dans la poésies qui est une progression: le «faire» par excellence. On «fait» ainsi la conscience, un geste après l’autre, comme un potier.
– Qu’entendez-vous par l’art de «révélation» dont vous parlez à propos de Dostoïevski ?
– Il suffit de voir comment se manifeste chez lui le sentiment de la réalité. Ses tableaux sont travaillés avec cette espèce de rage d’aquafortiste qui caractérise son style apparemment jeté mais tellement plus élaboré qu’on imagine, et ça y va dans les contrastes les plus violents, et tout à coup, sans crier gare, voici que ça se joue, que c’est là: que c’est réel. Il se dit réaliste, et c’est vrai. On s’en étonne en invoquant son atmosphère fantastique, mais il rétorque qu’il suffit de lire les journaux pour constater que le fantastique se trouve dans les multiples faits de ce qu’on appelle la banalité quotidienne. Il n’y a qu’à prendre l’exemple de la Douce. C’est en effet, à l’origine, un banal fait divers. Puis, un geste après l’autre, comme à tâtons, maladroitement, ça se forme et soudain, voilà: c’est là. Et c’est vrai que c’est comme une révélation. Et c’est vrai que cette façon de faire apparaître les choses a des conséquences incalculables sur le regard de celui qui est touché par Dostoïevski.
Propos recueillis par JLK


